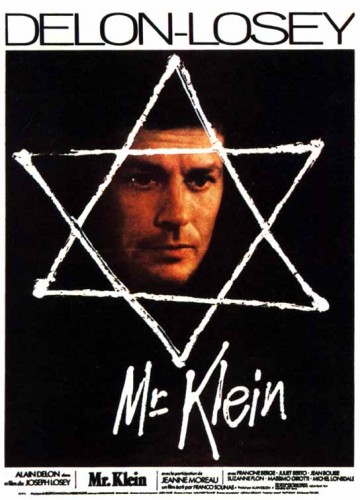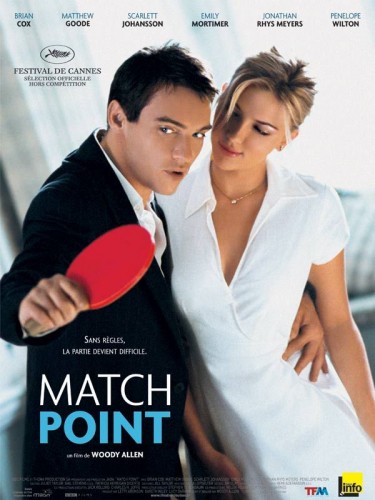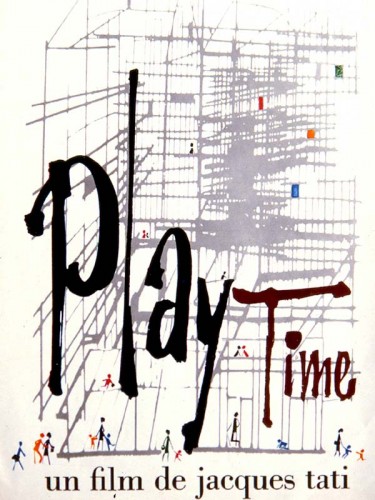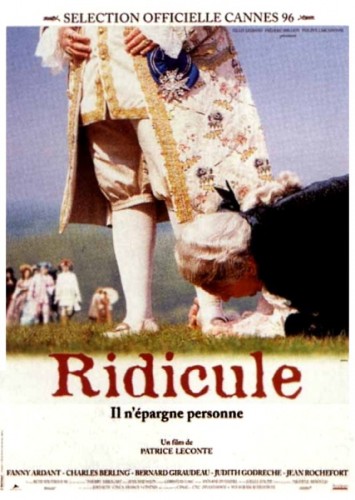Critique - LE CERCLE ROUGE de Jean-Pierre Melville (de retour en salles le 4 novembre 2020)

Annie Girardot aux César et dans ”Rocco et ses frères” (et critique du film de Visconti)
 Habituellement, je ne fais pas de rubrique nécrologique sur ce blog mais cette actrice représentait tout un pan de l'Histoire du cinéma (et du cinéma que j'aimais), a joué dans un de mes films préférés (dont vous pourrez retrouver un extrait ci-dessous et ma critique ).
Habituellement, je ne fais pas de rubrique nécrologique sur ce blog mais cette actrice représentait tout un pan de l'Histoire du cinéma (et du cinéma que j'aimais), a joué dans un de mes films préférés (dont vous pourrez retrouver un extrait ci-dessous et ma critique ).
Triste ironie du sort que son décès au lendemain des César où, il y a quelques années (en 1996), recevant son César du meilleur second rôle pour "Les Misérables" de Claude Lelouch, elle avait été si bouleversante, déclarant son amour au et du cinéma et émouvant une assistance qui, pourant, l'avait tant négligée (revoyez les images en cliquant ici et retrouvez également un extrait des "Misérables" ci-dessous).
Retrouvez également son impressionnante fimographie, en bas de cet article.
Synopsis : Après le décès de son mari, Rosaria Parondi (Katina Paxinou), mère de cinq fils, arrive à Milan accompagnée de quatre de ses garçons : Rocco (Alain Delon) Simone, (Renato Salvatori), Ciro (Max Cartier) et Luca (Rocco Vidolazzi), le benjamin. C’est chez les beaux-parents de son cinquième fils, Vincenzo (Spyros Fokas) qu’ils débarquent. Ce dernier est ainsi fiancé à Ginetta (Claudia Cardinale). Une dispute éclate. Les Parondi se réfugient dans un logement social. C’est là que Simone fait la connaissance de Nadia (Annie Girardot), une prostituée rejetée par sa famille. Simone, devenu boxeur, tombe amoureux de Nadia. Puis, alors qu’elle est séparée de ce dernier depuis presque deux ans, elle rencontre Rocco par hasard. Une idylle va naitre entre eux. Simone ne va pas le supporter…
Ce qui frappe d’abord, ce sont, au-delà de la diversité des styles (mêlant habilement Nouvelle Vague et néo-réalisme ici, un mouvement à l’origine duquel Visconti se trouve –« Ossessione » en 1942 est ainsi considéré comme le premier film néo-réaliste bien que les néoréalistes aient estimé avoir été trahis par ses films postérieurs qu’ils jugèrent très et trop classiques), les thématiques communes aux différents films de Visconti. Que ce soit à la cour de Bavière avec Ludwig, ou au palais Donnafigata avec le Prince Salina, c’est toujours d’un monde qui périclite et de solitude dont il est question mais aussi de grandes familles qui se désagrègent, d’être promis à des avenirs lugubres qui, de palais dorés en logements insalubres, sont sans lumière et sans espoir.
Ce monde où les Parondi, famille de paysans, émigre est ici celui de l’Italie d’après-guerre, en pleine reconstruction et industrialisation, où règnent les inégalités sociales. Milan c’est ainsi la ville de Visconti et le titre a ainsi été choisi en hommage à un écrivain réaliste de l'Italie du Sud, Rocco Scotellaro.
Avant d’être le portrait successif de cinq frères, « Rocco et ses frères » est donc celui de l’Italie d’après-guerre, une sombre peinture sociale avec pour cadre des logements aux formes carcérales et sans âme. Les cinq frères sont d’ailleurs chacun une illustration de cette peinture : entre ceux qui s’intègrent à la société (Vincenzo, Luca, Ciro) et ceux qu’elle étouffe et broie (Simone et Rocco). Une société injuste puisqu’elle va désagréger cette famille et puisque c’est le plus honnête et naïf qui en sera le martyr. Dans la dernière scène, Ciro fait ainsi l’éloge de Simone (pour qui Rocco se sacrifiera et qui n’en récoltera pourtant que reproches et malheurs) auprès de Luca, finalement d’une certaine manière désigné comme coupable à cause de sa « pitié dangereuse ».
Nadia ; elle, porte la trace indélébile de son passé. Son rire si triste résonne sans cesse comme un vibrant cri de désespoir. Elle est une sorte de double de « Rocco », n’ayant d’autre choix que de vendre son corps, Rocco qui est sa seule raison de vivre. L’un et l’autre, martyrs, devront se sacrifier. Rocco en boxant, en martyrisant son corps. Elle en vendant son corps (et le martyrisant déjà), puis, dans une scène aussi terrible que splendide, en le laissant poignarder, les bras en croix puis enserrant son meurtrier en une ultime et fatale étreinte.
Annie Girardot apporte toute sa candeur, sa lucidité, sa folie, son désespoir à cette Nadia, personnage à la fois fort et brisé qu’elle rend inoubliable par l’intensité et la subtilité de son jeu.
Face à elle, Alain Delon illumine ce film sombre de sa beauté tragique et juvénile et montre ici toute la palette de son jeu, du jeune homme timide, fragile et naïf, aux attitudes et aux craintes d’enfant encore, à l’homme déterminé. Une palette d’autant plus impressionnante quand on sait que la même année (1960) sortait « Plein soleil » de René Clément, avec un rôle et un jeu si différents.
La réalisation de Visconti reprend le meilleur du néoréalisme et le meilleur de la Nouvelle Vague avec une utilisation particulièrement judicieuse des ellipses, du hors-champ, des transitions, créant ainsi des parallèles et des contrastes brillants et intenses.
Il ne faudrait pas non plus oublier la musique de Nino Rota qui résonne comme une complainte à la fois douce, cruelle et mélodieuse.
« Rocco et ses frères » : encore un chef d’œuvre de Visconti qui prend le meilleur du pessimisme et d’une paradoxale légèreté de la Nouvelle Vague, mais aussi du néoréalisme qu’il a initié et qui porte déjà les jalons de ses grandes fresques futures. Un film d’une beauté et d’une lucidité poignantes, sombres et tragiques porté par de jeunes acteurs (Delon, Girardot, Salvatori…), un compositeur et un réalisateur déjà au sommet de leur art.
Filmographie d'Annie Girardot (source: wikipédia)
« Rocco et ses frères » a obtenu le lion d’argent à la Mostra de Venise 1960.
1950 : Pigalle, Saint-Germain-des-Prés d' André Berthomieu : Figuration
1950 : ...Sans laisser d'adresse de Jean-Paul Le Chanois : Apparition en jeune femme demandant si le taxi est libre
1955 : Treize à table d' André Hunebelle : Véronique Chambon
1956 : L'Homme aux clés d'or de Léo Joannon : Gisèle
1956 : Reproduction interdite ou Meurtre à Montmartre de Gilles Grangier : Viviana
1956 : Le Pays d'où je viens de Marcel Carné : Apparition
1957 : Le rouge est mis de Gilles Grangier : Hélène, l'amie de Pierre
1957 : L'Amour est en jeu ou Ma femme, mon gosse et moi de Marc Allégret : Marie-Blanche Fayard
1957 : Maigret tend un piège de Jean Delannoy : Yvonne Maurin, la femme de Marcel
1958 : Le Désert de Pigalle de Léo Joannon : Josy
1959 : La Corde raide de Jean-Charles Dudrumet : Cora
1960 : Recours en grâce de László Benedek : Lilla
1960 : La Française et l'Amour de Christian-Jaque, sketch : Le Divorce : Danielle, la femme de Michel
1960 : Rocco et ses frères (Rocco e i suoi fratelli) de Luchino Visconti : Nadia
1961 : La Proie pour l'ombre d'Alexandre Astruc : Anna
1961 : Les Amours célèbres de Michel Boisrond, sketch : Les Comédiennes : Mlle Duchesnois
1961 : Le Rendez-vous de Jean Delannoy : Madeleine
1961 : Le Bateau d'Émile (Le Homard flambé) de Denys de La Patellière : Fernande
1961 : Le crime ne paie pas de Gérard Oury, sketch : L'Affaire Fenayrou : Gabrielle Fenayrou
1961 : 21, rue Blanche de Quinto Albicocco : la narratrice du film
1962 : Smog de Franco Rossi
1962 : Le Vice et la vertu de Roger Vadim : Juliette Morand, « le vice »
1962 : Pourquoi Paris ? de Denys de La Patellière
1963 : Le Jour le plus court (Il giorno piu corto) de Bruno Corbucci (inédit) : L'infirmière
1963 : Les Camarades (I compagni) de Mario Monicelli : Niobe
1963 : Les hors la loi du mariage (I Fuorilegge del matrimonio) des frères Taviani et Valentino Orsini : Margherita
1963 : Le Mari de la femme à barbe (La donna scimmia) de Marco Ferreri : Maria
1963 : L'Autre Femme de François Villiers : Agnès Denis
1964 : La Bonne Soupe de Robert Thomas : Marie-Paule (2)
1964 : La Ragazza in prestito d'Alfredo Giannetti
1964 : Un monsieur de compagnie de Philippe de Broca : Clara
1964 : Ah ! Les belles familles (Le belle famiglie) de Ugo Gregoretti, sketch : Il principe d'azzuro : Maria
1964 : Une volonté de mourir (Una voglia da morire) de Duccio Tessari
1964 : Déclic...et des claques (L'Esbroufe) de Philippe Clair : Sandra
1965 : Guerre secrète (The Dirty Game), sketch de Christian-Jaque : Monique
1965 : Trois chambres à Manhattan de Marcel Carné : Kay Larsi
1965 : Une femme disponible (La ragazza in prestito) d' Alfredo Giannetti : Clara
1966 : Les Sorcières (Le streghe) de Luchino Visconti, sketch : La Sorcière brûlée vive (La strega bruciata viva) : Valeria
1967 : Vivre pour vivre de Claude Lelouch : Catherine Collonbs
1967 : Le Journaliste (Zhurnalist) de Serguei Guerassimov
1968 : Les Gauloises bleues de Michel Cournot : La mère
1968 : Une histoire de femme (Story of a woman/Storia di una donna) de Leonardo Bercovici : Liliana
1968 : La Bande à Bonnot de Philippe Fourastié : Marie, la Belge
1968 : Il pleut dans mon village (Bice skoro propast sveta) d' Aleksandar Petrovic
1968 : Disons, un soir à dîner (Metti una sera a cena) de Giuseppe Patroni Griffi : Giovanna
1969 : Erotissimo de Gérard Pirès : Annie
1969 : La Vie, l'Amour, la Mort de Claude Lelouch : Juste une apparition
1969 : La Semence de l'homme (Il seme dell'uomo) de Marco Ferreri : La femme étrangère
1969 : Un homme qui me plaît de Claude Lelouch : Françoise
1969 : Clair de Terre de Guy Gilles : Maria
1969 : Dillinger est mort (Dillinger è morto) de Marco Ferreri : La fille
1970 : Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas mais elle cause de Michel Audiard : Germaine
1970 : Les Novices de Guy Casaril : Mona-Lisa, la prostituée
1971 : Mourir d'aimer d'André Cayatte : Danièle Guénot
1971 : La Mandarine d'Edouard Molinaro : Séverine
1972 : La Vieille Fille de Jean-Pierre Blanc : Muriel Bouchon
1972 : Les Feux de la Chandeleur de Serge Korber : Marie-Louise
1972 : Traitement de choc d'Alain Jessua : Hélène Masson
1972 : Il n'y a pas de fumée sans feu d'André Cayatte : Sylvie Peyrac
Je dois m’excuser à nouveau, chers lecteurs, de n’avoir pas le temps de vous parler comme il se doit des derniers films en compétition découverts ce week end et de mes dernières péripéties, la fièvre (malheureusement pas seulement créatrice ou cinématographique) due à une météo capricieuse et versatile ayant quelque peu modifié mon planning, alors que, ce soir, déjà, se clôturera cette belle parenthèse cinématographique (que de beaux films encore cette année mais tellement divers que ce sera sans doute très compliqué de les départager pour le jury présidé par Steven Spielberg) et alors que, hier soir, avait lieu la projection en version restaurée de « Plein soleil » de René Clément, en présence d’Alain Delon, bouleversé et bouleversant, là pour rendre hommage à son "maître absolu", René Clément (je vous reparlerai, bien entendu, de ce beau moment !). A cette occasion, vous pouvez retrouver, ici, ma critique de ce chef d’œuvre ainsi qu’un dossier spécial Alain Delon avec 9 critiques de films avec ce dernier. Revenons tout d’abord à la journée d’avant-hier qui fut l’occasion de rattraper « Nebraska » d’Alexander Payne, l’histoire d’un vieil homme persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par correspondance, qui cherche à rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain. Sa famille, inquiète de ce qu’elle perçoit comme un début de sénilité, envisage de le placer en maison de retraite, mais un de ses deux fils se décide à l’emmener en voiture pour récupérer ce chèque auquel personne ne croit. En chemin, le père se blesse les obligeant à s’arrêter quelques jours dans sa petite ville natale du Nebraska. Épaulé par son fils, le vieil homme retrouve tout son passé. Sur un ton doux amer et avec une tendre cruauté, Alexander Payne prend le prétexte de cet improbable gain pour faire revenir le vieil homme, aussi bourru qu’attendrissant, sur les traces de sa jeunesse, un retour dans le passé filmé avec un noir et blanc d’une intemporelle nostalgie. C’est aussi le prétexte à la découverte d’une classe moyenne américaine, décrite avec ironie et causticité. C’est encore le prétexte pour filmer de splendides paysages déserts aussi arides que les cœurs de ceux qui y vivent, en apparence seulement pour certains. En chemin, le vieil homme perdra un dentier, engloutira quelques bières, retrouvera quelques vieilles connaissances et surtout apprendra à connaître son fils tandis que ce dernier, au cours de ce voyage dans le passé, découvrira des éléments du passé de son père qui permettront d’en dresser un portrait moins médiocre que celui qu’en font les autres membres de la famille. Un film teinté de la cruelle nostalgie de la jeunesse à jamais perdue et de la tendresse d’un fils pour son père ( père et fils entre lesquels les rôles s’inversent d’ailleurs, une inversion des rôles intelligemment mise en scène), et qui est, malgré ses défauts, à l’image de ce père: attachant. Un “petit” film, avec une photographie d’une splendide mélancolie, qui met joliment en scène l’amour filial (très belle scène de fin) et donne envie de profiter de ces instants inestimables en famille et d’étreindre ceux qui nous entourent et que nous aimons. Bruce Dern est parfait dans le rôle de ce vieux bougon sans doute moins sénile qu’il n’y parait. Avant-hier fut aussi projeté, également en compétition officielle, “The Immigrant” de James Gray décidément à l’honneur cette année puisqu’il est aussi le coscénariste de « Blood ties » réalisé par Guillaume Canet (dont je vous reparlerai également). On a du mal à croire qu’il s’agit ( seulement) du cinquième long-métrage du cinéaste américain ( après “Little Odessa”, “The Yards”, “La Nuit nous appartient”, “Two lovers”) tant chacun de ses films précédents était déjà maîtrisé, et James Gray comptant, déjà, comme un des plus grands cinéastes américains contemporains. “The Immigrant” a apparemment déçu bon nombre de ses admirateurs alors que, au contraire, c’est à mon sens son film le plus abouti, derrière son apparente simplicité. Il s’agit en effet de son film le plus sobre, intimiste et épuré mais quelle maîtrise dans cette épure et sobriété! On y retrouve les thèmes chers au cinéaste: l’empreinte de la Russie, l’importance du lien fraternel, le pardon mais c’est aussi son film le plus personnel puisque sa famille d’origine russe est arrivée à Ellis Island, où débute l’histoire, en 1923. L’histoire est centrée sur le personnage féminin de Ewa interprétée par Marion Cotillard. 1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée d’Orlando (Jeremy Renner), illusionniste et cousin de Bruno (Joaquin Phoenix), lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur la jalousie de Bruno... James Gray a écrit le rôle en pensant à Marion Cotillard (très juste et qui mériterait un prix d’interprétation même si la concurrence est rude notamment avec les actrices de « La vie d’Adèle » ou encore Bérénice Bejo ou Emmanuelle Seigner) qui ressemble ici à une actrice du temps du cinéma muet, au visage triste et expressif. « The Immigrant » est ainsi un mélo assumé qui repose sur le sacrifice de son héroïne qui va devoir accomplir un véritable chemin de croix pour (peut-être…) accéder à la liberté et faire libérer sa sœur. Les personnages masculins, les deux cousins ennemis, sont en arrière-plan, notamment Orlando. Quant à Bruno interprété par l’acteur fétiche de James Gray Joaquin Phoenix, c’est un personnage complexe et mystérieux qui prendra toute son ampleur au dénouement et montrera aussi à quel point le cinéma de James Gray derrière un apparent manichéisme est particulièrement nuancé et subtil. Le tout est sublimé par la photographie de Darius Khondji (qui avait d’ailleurs signé la photographie de la palme d’or du Festival de Cannes 2012, “Amour” de Michael Haneke) grâce à laquelle certains plans sont d’une beauté mystique à couper le souffle. James Gray a par ailleurs tourné à Ellis Island, sur les lieux où des millions d’immigrés ont débarqué de 1892 à 1924, leur rendant hommage et, ainsi, à ceux qui se battent, aujourd’hui encore, pour fuir des conditions de vie difficile, au péril de leur vie. C’est de dos qu’apparaît pour eux la statue de la liberté au début du film. C’est en effet la face sombre de cette liberté qu’ils vont découvrir, James Gray ne nous laissant d’ailleurs presque jamais entrevoir la lumière du jour. Si le film est situé dans les années 1920, il n’en est pas moins intemporel et universel. Une universalité et intemporalité qui (pourquoi pas ?) pourraient lui permettre d’accéder à la palme d’or, en plus de ses très nombreuses qualités visuelles. Tout comme dans « La Nuit nous appartient » qui en apparence opposait les bons et les méchants, l’ordre et le désordre, la loi et l’illégalité, et semblait au départ très manichéen, dans lequel le personnage principal était écartelé, allait évoluer, passer de l’ombre à la lumière, ou plutôt d’un univers obscur où régnait la lumière à un univers normalement plus lumineux dominé par des couleurs sombres, ici aussi le personnage de Bruno au cœur qui a « le goût du poison », incarne toute cette complexité, et le film baigné principalement dans des couleurs sombres, ira vers la lumière. Un plan, magistral, qui montre son visage à demi dans la pénombre sur laquelle la lumière l’emporte peu à peu, tandis qu’Ewa se confesse, est ici aussi prémonitoire de l’évolution du personnage. L’intérêt de « Two lovers » provenait avant tout des personnages, de leurs contradictions, de leurs faiblesses. C’est aussi le cas ici même si le thème du film et la photographie apportent encore une dimension supplémentaire. James Gray s’est inspiré des photos quadrichromes du début du XXe siècle, des tableaux qui mettent en scène le monde interlope des théâtres de variétés de Manhattan. Il cite aussi comme référence le Journal d’un curé de campagne, de Robert Bresson. James Gray parvient, comme avec « Two lovers », à faire d’une histoire a priori simple un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante et lancinante qui nous envahit peu à peu et dont la force ravageuse explose au dernier plan et qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin. Longtemps après, en effet, j’ai été éblouie par la noirceur de ce film, une noirceur de laquelle émerge une lueur de clarté sublimée par une admirable simplicité et maitrise des contrastes sans parler du dernier plan, somptueux, qui résume toute la richesse et la dualité du cinéma de James Gray et de ce film en particulier. Je n’ai pas le temps de vous parler de la splendide mise en abyme de Roman Polanski, « La Vénus à la fourrure » ni du film de Guillaume Gallienne « Les garçons et Guillaume, à table !» récompensé à la Quinzaine des Réalisateurs ou d’autres films encore comme « Grigris » de Mahamat-Saleh Haroun. Je le ferai au retour Je vous laisse avec quelques images de la soirée dans les coulisses du Grand Journal de Canal plus, avec le concert des BB Brunes. J’espère, dans l’après-midi, avoir le temps de vous livrer mes pronostics. En attendant, je vais rattraper « La vie d’Adèle » de Kechiche dont le nom revient très souvent pour une palme d’or même si, pour l’heure, mes coups de cœur demeurent « The immigrant » et « La Grande Bellezza » de Paolo Sorrentino. A l'occasion des 80 ans d'Alain Delon, hier, je vous proposais 9 critiques de ses films, à retrouver en cliquant ici, en tête desquelles se trouvait le chef d'œuvre de Losey, Monsieur Klein, à ne surtout pas manquer, ce soir. A chaque projection ce film me terrasse littéralement tant ce chef d'œuvre est bouleversant, polysémique, riche, brillant, nécessaire. Sans doute la démonstration cinématographique la plus brillante de l'ignominie ordinaire et de l'absurdité d'une guerre aujourd'hui encore partiellement insondables. A chaque projection, je le vois et l'appréhende différemment. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et que j'espère convaincre d'y remédier par cet article, récapitulons d'abord brièvement l'intrigue. Il s'agit de Robert Klein. Le monsieur Klein du titre éponyme. Enfin un des deux Monsieur Klein du titre éponyme. Ce Monsieur Klein-là, interprété par Alain Delon, voit dans l'Occupation avant tout une occasion de s'enrichir et de racheter à bas prix des œuvres d'art à ceux qui doivent fuir ou se cacher, comme cet homme juif (Jean Bouise) à qui il rachète une œuvre du peintre hollandais Van Ostade. Le même jour, il reçoit le journal « Informations juives » adressé à son nom, un journal normalement uniquement délivré sur abonnement. Ces abonnements étant soumis à la préfecture et M.Klein allant lui-même signaler cette erreur, de victime, il devient suspect... Il commence alors à mener l'enquête et découvre que son homonyme a visiblement délibérément usé de la confusion entre leurs identités pour disparaître... La première scène, d'emblée, nous glace d'effroi par son caractère ignoble et humiliant pour celle qui la subit. Une femme entièrement nue est examinée comme un animal par un médecin et son assistante afin d'établir ou récuser sa judéité. Y succède une scène dans laquelle, avec la même indifférence, M.Klein rachète un tableau à un juif obligé de s'en séparer. M.Klein examine l'œuvre avec plus de tact que l'était cette femme humiliée dans la scène précédente, réduite à un état inférieur à celui de chose mais il n'a pas plus d'égard pour son propriétaire que le médecin en avait envers cette femme même s'il respecte son souhait de ne pas donner son adresse, tout en ignorant peut-être la véritable raison de sa dissimulation affirmant ainsi avec une effroyable et sans doute inconsciente effronterie « bien souvent je préfèrerais ne pas acheter ». Au plan des dents de cette femme observées comme celles d'un animal s'oppose le plan de l'amie de M.Klein, Jeanine (Juliet Berto) qui se maquille les lèvres dans une salle de bain outrageusement luxueuse. A la froideur clinique du cabinet du médecin s'oppose le luxe tapageur de l'appartement de M.Klein qui y déambule avec arrogance et désinvolture, recevant ses invités dans une robe de chambre dorée. Il collectionne. Les œuvres d'art même s'il dit que c'est avant tout son travail. Les femmes aussi apparemment. Collectionner n'est-ce pas déjà une négation de l'identité, cruelle ironie du destin alors que lui-même n'aura ensuite de cesse de prouver et retrouver la sienne ? Cet homonyme veut-il lui sauver sa vie ? Le provoquer ? Se venger ? M.Klein se retrouve alors plongé en pleine absurdité kafkaïenne où son identité même est incertaine. Cette identité pour laquelle les Juifs sont persécutés, ce qui, jusque-là, l'indifférait prodigieusement et même l'arrangeait plutôt, ou en tout cas arrangeait ses affaires. Losey n'a pas son pareil pour utiliser des cadrages qui instaurent le malaise, instillent de l'étrangeté dans des scènes a priori banales dont l'atmosphère inquiétante est renforcée par une lumière grisâtre mettent en ombre des êtres fantomatiques, le tout exacerbé par une musique savamment dissonante... Sa caméra surplombe ces scènes comme un démiurge démoniaque : celui qui manipule M.Klein ou celui qui dicte les lois ignominieuses de cette guerre absurde. La scène du château en est un exemple, il y retrouve une femme, apparemment la maîtresse de l'autre M.Klein (Jeanne Moreau, délicieusement inquiétante, troublante et mystérieuse) qui y avait rendez-vous. Et alors que M.Klein-Delon lui demande l'adresse de l'autre M.Klein, le manipulateur, sa maîtresse lui donne sa propre adresse, renforçant la confusion et la sensation d'absurdité. Changement de scène. Nous ne voyons pas la réaction de M.Klein. Cette brillante ellipse ne fait que renforcer la sensation de malaise. Le malentendu (volontairement initié ou non ) sur son identité va amener Klein à faire face à cette réalité qui l'indifférait. Démonstration par l'absurde auquel il est confronté de cette situation historique elle-même absurde dont il profitait jusqu'alors. Lui dont le père lui dit qu'il est « français et catholique depuis Louis XIV», lui qui se dit « un bon français qui croit dans les institutions ». M.Klein est donc certes un homme en quête d'identité mais surtout un homme qui va être amené à voir ce qu'il se refusait d'admettre et qui l'indifférait parce qu'il n'était pas personnellement touché : « je ne discute pas la loi mais elle ne me concerne pas ». Lui qui faisait partie de ces « Français trop polis ». Lui qui croyait que « la police française ne ferait jamais ça» mais qui clame surtout : « Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Peu lui importait ce que faisait la police française tant que cela ne le concernait pas. La conscience succède à l'indifférence. Le vide succède à l'opulence. La solitude succède à la compagnie flatteuse de ses « amis ». Il se retrouve dans une situation aux frontières du fantastique à l'image de ce que vivent alors quotidiennement les Juifs. Le calvaire absurde d'un homme pour illustrer celui de millions d'autres. Et il faut le jeu tout en nuances de Delon, presque méconnaissable, perdu et s'enfonçant dans le gouffre insoluble de cette quête d'identité pour nous rendre ce personnage sympathique, ce vautour qui porte malheur et qui « transpercé d'une flèche, continue à voler ». Ce vautour auquel il est comparé et qui éprouve du remords, peut-être, enfin. Une scène dans un cabaret le laisse entendre. Un homme juif y est caricaturé comme cupide au point de voler la mort et faisant dire à son interprète : « je vais faire ce qu'il devrait faire, partir avant que vous me foutiez à la porte ». La salle rit aux éclats. La compagne de M.Klein, Jeanine, est choquée par ses applaudissements. Il réalise alors, apparemment, ce que cette scène avait d'insultante, bête et méprisante et ils finiront par partir. Dans une autre scène, il forcera la femme de son avocat à jouer l'International alors que le contenu de son appartement est saisi par la police, mais il faut davantage sans doute y voir là une volonté de se réapproprier l'espace et de se venger de celle-ci qu'un véritable esprit de résistance. Enfin, alors que tous ses objets sont saisis, il insistera pour garder le tableau de Van Ostade, son dernier compagnon d'infortune et peut-être la marque de son remords qui le rattache à cet autre qu'il avait tellement méprisé, voire nié et que la négation de sa propre identité le fait enfin considérer. Le jeu des autres acteurs, savamment trouble, laisse ainsi entendre que chacun complote ou pourrait être complice de cette machination, le père de M.Klein (Louis Seigner) lui-même ne paraissant pas sincère quand il dit « ne pas connaître d'autre Robert Klein », de même que son avocat (Michael Lonsdale) ou la femme de celui-ci (Francine Bergé) qui auraient des raisons de se venger, son avocat le traitant même de « minus », parfaite incarnation des Français de cette époque au rôle trouble, à l'indifférence coupable, à la lâcheté méprisable, au silence hypocrite. Remords ? Conviction de supériorité ? Amour de liberté ? Volonté de partager le sort de ceux dont il épouse alors jusqu'au bout l'identité ? Homme égoïste poussé par la folie de la volonté de savoir ? Toujours est-il que, en juillet 1942, il se retrouve victime de la Raflé du Vel d'Hiv avec 15000 autres juifs parisiens. Alors que son avocat possédait le certificat pouvant le sauver, il se laisse délibérément emporter dans le wagon en route pour Auschwitz avec, derrière lui, l'homme à qui il avait racheté le tableau et, dans sa tête, résonne alors le prix qu'il avait vulgairement marchandé pour son tableau. Scène édifiante, bouleversante, tragiquement cynique. Pour moi un des dénouements les plus poignants de l'Histoire du cinéma. Celui qui, en tout cas, à chaque fois, invariablement, me bouleverse. La démonstration est glaciale, implacable. Celle de la perte et de la quête d'identité poussées à leur paroxysme. Celle de la cruauté dont il fut le complice peut-être inconscient et dont il est désormais la victime. Celle de l'inhumanité, de son effroyable absurdité. Celle de gens ordinaire qui ont agi plus par lâcheté, indifférence que conviction. Losey montre ainsi froidement et brillamment une triste réalité française de cette époque, un pan de l'Histoire et de la responsabilité française qu'on a longtemps préféré ignorer et même nier. Sans doute cela explique-t-il que « Monsieur Klein » soit reparti bredouille du Festival de Cannes 1976 pour lequel le film et Delon, respectivement pour la palme d'or et le prix d'interprétation, partaient pourtant favoris. En compensation, il reçut les César du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleurs décors. Ironie là aussi de l'histoire (après celle de l'Histoire), on a reproché à Losey de faire, à l'image de Monsieur Klein, un profit malsain de l'art en utilisant cette histoire mais je crois que le film lui-même est une réponse à cette accusation (elle aussi) absurde. A la fois thriller sombre, dérangeant, fascinant, passionnant ; quête de conscience et d'identité d'un homme ; mise en ombres et en lumières des atrocités absurdes commises par le régime de Vichy et de l'inhumanité des français ordinaires ; implacable et saisissante démonstration de ce que fut la barbarie démente et ordinaire, « Monsieur Klein » est un chef d'œuvre aux interprétations multiples que la brillante mise en scène de Losey sublime et dont elle fait résonner le sens et la révoltante et à jamais inconcevable tragédie ... des décennies après. A voir et à revoir. Pour ne jamais oublier... L'ouverture de la rétrospective Joseph Losey à la Cinémathèque Française, demain, 6 janvier 2022, à 20H, avec Monsieur Klein me donne l'occasion de vous parler à nouveau de ce chef-d'œuvre à (re)voir absolument. Retrouvez le programme complet de la rétrospective, ici. Retrouvez ma critique du film ci-dessous mais aussi mon récit de la remise de la palme d'or d'honneur à Alain Delon, là, lors du Festival de Cannes 2019. A chaque projection ce film me terrasse littéralement tant ce chef-d'œuvre est bouleversant, polysémique, riche, nécessaire. Sans doute la démonstration cinématographique la plus brillante de l'ignominie ordinaire et de l'absurdité d'une guerre aujourd'hui encore partiellement insondables. A chaque projection, je le vois et l'appréhende différemment. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore et que j'espère convaincre d'y remédier par cet article, récapitulons d'abord brièvement l'intrigue. Il s'agit de Robert Klein. Le monsieur Klein du titre éponyme. Enfin un des deux Monsieur Klein du titre éponyme. Ce Monsieur Klein, interprété par Alain Delon, voit dans l'Occupation avant tout une occasion de s'enrichir et de racheter à bas prix des œuvres d'art à ceux qui doivent fuir ou se cacher, comme cet homme juif (Jean Bouise) à qui il rachète une œuvre du peintre hollandais Van Ostade. Le même jour, il reçoit le journal Informations juives adressé à son nom, un journal normalement uniquement délivré sur abonnement. Ces abonnements étant soumis à la préfecture et Monsieur Klein allant lui-même signaler cette erreur, de victime il devient suspect. Il commence alors à mener l'enquête et découvre que son homonyme a visiblement délibérément usé de la confusion entre leurs identités pour disparaître. La première scène, d'emblée, nous glace d'effroi par son caractère ignoble et humiliant pour celle qui la subit. Une femme entièrement nue est examinée comme un animal par un médecin et son assistante afin d'établir ou récuser sa judéité. Y succède une scène dans laquelle, avec la même indifférence, Monsieur Klein rachète un tableau à un juif obligé de s'en séparer. Monsieur Klein examine l'œuvre avec plus de tact que l'était cette femme humiliée dans la scène précédente, réduite à un état inférieur à celui de chose mais il n'a pas plus d'égards pour son propriétaire que le médecin en avait envers cette femme même s'il respecte son souhait de ne pas donner son adresse, tout en ignorant peut-être la véritable raison de sa dissimulation affirmant ainsi avec une effroyable (et sans doute inconsciente) effronterie : « bien souvent je préfèrerais ne pas acheter ». Au plan des dents de cette femme observées comme celles d'un animal s'oppose le plan de l'amie de Monsieur Klein, Jeanine (Juliet Berto) qui se maquille les lèvres dans une salle de bain outrageusement luxueuse. A la froideur clinique du cabinet du médecin s'oppose le luxe tapageur de l'appartement de Klein qui y déambule avec arrogance et désinvolture, recevant ses invités dans une robe de chambre dorée. Il collectionne. Les œuvres d'art même s'il dit que c'est avant tout son travail. Les femmes aussi apparemment. Collectionner, n'est-ce pas déjà une négation de l'identité ? Cruelle ironie du destin alors que lui-même n'aura ensuite de cesse de prouver et retrouver la sienne. Cet homonyme veut-il lui sauver sa vie ? Le provoquer ? Se venger ? Klein se retrouve alors plongé en pleine absurdité kafkaïenne où son identité même est incertaine. Cette identité pour laquelle les Juifs sont persécutés, ce qui, jusque-là, l'indifférait prodigieusement et même l'arrangeait plutôt, ou en tout cas arrangeait ses affaires. Losey n'a pas son pareil pour utiliser des cadrages qui instaurent le malaise, instillent de l'étrangeté dans des scènes a priori banales dont l'atmosphère inquiétante est renforcée par une lumière grisâtre (direction de la photographie signée Gerry Fisher) mettent en ombre des êtres fantomatiques, le tout exacerbé par une musique savamment dissonante ( de Egisto Macchi et Pierre Porte). Sa caméra surplombe ces scènes comme un démiurge démoniaque : celui qui manipule Klein ou celui qui dicte les lois ignominieuses de cette guerre absurde. La scène du château en est un exemple, il y retrouve une femme, apparemment la maîtresse de l'autre Monsieur Klein (Jeanne Moreau, délicieusement inquiétante, troublante et mystérieuse) qui y avait rendez-vous. Et alors que Klein-Delon lui demande l'adresse de l'autre Klein, le manipulateur, sa maîtresse lui donne sa propre adresse, renforçant la confusion et la sensation d'absurdité. Changement de scène. Nous ne voyons pas la réaction de Klein. Cette brillante ellipse ne fait que renforcer la sensation de malaise. Le malentendu (volontairement initié ou non ) sur son identité va amener Klein à faire face à cette réalité qui l'indifférait. Démonstration par l'absurde auquel il est confronté de cette situation historique elle-même absurde dont il profitait jusqu'alors. Lui dont le père lui dit qu'il est « français et catholique depuis Louis XIV», lui qui se dit « un bon français qui croit dans les institutions ». Klein est donc certes un homme en quête d'identité mais surtout un homme qui va être amené à voir ce qu'il se refusait d'admettre et qui l'indifférait parce qu'il n'était pas personnellement touché : « je ne discute pas la loi mais elle ne me concerne pas ». Lui qui faisait partie de ces « Français trop polis ». Lui qui croyait que « la police française ne ferait jamais ça» mais qui clame surtout : « Je n'ai rien à voir avec tout ça. » Peu lui importait ce que faisait la police française tant que cela ne le concernait pas. La conscience succède à l'indifférence. Le vide succède à l'opulence. La solitude succède à la compagnie flatteuse de ses « amis ». Il se retrouve dans une situation aux frontières du fantastique à l'image de ce que vivent alors quotidiennement les Juifs. Le calvaire absurde d'un homme pour illustrer celui de millions d'autres. Et il faut le jeu tout en nuances de Delon, presque méconnaissable, perdu et s'enfonçant dans le gouffre insoluble de cette quête d'identité pour nous rendre ce personnage sympathique, ce vautour qui porte malheur et qui « transpercé d'une flèche, continue à voler ». Ce vautour auquel il est comparé et qui éprouve du remords, peut-être, enfin. Une scène dans un cabaret le laisse entendre. Un homme juif y est caricaturé comme cupide au point de voler la mort et faisant dire à son interprète : « je vais faire ce qu'il devrait faire, partir avant que vous me foutiez à la porte ». La salle rit aux éclats. La compagne de Klein, Jeanine, est choquée par ses applaudissements. Il réalise alors, apparemment, ce que cette scène avait d'insultante, bête et méprisante et ils finiront par partir. Dans une autre scène, il forcera la femme de son avocat à jouer l'International alors que le contenu de son appartement est saisi par la police, mais il faut davantage sans doute y voir là une volonté de se réapproprier l'espace et de se venger de celle-ci qu'un véritable esprit de résistance. Enfin, alors que tous ses objets sont saisis, il insistera pour garder le tableau de Van Ostade, son dernier compagnon d'infortune et peut-être la marque de son remords qui le rattache à cet autre qu'il avait tellement méprisé, voire nié, et que la négation de sa propre identité le fait enfin considérer. Le jeu des autres acteurs, savamment trouble, laisse ainsi entendre que chacun complote ou pourrait être complice de cette machination, le père de Klein (Louis Seigner) lui-même ne paraissant pas sincère quand il dit « ne pas connaître d'autre Robert Klein », de même que son avocat (Michael Lonsdale) ou la femme de celui-ci (Francine Bergé) qui auraient des raisons de se venger, son avocat le traitant même de « minus », parfaite incarnation de ceux qui avaient à cette époque un rôle trouble, à l'indifférence coupable, à la lâcheté méprisable, au silence hypocrite. Remords ? Conviction de supériorité ? Amour de liberté ? Volonté de partager le sort de ceux dont il épouse alors jusqu'au bout l'identité ? Homme égoïste poussé par la folie de la volonté de savoir ? Toujours est-il que, en juillet 1942, il se retrouve victime de la Rafle du Vel d'Hiv avec 15000 autres juifs parisiens. Alors que son avocat possédait le certificat pouvant le sauver, il se laisse délibérément emporter dans le wagon en route pour Auschwitz avec, derrière lui, l'homme à qui il avait racheté le tableau et, dans sa tête, résonne alors le prix qu'il avait vulgairement marchandé pour son tableau. Scène édifiante, bouleversante, tragiquement cynique. Pour moi un des dénouements les plus poignants de l'Histoire du cinéma. Celui qui, en tout cas, à chaque fois, invariablement, me bouleverse. La démonstration est glaciale, implacable. Celle de la perte et de la quête d'identité poussées à leur paroxysme. Celle de la cruauté dont il fut le complice peut-être inconscient et dont il est désormais la victime. Celle de l'inhumanité, de son effroyable absurdité. Celle de gens ordinaire qui ont agi plus par lâcheté, indifférence que conviction. Losey montre ainsi froidement et brillamment une triste réalité française de cette époque, un pan de l'Histoire et de la responsabilité française qu'on a longtemps préféré ignorer et même nier. Sans doute cela explique-t-il que Monsieur Klein soit reparti bredouille du Festival de Cannes 1976 pour lequel le film et Delon, respectivement pour la palme d'or et le prix d'interprétation, partaient pourtant favoris. En compensation, il reçut les César du meilleur film, de la meilleure réalisation et des meilleurs décors. Ironie là aussi de l'histoire (après celle de l'Histoire), on a reproché à Losey de faire, à l'image de Monsieur Klein, un profit malsain de l'art en utilisant cette histoire mais je crois que le film lui-même est une réponse à cette accusation (elle aussi) absurde. A la fois thriller sombre, dérangeant, fascinant, passionnant, quête de conscience et d'identité d'un homme, mise en ombres et en lumières des atrocités absurdes commises par le régime de Vichy et de l'inhumanité des français ordinaires, implacable et saisissante démonstration de ce que fut la barbarie démente et banale, Monsieur Klein est un chef d'œuvre aux interprétations multiples que la brillante mise en scène de Losey sublime et dont elle fait résonner le sens et la révoltante et à jamais inconcevable tragédie, des décennies après. A voir et à revoir. Pour ne jamais oublier. Plus que jamais. Sur la route de Madison aurait alors pu être un mélodrame mièvre et sirupeux, à l’image du best-seller de Robert James Waller dont il est l’adaptation. Sur la route de Madison est tout sauf cela. Chaque plan, chaque mot, chaque geste suggèrent l’évidence de l’amour qui éclôt entre les deux personnages. Ils n’auraient pourtant jamais dû se rencontrer : elle a une quarantaine d’années et, des années auparavant, elle a quitté sa ville italienne de Bari et son métier de professeur pour se marier dans l’Iowa et y élever ses enfants. Elle n’a plus bougé depuis. A 50 ans, solitaire, il n’a jamais suivi que ses désirs, parcourant le monde au gré de ses photographies. Leurs chemins respectifs ne prendront pourtant réellement sens que sur cette route de Madison. Ce jour de 1965, ils n’ont plus d’âge, plus de passé, juste cette évidence qui s’impose à eux et à nous, transparaissant dans chaque seconde du film, par le talent du réalisateur Clint Eastwood. Francesca passe une main dans ses cheveux, jette un regard nostalgico-mélancolique vers la fenêtre alors que son mari et ses enfants mangent, sans lui parler, sans la regarder: on entrevoit déjà ses envies d’ailleurs, d’autre chose. Elle semble attendre Robert Kincaid avant même de savoir qu’il existe et qu’il viendra. Chaque geste, simplement et magnifiquement filmé, est empreint de poésie, de langueur mélancolique, des prémisses de leur passion inéluctable : la touchante maladresse avec laquelle Francesca indique son chemin à Robert; la jambe de Francesca frôlée furtivement par le bras de Robert; la main de Francesca caressant, d'un geste faussement machinal, le col de la chemise de Robert assis, de dos, tandis qu’elle répond au téléphone; la main de Robert qui, sans se retourner, se pose sur la sienne; Francesca qui observe Robert à la dérobée à travers les planches du pont de Roseman, puis quand il se rafraîchit à la fontaine de la cour; et c’est le glissement progressif vers le vertige irrésistible. Les esprits étriqués des habitants renforcent cette impression d’instants volés, sublimés. Francesca, pourtant, choisira de rester avec son mari très « correct » à côté duquel son existence sommeillait, plutôt que de partir avec cet homme libre qui « préfère le mystère » qui l’a réveillée, révélée, pour ne pas ternir, souiller, ces 4 jours par le remord d’avoir laissé une famille en proie aux ragots. Aussi parce que « les vieux rêves sont de beaux rêves, même s’ils ne se sont pas réalisés ». Et puis, ils se revoient une dernière fois, un jour de pluie, à travers la vitre embuée de leurs voitures respectives. Francesca attend son mari dans la voiture. Robert est dans la sienne. Il suffirait d’une seconde… Elle hésite. Trop tard, son mari revient dans la voiture et avec lui : la routine, la réalité, la raison. Puis, la voiture de Francesca et de son mari suit celle de Robert. Quelques secondes encore, le temps suspend son vol à nouveau, instant sublimement douloureux. Puis, la voiture s’éloigne. A jamais. Les souvenirs se cristalliseront au son du blues qu’ils écoutaient ensemble, qu’ils continueront à écouter chacun de leur côté, souvenir de ces instants immortels, d’ailleurs immortalisés des années plus tard par un album de photographies intitulé « Four days ». Avant que leurs cendres ne soient réunies à jamais du pont de Roseman. Avant que les enfants de Francesca ne réalisent son immense sacrifice. Et leur passivité. Et la médiocrité de leurs existences. Et leur envie d'exister, à leur tour. Son sacrifice en valait-il la peine ? Son amour aurait-il survécu au remord et au temps ?... Sans esbroufe, comme si les images s’étaient imposées à lui avec la même évidence que l’amour s’est imposé à ses protagonistes, Clint Eastwood filme simplement, majestueusement, la fugacité de cette évidence. Sans gros plan, sans insistance, avec simplicité, il nous fait croire aux« certitudes qui n’arrivent qu’une fois dans une vie » ou nous renforce dans notre croyance qu’elles peuvent exister, c'est selon. Peu importe quand. Un bel été de 1965 ou à un autre moment. Peu importe où. Dans un village perdu de l’Iowa ou ailleurs. Une sublime certitude. Une magnifique évidence. Celle d’une rencontre intemporelle et éphémère, fugace et éternelle. Un chef d’œuvre d’une poésie sensuelle et envoûtante. A voir absolument. Remarque: La pièce de James Waller dont est tiré le film sera reprise au théâtre Marigny, à Paris, en janvier 2007, et les deux rôles principaux seront repris par Alain Delon et Mireille Darc. Ce article est également publié sur Agoravox. Sandra.M Les Cinoches. Voilà l'adresse qui manquait à Saint-Germain-des-Prés! J'y suis retournée à maintes reprises depuis que je l'ai découverte au hasard de mes déambulations germanopratines. L'endroit n'a jamais démérité. Cuisine de qualité, accueil chaleureux, lieu moderne mais cosy, depuis son ouverture en septembre 2009, ce restaurant a su s'imposer comme une adresse incontournable du quartier. Contrairement à nombre d'endroits à la mode où la décoration est particulièrement soignée au détriment de la cuisine, ni l'un ni l'autre ne sont négligés et pour cause: aux commandes se trouve le chef Frédéric Calmels, ancien du Lancaster et second de la Tour d’Argent. Les plats sont aussi simples que délicieux, à des prix très abordables pour le quartier avec, notamment, un menu à 18€ pour le déjeuner mais aussi un brunch, le dimanche, pour 25€. La carte, toujours avec des produits frais de saison, varie fréquemment. Les bar des Cinoches vous accueille également avant et après les repas pour les noctambules. Depuis le 22 mars, les Cinoches ont également ouvert leur terrasse qui donne sur la rue de Condé, point stratégique pour observer la joyeuse comédie humaine germanopratine ou pour simplement se détendre (l'un n'empêchant pas l'autre me direz-vous). Quant à la décoration, à l'image de la carte, elle varie elle aussi avec régulièrement de nouvelles oeuvres aux murs pour le plus grand plaisir des esthètes, à l'exemple des photographies de Karl Lagerfeld. Cet endroit est d'autant plus incontournable pour moi qu'il s'agit d'une ancienne salle art et essai reconvertie en restaurant et que, comble du rêve pour une cinéphile gastronome, chaque dimanche soir, le restaurant devient ciné club et donc le rendez-vous des gastronomes, des cinéphiles...et des cinéastes. Vous pouvez suivre les films sur un fauteuil côté bar ou depuis le restaurant, aux premières loges juste sous l'écran si vous souhaitez écouter et regarder religeusement le film présenté, ou plus loin si votre attention se veut plus volatile. Je pense que vous aurez compris que je vous recommande les lieux sans réserves. J'ai donc le grand plaisir et l'honneur de faire la programmation de mon nouveau quartier général, à partir du 2 mai et cela pour 8 semaines. Il faut dire que Les Cinoches n'avaient pas besoin de moi pour avoir une excellente et judicieuse programmation, le maître des lieux étant aussi un grand cinéphile. Chaplin, Godard, Melville ...y ont ainsi été régulièrement projetés. A partir du 2 mai, je prends donc toutes les récriminations si la programmation ne vous satisfait pas et remercie au passage la direction de m'avoir laissé entière liberté quant au choix des films présentés.:-) J'ai tenu compte du fait que nous sommes au printemps en évitant les films trop sombres (dans tous les sens du terme)... Un film avec Alain Delon était pour moi évidemment incontournable ("La Piscine", "Le Samouraï", "Rocco et ses frères", "Borsalino", "Le Guépard", "Monsieur Klein", "Le Cercle rouge" - d'ailleurs déjà projeté aux Cinoches-...je n'avais que l'embarras du choix, j'ai donc choisi le plus estival: "Plein soleil" même si "La Piscine aurait également bien convenu). Un film de Claude Sautet était également pour moi inévitable, j'ai choisi le plus joyeux: "César et Rosalie" (même si "Un coeur en hiver" reste pour moi le meilleur) . Je vous reparlerai plus en détails de la programmation tout au long des semaines à venir et les critiques des films présentés manquantes viendront s'ajouter à celles figurant déjà sur le blog. Voici donc les films qui seront projetés à partir du 2 mai, chaque dimanche, à 21H. Vous pouvez accéder à la page du ciné club en cliquant ici. Vous pouvez lire mes critiques ou commentaires sur le film concerné en cliquant sur son titre avec, dans l'ordre de leurs dates de programmation: "Les Enchaînés" d'Alfred Hitchcock (1946)Festival de Cannes 2013 – Compte-rendu n°5 – « The Immigrant » de James Gray, « Nebraska » d’Alexander Payne et coulisse









Critique de MONSIEUR KLEIN de Joseph Losey à 21h sur TV5 Monde ce 9 novembre 2015
Rétrospective Losey à la Cinémathèque Française : ”Monsieur Klein” en ouverture le 6.01.2022

”Sur la route de Madison” de Clint Eastwood (1995), la beauté de la fugacité éternelle
 L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.
L’éphémère peut avoir des accents d’éternité, quatre jours, quelques heures peuvent changer, illuminer et sublimer une vie. Du moins, Francesca Johnson (Meryl Streep) et Robert Kincaid (Clint Eastwood) le croient-il et le spectateur aussi, forcément, inévitablement, après ce voyage bouleversant sur cette route de Madison qui nous emmène bien plus loin que sur ce chemin poussiéreux de l’Iowa. Caroline et son frère Michael Johnson reviennent dans la maison où ils ont grandi pour régler la succession de leur mère, Francesca. Mais quelle idée saugrenue a-t-elle donc eu de vouloir être incinérée et d’exiger de faire jeter ses cendres du pont de Roseman, au lieu d’être enterrée auprès de son défunt mari ? Pour qu’ils sachent enfin qui elle était réellement, pour qu’ils comprennent, elle leur a laissé une longue lettre qui les ramène de nombreuses années en arrière, un été de 1965… un matin d’été de 1965, de ces matins où la chaleur engourdit les pensées, et réveille parfois les regrets. Francesca est seule. Ses enfants et son mari sont partis pour un concours agricole, pour quatre jours, quatre jours qui s’écouleront probablement au rythme hypnotique et routinier de la vie de la ferme sauf qu’un photographe au National Geographic, Robert Kincaid, emprunte la route poussiéreuse pour venir demander son chemin. Sauf que, parfois, quatre jours peuvent devenir éternels.Inthemoodforcinema choisit la programmation du ciné club du restaurant Les Cinoches à partir du 2 mai