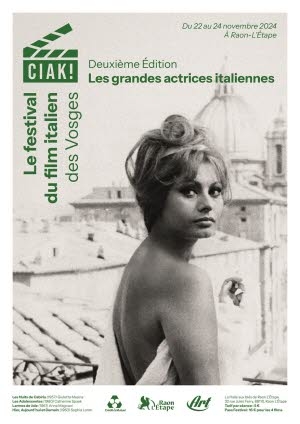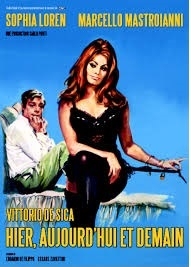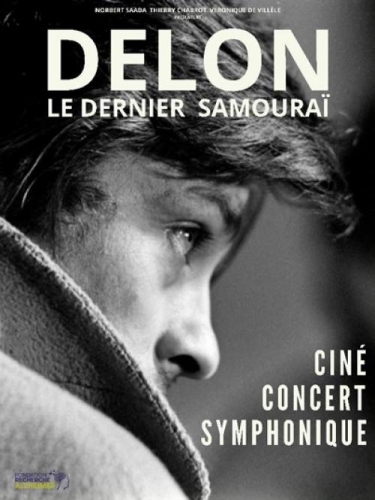Critique de LA PLUS PRÉCIEUSE DES MARCHANDISES de Michel Hazanavicius

Le film de Michel Hazanavicius, La Plus Précieuse Des Marchandises figurait parmi les films en compétition au Festival de Cannes 2024. Il fut aussi présenté en avant-première au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2024, et au Festival du Cinéma et Musique de La Baule 2024. Il fit également l’ouverture du Festival International du Film d’Annecy. À Cannes, il a remporté le prix du Cinéma positif, un prix qui récompensait ainsi son « engagement et son message sur des thématiques fortes, pleines d’espoir et d’humanité », permettant « au monde de réfléchir à un monde meilleur ».
L’an passé, avec son chef-d’œuvre La Zone d’intérêt, également présenté en compétition à Cannes mais aussi en avant-première dans le cadre du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2023, Jonathan Glazer prouvait d’une nouvelle manière, singulière, puissante, audacieuse et digne, qu’il est possible d’évoquer l’horreur sans la représenter frontalement, par des plans fixes, en nous en montrant le contrechamp, reflet terrifiant de la banalité du mal, non moins insoutenable, dont il signait ainsi une démonstration implacable, réunissant dans chaque plan deux mondes qui coexistent, l'un étant une insulte permanente à l’autre.
Avant lui, bien d’autres cinéastes avaient évoqué la Shoah : Claude Lanzmann (dont le documentaire, Shoah, reste l’incontournable témoignage sur le sujet, avec également le court-métrage d’Alain Resnais, Nuit et brouillard) qui écrivit ainsi : « L’Holocauste est d’abord unique en ceci qu’il édifie autour de lui, en un cercle de flammes, la limite à ne pas franchir parce qu’un certain absolu de l’horreur est intransmissible : prétendre pourtant le faire, c’est se rendre coupable de la transgression la plus grave. »
Autre approche que celle de La Liste de Schindler de Spielberg ( qui va à l'encontre même de la vision de Lanzmann) dont le scénario sans concessions au pathos de Steven Zaillian, la photographie entre expressionnisme et néoréalisme de Janusz Kaminski (splendides plans de Schindler partiellement dans la pénombre qui reflètent les paradoxes du personnage), l’interprétation de Liam Neeson, passionnant personnage, paradoxal, ambigu et humain à souhait, et face à lui, la folie de celui de Ralph Fiennes, la virtuosité et la précision de la mise en scène (qui ne cherche néanmoins jamais à éblouir mais dont la sobriété et la simplicité suffisent à retranscrire l’horrible réalité), la musique poignante de John Williams par laquelle il est absolument impossible de ne pas être ravagé d'émotions à chaque écoute (musique solennelle et austère qui sied au sujet avec ce violon qui larmoie, voix de ceux à qui on l’a ôtée, par le talent du violoniste israélien Itzhak Perlman, qui devient alors, aussi, le messager de l’espoir), et le message d’espérance malgré toute l’horreur en font un film bouleversant et magistral. Et cette petite fille en rouge que nous n'oublierons jamais, perdue, tentant d’échapper au massacre (vainement) et qui fait prendre conscience à Schindler de l’individualité de ces Juifs qui n’étaient alors pour lui qu’une main d’œuvre bon marché.
En 2015, avec Le Fils de Saul, László Nemes nous immergeait dans le quotidien d'un membre des Sonderkommandos, en octobre 1944, à Auschwitz-Birkenau.
Avec le plus controversé La vie est belle, Benigni avait lui opté pour le conte philosophique, la fable pour démontrer toute la tragique et monstrueuse absurdité à travers les yeux de l’enfance, de l’innocence, ceux de Giosué. Benigni ne cède pour autant à aucune facilité, son scénario et ses dialogues sont ciselés pour que chaque scène « comique » soit le masque et le révélateur de la tragédie qui se « joue ». Bien entendu, Benigni ne rit pas, et à aucun moment, de la Shoah mais utilise le rire, la seule arme qui lui reste, pour relater l’incroyable et terrible réalité et rendre l’inacceptable acceptable aux yeux de son enfant. Benigni cite ainsi Primo Levi dans Si c’est un homme qui décrit l’appel du matin dans le camp. « Tous les détenus sont nus, immobiles, et Levi regarde autour de lui en se disant : « Et si ce n’était qu’une blague, tout ça ne peut pas être vrai… ». C’est la question que se sont posés tous les survivants : comment cela a-t-il pu arriver ? ». Tout cela est tellement inconcevable, irréel, que la seule solution est de recourir à un rire libérateur qui en souligne l'absurdité. Le seul moyen de rester fidèle à la réalité, de toute façon intraduisible dans toute son indicible horreur, était donc, pour Benigni, de la styliser et non de recourir au réalisme. Quand il rentre au baraquement, épuisé, après une journée de travail, il dit à Giosué que c’était « à mourir de rire ». Giosué répète les horreurs qu’il entend à son père comme « ils vont faire de nous des boutons et du savon », des horreurs que seul un enfant pourrait croire mais qui ne peuvent que rendre un adulte incrédule devant tant d’imagination dans la barbarie (« Boutons, savons : tu gobes n’importe quoi ») et n’y trouver pour seule explication que la folie (« Ils sont fous »). Benigni recourt à plusieurs reprises intelligemment à l’ellipse comme lors du dénouement avec ce tir de mitraillette hors champ, brusque, violent, où la mort terrible d’un homme se résume à une besogne effectuée à la va-vite. Les paroles suivantes le « C’était vrai alors » lorsque Giosué voit apparaître le char résonne alors comme une ironie tragique. Et saisissante.
C’est aussi le genre du conte qu’a choisi Michel Hazanavicius, pour son premier film d’animation, qui évoque également cette période de l’Histoire, une adaptation du livre La Plus Précieuse Des Marchandises de Jean-Claude Grumberg. Le producteur Patrick Sobelman lui avait ainsi proposé d’adapter le roman avant même sa publication.
Le réalisateur a ainsi dessiné lui-même les images, particulièrement marquantes (chacune pourrait être un tableau tant les dessins sont magnifiques), il dit ainsi s’être nourri du travail de l’illustrateur Henri Rivière, l’une des figures majeures du japonisme en France. En résulte en effet un dessin particulièrement poétique, aux allures de gravures ou d’estampes.
Ainsi est résumé ce conte : Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron (voix de Grégory Gadebois) et une pauvre bûcheronne (voix de Dominique Blanc). Le froid, la faim, la misère, et partout autour d´eux la guerre, leur rendaient la vie bien difficile. Un jour, pauvre bûcheronne recueille un bébé. Un bébé jeté d’un des nombreux trains qui traversent sans cesse leur bois. Protégée quoi qu’il en coûte, ce bébé, cette petite marchandise va bouleverser la vie de cette femme, de son mari, et de tous ceux qui vont croiser son destin, jusqu’à l’homme qui l’a jeté du train.
Avant même l’horreur que le film raconte, ce qui marque d’abord, ce sont les voix, celle si singulière et veloutée de Jean-Louis Trintignant d’abord (ce fut la dernière apparition vocale de l’acteur décédé en juin 2022) qui résonne comme une douce mélopée murmurée à nos oreilles pour nous conter cette histoire dont il est le narrateur. Dans le rôle du « pauvre bûcheron », Grégory Gadebois, une fois de plus, est d’une justesse de ton remarquable, si bien que même longtemps après la projection son « Même les sans cœurs ont un cœur » (ainsi appellent-ils d’abord les Juifs, les « sans cœurs » avant de tomber fou d’amour pour ce bébé et de réaliser la folie et la bêtise de ce qu’il pensait jusqu’alors et avant d’en devenir le plus fervent défenseur, au péril de sa vie) résonne là aussi encore comme une litanie envoûtante et bouleversante.
Le but était ainsi que le film soit familial et n’effraie pas les enfants. Les images des camps sont donc inanimées, accompagnées de neige et de fumée, elles n’en sont pas moins parlantes, et malgré l’image figée elles s’insinuent en nous comme un cri d’effroi. Le but du réalisateur n’était néanmoins pas de se focaliser sur la mort et la guerre mais de rendre hommage aux Justes, de réaliser un film sur la vie, de montrer que la lumière pouvait vaincre l’obscurité. Un message qu’il fait plus que jamais du bien d’entendre.
Le film est accompagné par les notes d’Alexandre Desplat qui alternent entre deux atmosphères du conte : funèbre et féérique (tout comme dans le dessin et l’histoire, la lumière perce ainsi l’obscurité). S’y ajoutent deux chansons : La Berceuse (Schlof Zhe, Bidele), chant traditionnel yiddish, et Chiribim Chiribom, air traditionnel, interprétées par The Barry Sisters.
Michel Hazanavicius signe ainsi une histoire d’une grande humanité, universelle, réalisée avec délicatesse, pudeur et élégance sans pour autant masquer les horreurs de la Shoah. Les dessins d’une grande qualité, les sublimes voix qui narrent et jouent l’histoire, la richesse du texte, la musique qui l’accompagne en font un film absolument captivant, d’une grande douceur malgré l’âpreté du sujet et de certaines scènes. Un conte qui raconte une réalité historique. Une ode au courage, elle-même audacieuse. On n’en attendait pas moins de la part de celui qui avait osé réaliser des OSS désopilants, mais aussi The Artist, un film muet (ou quasiment puisqu’il y a quelques bruitages), en noir et blanc tourné à Hollywood, un film qui concentre magistralement la beauté simple et magique, poignante et foudroyante, du cinéma, comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable. Chacun de ses films prouve l’immense étendue du talent de Michel Hazanavicius qui excelle et nous conquiert avec chaque genre cinématographique, aussi différents soient-ils avec, toujours, pour point commun, l’audace.
Des années après Benigni, Hazanavicius a osé à son tour réaliser un conte sur la Shoah, qui est avant tout une ode à la vie, un magnifique hommage aux Justes, sobre et poignant, qui use intelligemment du hors champ pour nous raconter le meilleur et le pire des hommes, la générosité, le courage et la bonté sans limites (représentées aussi par cette Gueule cassée de la première guerre mondiale incarnée par la voix de Denis Podalydès) et la haine, la bêtise et la cruauté sans bornes, et qui nous laisse après la projection, bouleversés, avec, en tête, les voix de Grégory Gadebois et Jean-Louis Trintignant, mais aussi cette lumière victorieuse, le courage des Justes auquel ce film rend magnifiquement hommage et cette phrase, à l’image du film, d’une force poignante et d’une beauté renversante : « Voilà la seule chose qui mérite d’exister : l’amour. Le reste est silence ».