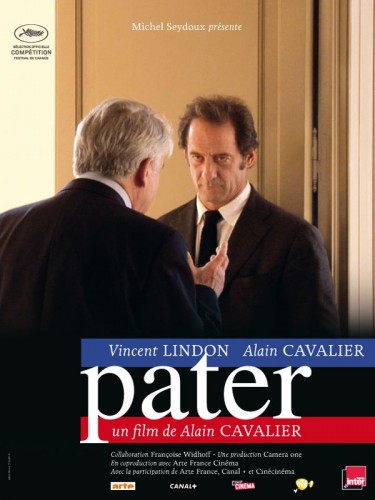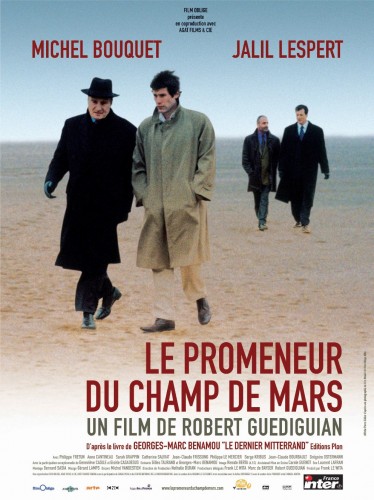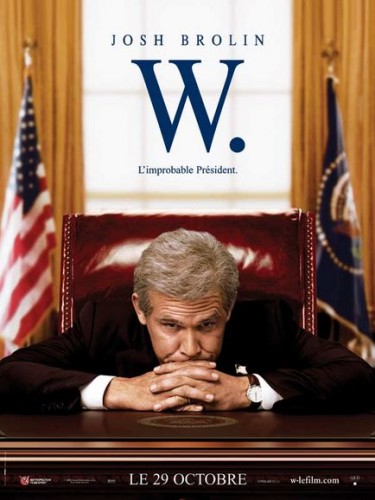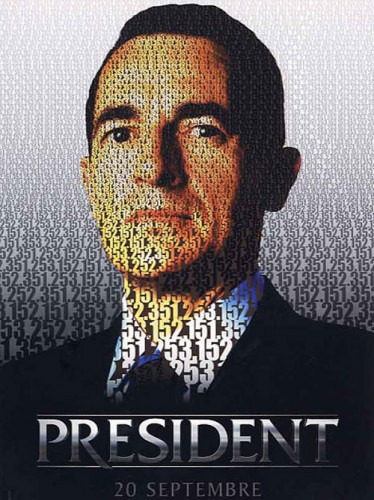A l'occasion de la Présidentielle 2012 et à J-7 du premier tour, comme je ne souhaite pas parler politique sur ce blog, je vais néanmoins célèbrer la campagne en vous proposant ci-dessous quelques critiques de films sur la politique déjà parues sur ce blog, des films "sur" la politique et non des films politiques car, d'une certaine manière, tous les films ou en tout cas une grande majorité pourraient répondre à cette seconde définition.
A l'occasion de la Présidentielle 2012 et à J-7 du premier tour, comme je ne souhaite pas parler politique sur ce blog, je vais néanmoins célèbrer la campagne en vous proposant ci-dessous quelques critiques de films sur la politique déjà parues sur ce blog, des films "sur" la politique et non des films politiques car, d'une certaine manière, tous les films ou en tout cas une grande majorité pourraient répondre à cette seconde définition.
Vous trouverez des films français et des films américains, de très bons films, surtout ("L'Exercice de l'Etat", "Le Promeneur du champ de mars" , "Les Marches du pouvoir"...), et un qui est tout le contraire de ce que doit être selon moi un film sur la politique ("Président"), des critiques récentes et d'autres publiées aux débuts de ce blog (pour lesquelles je réclame donc plus d'indulgence).
8 critiques et autant de visages de la politique. Bien entendu, il y en aurait tant d'autres : "Le Bon plaisir", "Les Hommes du Président", "Votez Mc Kay", "Le Juge Fayard dit le Shériff", "Le Président", tous les films ou presque de Costa Gavras etc.

Critique de "L'Exercice de l'Etat" de Pierre Schoeller

Hasard ou coïncidence : 2011 aura été l’année du retour des films politiques, à la veille d’une année riche en échéances électorales primordiales. Trois films et trois regards sur la politique. Trois films sélectionnés au dernier Festival de Cannes. « Pater » d’Alain Cavalier (en compétition) : une réflexion déroutante et ludique sur le jeu et les jeux de pouvoirs (entre un président de la République et son Premier ministre, entre deux hommes, entre un père et son fils, entre un réalisateur et un acteur mais aussi entre un réalisateur et le spectateur ici allègrement manipulé) qui, témoigne d’une belle audace et liberté. « La Conquête » de Xavier Durringer, présenté hors compétition, que je n’ai pas vu mais qui me semble tout de même être le contraire du premier, notamment en ce qu’il n’est pas une représentation mais une imitation. Et enfin « L’Exercice de l’Etat » de Pierre Schoeller, présenté dans la sélection Un Certain Regard, dont il est reparti lauréat du prix de la critique internationale.
Olivier Gourmet y incarne le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean. Réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet (Michel Blanc qui a reçu le César 2012, mérité, du meilleur second rôle) suite à un accident (un car avec des enfants a basculé dans un ravin), il n’a d’autre choix que de se rendre sur les lieux du carnage. C’est le début du parcours d’un homme qui apparaît d’abord guidé par ses convictions mais dans un Etat qui dévore ceux qui le servent, où une urgence et une actualité chassent l’autre, les idéaux sont mis à rude épreuve surtout quand on le choisit, lui, le défenseur du service public, pour réformer les gares et les privatiser.
Le film débute par une séquence onirique et inquiétante. Une femme se glisse languissamment dans la gueule d’un crocodile qui la dévore, sous les apparats d’un bureau ministériel. L’homme est un animal politique pétri de désirs et de pouvoir(s) qui dévore ce qu’il désire et ce qui l’entrave. Le ton est donné. Bertrand Saint-Jean est alors brusquement sorti de son rêve par son directeur de cabinet. L’actualité fracassante et tonitruante, l’actualité qui ne le lâchera plus le rattrape dans ses évasions nocturnes et prémonitoires.
Ce film a priori rugueux, qui ne cherche pas à être à tout prix sympathique (au contraire de celui dont il dresse le portrait, manière habile de nous dire ce que doit être la politique ?) est aussi palpitant qu’un thriller. Après tout, l’enjeu aussi est de sauver sa peau. Au prix de ses idéaux. De ses illusions. De la vie des autres.
Il fallait un acteur de la trempe d’Olivier Gourmet pour incarner ce rôle. Connu mais assez peu pour que sa personnalité ne parasite pas celle de son personnage. Homme politique complexe (pléonasme) tour à tour mécanique, humain, imbuvable, cynique, altruiste, égoïste, idéaliste, ambitieux et finalement surtout ambitieux, notre attention ne le quitte pas une seconde, partagée entre l’empathie, le rejet, l’incompréhension.
La tension est constante car la caméra traque ses faiblesses et ses sursauts d’humanité, nous fait suivre son parcours qui ne lui laisse, pas plus qu’à nous, aucun répit, guidé par une actualité et un Etat voraces.
Le film ne s’appelle pas (et à dessein) l’Exercice du pouvoir, mais de l’Etat car il s’agit d’ailleurs plutôt d’un renoncement au premier dévolu à d’autres entités (privé, économie, médias). Le manège qui l’entoure est alors essentiel et en partie responsable : des médias carnassiers, une chargée des communication qui lui dicte aussi bien sa cravate que ses réponses pour créer l’image de cet « objet non identifié », « flou » qui a une histoire à écrire pour un peuple, semble-t-il, avide d’histoires (par exemple celle d’un homme qui survit à un accident –dont il est d’ailleurs en partie responsable, ironie de l’histoire et de l’Histoire-) plus que de compétences. Le tout appuyé par une musique aux sonorités ironiques.
La réalisation, nerveuse, constamment sous tension, épouse son rythme de vie trépidant, tendu, grisant, vertigineux, périlleux, étouffant aussi. Le piège se referme comme une mâchoire de crocodile. L’obstacle auquel se retrouve confronté l’Exercice de l’Etat n’est pas tant une hiérarchie (quelle qu’elle soit) que l’ambition personnelle qui, forcément semble-t-on nous dire, dicte ses actes à l’homme politique, au mépris de ses convictions, de l’intérêt général, de la sécurité, de ses citoyens instrumentalisés (idée démagogique des chômeurs employés au service des ministères, fascinant personnage du chauffeur qui incarne ce citoyen silencieux partagé entre scepticisme, fascination, désapprobation) . Les choix s’imposent au ministre plus qu’il ne les impose : c’est cela l’Exercice de l’Etat, ici.
Dommage que la conclusion aboutisse à ce constat aux frontières poujadistes (d’autant qu’aucun homme ou parti politique n’est clairement identifiable, et ce qui en fait une qualité du film au début, contribue finalement à cet amer constat ) dont le film avait pourtant brillamment évité l’écueil (nous montrant au départ Saint-Jean dans toute son ambigüité, guidé par ses idéaux qu’il abandonne ensuite par ambition, tout comme il abandonnera son directeur de cabinet et ami lors d’une scène d’autant plus effroyablement cruelle qu’elle se déroule au calme, dans un cadre doré, avec sourires et politesses de rigueur) et surtout que son renoncement semble être la seule solution possible dans un monde politique décrit avec cynisme (« pas là pour refaire les mondes mais pour reprendre 5 points de sondage », qui « brasse du vent, n’a rien dans les mains, à part sa petite ambition »).
Brillant exercice de style ( avec un symbolisme parfois appuyé comme le début ou cette route que Saint-Jean remonte après son accident, comme tout homme politique qui « remonte la pente » parce que « ce qui ne [le] tue pas [le] rend plus fort »), démonstration implacable (mais contestable) du renoncement inéluctable à ses idéaux, de l’ambition dévorante et dévoreuse de l’homme (animal) politique. Le seul qui n’y renoncera pas (très beau personnage de Michel Blanc qui vaut une des plus belles scènes du film, lorsque celui-ci écoute le discours d’André Malraux sur Jean Moulin, presque avec ferveur, comme le témoignage d’un idéalisme révolu) sera broyé avec une ferme et impitoyable douceur.
Reste un film passionnant, parfois aussi cruel et âpre, cynique ou réaliste, selon les points de vue. Vous aurez compris le mien, sans doute idéaliste mais assumé. Une vision de l’exercice de l’Etat, contestable, mais indéniablement personnelle, et traitée avec rigueur et originalité, à voir en tout cas !
Critique de "Pater" d'Alain Cavalier
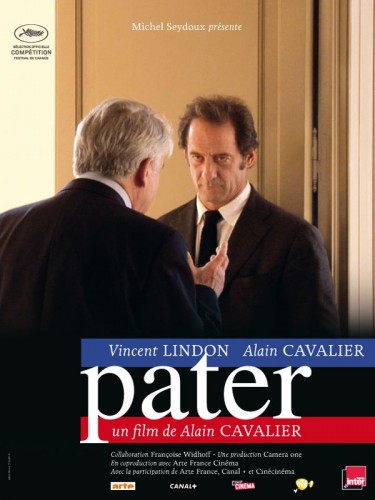
J’étais d’autant plus impatiente de découvrir « Pater » en salles que j’avais assisté à Cannes à la conférence de presse (passionnante) et que le film y avait reçu un accueil pour le moins chaleureux (17 minutes d’applaudissements dans la salle du Grand Théâtre Lumière, sans doute, pourtant, le public le plus impitoyable et versatile qui soit). Un succès cannois qui contraste avec le peu de salles projetant le film … et avec son caractère très iconoclaste.
Pendant un an, le réalisateur « filmeur » Alain Cavalier et le comédien Vincent Lindon se sont vus et filmés. Le réalisateur devenu aussi acteur et l’acteur réalisateur. Et le réalisateur acteur devenant Président de la République et son acteur réalisateur son Premier Ministre. Le tout mêlant réalité et fiction, vérité et jeu. Une fiction inventée tout en filmant la vie, l’une et l’autre étant indistinctes et se contaminant. Le Président de la République et son Premier ministre décident de proposer une loi fixant l’écart maximal entre les salaires. Le Président est partisan d’un rapport de 1 à 15 alors que son Premier ministre préférerait un écart de 1 à 10. L’élection présidentielle approche, les deux hommes s’éloignent alors et finissent par se présenter l’un contre l’autre…
Un film pour lequel Alain Cavalier a eu carte blanche de son fidèle producteur Michel Seydoux. Et sans doute ne sont-ils pas très nombreux à accepter encore ce genre de projet : hybride, hors normes, indéfinissable.
Un film malin et agaçant, humble et prétentieux, ludique et pédant. Mais en tout cas, un film courageux, audacieux, original, libre, à l’image de son réalisateur et de son acteur principal. Déjà au moins quatre qualités à mes yeux.
Malin parce que, en feignant l’improvisation totale, Alain Cavalier nous emmène là où il souhaite nous emmener tout comme il conduit son acteur-réalisateur-Premier-Ministre. Malin parce qu’il brouille constamment les repères, les pistes. Malin parce que, en feignant de ne rien dire, ne rien faire ou presque, il stigmatise la politique ou du moins (dé)montre à quel point elle est un jeu (de pouvoirs, d’acteurs). Malin parce que le titre est loin d’être innocent ou anodin. Pater. Père de la nation. Relation filiale complexe qui s’établit un père et un fils. Entre Lindon et Cavalier, hommes entre lesquels s’établit une relation presque filiale. Entre le Président et le 1er Ministre, le fils rêvant d’ailleurs de prendre la place du père. Pater. Ce père que Cavalier évoque non sans tendresse, avouant l’avoir jugé trop durement mais gommant par une opération un défaut physique qui fait qu’il lui ressemble. Enfin, Pater parce que Cavalier a été élevé chez les prêtres où Dieu était un autre Pater. Pater : une absence donc omniprésente.
Agaçant quand il singe la politique, la décrédibilise une fois de plus comme si elle avait encore besoin de ça. Agaçant quand Lindon et Cavalier jouent à être des politiques (et jouent sous nos yeux à être des acteurs, le film se construisant sous notre regard, ou du moins feignant de se construire sous notre regard) avec une sémantique tout aussi enfantine ( comme un « malgré que » qui a écorché mes oreilles etc et un programme relevant de ce que certains qualifieront sans doute d’une enfantine utopie : retrait de la légion d'honneur à qui place son argent à l'étranger, limitation de l'écart entre petits et gros salaires dans une même entreprise).
Ludique quand il interroge les fonctions d’acteur et de politique et les met en parallèle. Ludique parce que finalement l’un et l’autre (acteur et politique) jouent à être quelqu’un d’autre pour convaincre. Ludique parce que c’est aussi une leçon de cinéma (la dernière scène en est particulièrement emblématique) et une leçon contre les budgets pharaoniques donnant des films vains. Ludique quand il nous devient impossible de distinguer ce qui est fiction ou réalité, ce qui est jeu ou vérité.
Ludique et même drôle quand Vincent Lindon parle à ses gardes du corps dans le film se plaignant de ne pas avoir reçu de coup de fil du Président/réalisateur Cavalier pour valider son interprétation « Qu'il n'appelle pas Vincent Lindon c'est une chose, mais le Premier Ministre quand même... » ou quand une photo compromettante pour le leader de l'opposition tombe entre ses mains.
Humble par ses moyens de production. Prétentieux par sa forme déconcertante, son discours d’apparence simple et finalement complexe comme la relation qu’il met en scène. Prétentieux car finalement très personnel avec un discours prétendument universel.
L’antithèse de la « Conquête » (également en sélection officielle à Cannes mais hors compétition, contrairement à « Pater ») qui veut nous faire croire que le cinéma c’est l’imitation ; Cavalier nous dit ici au contraire que c’est plutôt recréation (et récréation). Réflexion déroutante et ludique sur le jeu et les jeux de pouvoirs (entre un Président de la République et son Premier Ministre, entre deux hommes, entre un père et son fils, entre un réalisateur et un acteur mais aussi entre un réalisateur et le spectateur ici allègrement manipulé) qui, tout de même, témoigne d’une belle audace et liberté (de plus en plus rares) mais s’adresse à des initiés tout en feignant de s’adresser à tous. Le « Pater » Cavalier ne reproduit-il pas ainsi d’une certaine manière avec le spectateur ces jeux de pouvoirs qu’il stigmatise ? Le sous-estime-t-il, l’infantilise-t-il ou au contraire le responsabilise-t-il en lui laissant finalement l’interprétation –dans les deux sens du terme- finale ? Peut-être que trouver des réponses à ces questions vaut la peine d’aller le voir en salles. A vous de juger.
Critique "Les Marches du pouvoir" de George Clooney

« The American » d’Anton Corbijn, le dernier film sorti en salles avec George Clooney prouvait une nouvelle fois le caractère judicieux de ses choix en tant que comédien et en tant que producteur, ce film allant à l’encontre d’une tendance selon laquelle les films doivent se résumer à des concepts, prouvant qu’un film lent, au style épuré et aux paysages rugueux (ceux des Abruzzes en l’occurrence, d’ailleurs magnifiquement filmés) peut être plus palpitant qu’un film avec une action à la minute. Avec « Les Marches du pouvoir », il confirme la clairvoyance de ses choix (film produit par un autre acteur aux choix clairvoyants, Leonardo DiCaprio) avec un film au sujet a priori (et seulement a priori) peu palpitant : la bataille pour les primaires démocrates et, un peu à l’inverse de « The American » qui était un thriller traité comme un film d’auteur intimiste, il nous embarque dans un thriller palpitant avec ce qui aurait pu donner lieu à un film d’auteur lent et rébarbatif. "Les Marches du Pouvoir" est une adaptation de la pièce de théâtre « Farragut North » de Beau Willimon, il a été présenté en compétition officielle de la dernière Mostra de Venise.
Stephen Meyers (Ryan Gosling) est le jeune, légèrement arrogant, mais déjà très doué et expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris (George Clooney) candidat aux primaires démocrates pour la présidence américaine. Pour lui, Morris est le meilleur candidat et il s’engage à ses côtés, totalement convaincu de son intégrité et de ses compétences mais peu à peu il va découvrir les compromis qu’impose la quête du pouvoir et perdre quelques illusions en cours de route… Il va découvrir ce qu’il n’aurait jamais dû savoir, commettre l’erreur à ne pas commettre et la campagne va basculer dans un jeu de dupes aussi fascinant que révoltant.
Le film commence sur le visage de Meyers récitant un discours, du moins le croit-on… La caméra s’éloigne et dévoile une salle vide et que l’homme qui semblait être dans la lumière est en réalité un homme dans et de l’ombre, préparant la salle pour celui qu’il veut mener à la plus grande marche du pouvoir. Ce début fait ironiquement écho au magnifique plan-séquence de la fin où la caméra se rapproche au lieu de s’éloigner (je ne vous en dis pas plus sur cette fin saisissante)…tout un symbole !
Je ne suis pas à un paradoxe près : alors que je m’insurge constamment contre le poujadiste et simpliste « tous pourris » souvent le credo des films sur la politique, ce film qui dresse un portrait cynique de la politique et de ceux qui briguent les plus hautes marches du pouvoir m’a complètement embarquée… Clooney non plus n’est pas à un paradoxe près puisque lui qui a fermement défendu Obama dans sa campagne présidentielle et dont la sensibilité démocrate n’est pas un mystère a mis en scène un candidat (démocrate) dont l’affiche ressemble à s’y méprendre à celle du candidat Obama. D’ailleurs, ce n’est pas forcément un paradoxe, mais plutôt une manière habile de renforcer son propos.
A première vue, rien de nouveau : les manigances et les roueries de la presse pour obtenir des informations qui priment sur tout le reste, y compris de fallacieuses amitiés ou loyautés, la proximité intéressée et dangereuse entre le pouvoir politique et cette même presse (tout ce que la très belle affiche résume, avec en plus le double visage du politique), et même les liens inévitables entre désir et pouvoir qui ouvraient récemment un autre film sur la politique, « L’Exercice de l’Etat », dans une scène fantasmagorique mais, malgré cela, George Clooney signe un film remarquable d’intensité, servi par des dialogues précis, vifs et malins et par une mise en scène d’une redoutable élégance, notamment grâce au recours aux ombres et à la lumière pour signifier l’impitoyable ballet qui broie et fait passer de l’un à l’autre mais surtout pour traiter les coulisses obscures du pouvoir comme un thriller et même parfois comme un western (le temps d’un plan magnifique qui annonce le face-à-face dans un bar comme un duel dans un saloon). En fait, « Les marches du pouvoir » porte en lui les prémisses de plusieurs genres de films (thriller, romantique, western) montrant, d’une part, l’habileté de Clooney pour mettre en scène ces différents genres et, d’autre part, les différents tableaux sur lesquels doivent jouer les hommes politiques, entre manipulation, séduction et combat.
Le temps d’une conversation plongée dans le noir ou d’une conversation devant la bannière étoilée (invisible un temps comme si elle n’était plus l’enjeu véritable mais aussi gigantesque et carnassière), sa mise en scène se fait particulièrement significative. Cette plongée dans les arcanes du pouvoir les décrit comme une tentation perpétuelle de trahir : ses amis politiques mais surtout ses idéaux. L’étau se resserre autour de Stephen comme un piège inextricable et les seuls choix semblent alors être de dévorer ou être dévoré, d’ailleurs peut-être pas tant par soif du pouvoir que par souci de vengeance et par orgueil, amenant ainsi de la nuance dans le cynisme apparent qui consisterait à dépeindre des hommes politiques uniquement guidés par la soif de conquête et de pouvoir. Ryan Gosling est parfait dans ce rôle, finalement pas si éloigné de celui qu’il endosse dans « Drive », incarnant dans les deux cas un homme qui va devoir renier ses idéaux avec brutalité, et qui révèle un visage beaucoup plus sombre que ce qu’il n’y parait. Face à lui, George Clooney en impose avec sa classe inégalée et inégalable qui rend d’autant plus crédible et ambivalent son personnage à la trompeuse apparence, épris de laïcité, de pacifisme et d’écologie... sans doute davantage par opportunisme que par convictions profondes, ses choix privés révélant la démagogie de ses engagements publics.
Le cinéma américain entre Oliver Stone, Pakula, ou avec des rôles incarnés par Robert Redford comme dans « Votez McKay » de Michael Ritchie (que Redford avait d’ailleurs coproduit) a longtemps considéré et trainté la politique comme un sujet à suspense. Tout en s’inscrivant dans la lignée de ces films, Clooney réinvente le genre en écrivant un film aux confluences de différents styles. La politique est décidément à la mode puisque pas moins de trois films français (très différents) sur le sujet sont sortis cette année (« La Conquête », « Pater » et « L’Exercice de l’Etat »). Clooney ne s’intéresse d’ailleurs pas ici uniquement à la politique, le film ne s’intitulant pas « Les marches du pouvoir politique » mais du pouvoir tout court et cette soif d’ascension au mépris de tout pourrait se situer dans d’autres sphères de la société de même que la duplicité de ceux qui cherchent à en gravir les marches, à tout prix, même celui de leurs idéaux.
Seul regret : que le titre original peut-être pas plus parlant mais plus allégorique n’ait pas été conservé. « The ides of March » correspond ainsi au 15 mars du calendrier romain, une expression popularisée par une des scènes de « Jules César » de William Shakespeare, dans laquelle un oracle prévient le célèbre général de se méfier du 15 mars, date à laquelle il finira par être assassiné.
Un thriller aussi élégant que le sont en apparence ses protagonistes et qui en révèle d’autant mieux la face obscure grâce à un rythme particulièrement soutenu, un distribution brillamment dirigée (avec des seconds rôles excellents comme Philip Seymour Hoffman ou Paul Giamatti), des dialogues vifs, et surtout une mise en scène métaphorique entre ombre et lumière particulièrement symptomatique du véritable enjeu (être, devenir ou rester dans la lumière) et de la part d’ombre qu’elle dissimule (souvent habilement) et implique. Je vous engage à gravir ces « Marches du pouvoir » quatre-à-quatre. Un régal impitoyable. Vous en ressortirez le souffle coupé !
Critique- "Le Promeneur du champ de Mars" de Robert Guédiguian
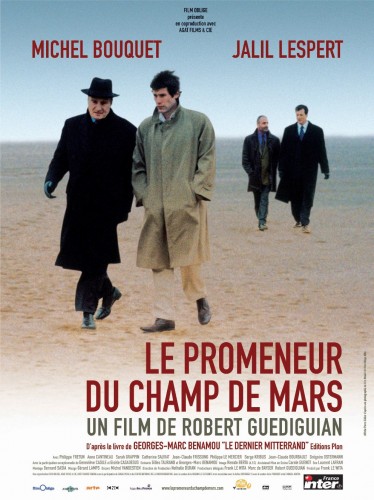
« Le promeneur du champ de Mars », c’est l’histoire d’un homme qui chemine vers la mort…oui mais voilà pas n’importe quel homme. Cet homme, c’est François Mitterrand, figure emblématique de la vie politique française du vingtième siècle, président de la République française pendant 14 ans, et qui, gravement malade défie le temps et la maladie pour terminer son deuxième mandat. Cela change tout. Cela ne change rien. Cela change tout pour les responsabilités qui incombent à sa charge, même aux portes de la mort. Cela ne change rien parce-que la mort n’en est pas moins inéluctable. Davantage qu’un film sur le pouvoir, c’est donc de ce chemin là qu’il est avant tout question, un chemin parsemé de doutes, de désillusions et surtout de zones d’ombre.
Le jeune journaliste qui accompagne cette ultime promenade cherche en effet à lever le voile obscur qui recouvre le rôle de Mitterrand sous l’Occupation, son engagement tardif dans la Résistance et son embarrassante amitié avec Bousquet. Fasciné par son sujet (à l’image du réalisateur ?) la question restera en suspens…malgré ses tentatives velléitaires de questionnement sur ces problèmes.
Il nous dresse le portrait d’un homme qui fait le bilan de sa vie politique, qui a appris les compromis, ironise non sans un certain cynisme sur le devenir de la gauche et sur les utopies politiques désenchantées, le hiatus entre la « réalité rêvée » et la « réalité réelle ».
Michel Bouquet est impressionnant de vérité. Il ne singe pas mais incarne Mitterrand de manière saisissante et de temps à autre sa silhouette provoque une troublante confusion entre l’acteur et son modèle. Son regard juge, jauge, désarçonne, pétille, fusille, désarme comme le faisait celui de l’ancien président. Face à lui Jalil Lespert ne démérite pas dans le rôle du journaliste idéaliste intrigué, fasciné, parfois désemparé. Asservi aussi ? Peut-être peut-on y voir une amorce de critique en filigrane : son comportement monarchiste, exclusif, intransigeant. La critique, certes bien timide, s‘arrête là. Pour le reste le film pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses mais parfois les questions sont plus significatives que les réponses. A vous de juger si tel est le cas en l’espèce.
Cela ne fait pas pour autant de ce film un portrait complaisant comme cela lui a été souvent reproché. Il l’aurait été s’il s’était agi de faire un bilan de sa carrière mais il ne s’agit nullement de cela ou alors de manière anecdotique. C’est aussi la leçon de vie d’un homme qui assène ses vérités sur l’amour, la mort, l’Histoire, la littérature, une littérature omniprésente tout au long du film, entre Verlaine, Fournier, Cohen et les autres.
Ce promeneur là se distingue des autres peut-être davantage encore parce-qu’il est à la dernière étape de sa vie que par les fonctions qu’il va ou vient de quitter (à la fin du film puisque celui-ci retrace ses derniers mois de mandat et ses derniers mois de vie avec pour fil conducteur ses conversations avec le journaliste- double de Benamou.)
Les dialogues sont percutants et incisifs, les silences sont éloquents d’ambivalence et crédibilisent davantage encore le personnage parfois arrogant et même cassant. Les répliques cinglantes et caustiques sont criantes de véracité, témoignages de son cynisme, de son machiavélisme, pour ses détracteurs, de son intelligence pour ses admirateurs. D’ailleurs il est fort probable que ceux qui l’aimaient continueront à l’aimer et que ceux qui le détestaient continueront à le détester. En effet, Guédigian n’est pas tombé dans l’écueil du voyeurisme et bien que se revendiquant homme de gauche il n’est pas non plus tombé dans celui de l’apologie. Tout juste nous le montre-t-il parfois affaibli, nous laissant entrevoir derrière le masque l’homme qui se meurt et homme parce-qu’il se meurt.
Aux couleurs chaudes et méditerranéennes caractéristiques de ses précédents films Guédiguian a préféré recourir à des teintes grisonnantes à l’image de la couleur qui selon Mitterrand définit le mieux la France. A la grandiloquence qui caractérise souvent les films politiques ou historiques Guédiguian a préféré un récit nuancé et sobre. Cela pourrait être ennuyeux, c’est captivant comme un film à suspense qui présente pourtant le postulat contraire à celui du film à suspense puisque nous en connaissons forcément d’emblée le dénouement.
Critique de "W.L'improbable président" d'Oliver Stone
En cette belle journée historique qui, par l’élection du Démocrate Barack Obama comme 44ème Président des Etats-Unis, symbolise le début d’une nouvelle ère et cristallise tellement d’espoirs Outre-Atlantique et dans le monde entier, mettant ainsi fin à huit années de calamiteuse présidence du Républicain George W. Bush, j’ai choisi de vous parler du film éponyme d’Oliver Stone qui résume ce nom en une simple lettre à laquelle est accolé ce qualificatif ironique et terrible « improbable », une lettre qui, par ce qu’elle sous-entend, en dit tellement sur les motivations de l’ancien président (qui l’est néanmoins officiellement jusqu’au 20 janvier 2009) qui a tristement transformé la face du monde, du moins du Moyen Orient.
W. c’est donc deux récits que le montage entremêle judicieusement : l’histoire du fils d’un homme politique qui brigue la présidence américaine (James Cromwell dans le rôle de George Bush, senior), un fils alcoolique, impulsif (Josh Brolin dans le rôle de W.) qui rate tout ce qu’il entreprend et que le manque de confiance et de considération paternelles conduiront jusqu’à la Maison Blanche et l’histoire d’un Président, ledit fils, qui se lance dans une guerre aux motivations troubles qui le conduira à sa perte, à devenir le plus mauvais Président américain. Le parcours d’un homme alcoolique notoire qui devient l’improbable Président des Etats-Unis.
J’ai lu ou entendu ça et là que certains déploraient que George W. paraisse sympathique comme si être sympathique occultait tous les autres défauts qu’Oliver Stone décrypte malicieusement, comme si paraître sympathique suffisait pour être Président des Etats-Unis. C’est à mon sens d’ailleurs bien pire, la critique n’en est que plus percutante et virulente. W. n’est pas un idiot sanguinaire mais un homme qui malgré ses faiblesses, ses failles (et peut-être à cause d’elles) arrivera à la tête de la plus grande puissance mondiale. Il pourrait même nous inspirer de la pitié. Mais il est juste pitoyable. Et la caméra d’Oliver Stone, souvent placée là où ça fait mal, ne lui épargne rien, soulignant souvent son ridicule, le montrant comme un enfant capricieux, plutôt rustre, pas très cultivé mais doté d’une mémoire considérable, un enfant dont la relation a son père a bouleversé la face du monde, un enfant qui s’intéresse essentiellement au baseball mais qui, à 40 ans, trouve la foi, se convertit, cesse de boire et se retrouve dans les pas historiques de son père, lequel aurait préféré y voir son frère qui, d’ailleurs, échouera.
W. : c’est donc une simple lettre qui en dit long car c’est justement pour n’être pas que W., pas que « le fils de » que ce dernier se lancera en politique et qu’il briguera la présidence sans jamais avoir vraiment le soutien de son père à la personnalité écrasante avec lequel il entretient une relation orageuse par laquelle Oliver Stone explique ici en partie la guerre en Irak, W. reprochant à son père de ne pas avoir éliminé Saddam Hussein et expliquant ainsi qu’il n’ait pas été réélu. (Les conversations entre le père et le fils à ce sujet ou les réunions de l’administration Bush sont réellement passionnantes et tristement instructives.) Ce complexe œdipien serait sans doute touchant si W. n’était à la tête de la plus grande puissance mondiale et de son armée. Un homme comme les autres (qui a d’ailleurs bien compris le bénéfice qu’il pouvait en tirer) à une place qui n’est pas comme les autres.
Un film captivant, édifiant qui décrit un système dont le président n’est parfois qu’un rouage et auquel la caméra d’Oliver Stone, toujours intelligemment placée, apporte un regard incisif, parfois un second degré, démontrant de manière implacable à quel point ce président est improbable. Seul regret : la fin, certes explicite et significative, un peu expéditive et abrupte après une scène néanmoins consternante d’une conférence de presse où il apparaît, perdu, tel un enfant pris en faute, en manque d’arguments, un enfant qui a mené un pays à la guerre, pour de fallacieuses raisons.
Cette critique serait incomplète sans évoquer l’interprétation, celle, magistrale, de Josh Brolin ( que l’on a vu récemment dans « No country for old men ») avant tout mais aussi de tous ceux qui incarnent l’administration Bush. Si le voir jeune manque parfois un peu de crédibilité (l’acteur a 40 ans) en revanche lorsqu’il l’incarne comme Président des Etats-Unis, nous retrouvons sa voix, ses gestes, sa démarche de cow-boy, un mimétisme troublant que l’on retrouve également chez les autres acteurs, notamment avec Thandie Newton dans le rôle de Condoleezza Rice ou Jeffrey Wright dans celui de Colin Powell dont on découvre ici les réticences pour entrer en guerre et ensuite sa capacité à la défendre (Colin Powell a finalement appelé à voter Obama …).
Après « JFK » en 1991 et « Nixon » en 1995, Oliver Stone signe donc son troisième film consacré à un Président américain et la première fiction réalisée sur un président encore en exercice. Nous imaginons déjà quel film magnifique et poignant pourrait être la vie de celui, si posé et charismatique, qui incarne désormais l’American dream, de celui, entre autres symboles tellement cinématographiques d’un indéniable potentiel dramatique, dont la grand-mère qui l’a élevé expire son dernier souffle (non sans avoir voté !) la veille du jour où son petit-fils en donne un nouveau au monde, de celui qui est bien plus et mieux que tous les symboles auxquels certains tentent de le réduire, de celui qui incarne aussi tellement d’espoirs comme personne n’en avait incarné depuis longtemps, de celui qui redonne le sourire au monde, de celui qui démontre que l’improbable, dans tous les sens est toujours possible à condition d’y croire et de s’en donner les moyens. Yes, we can!
Un film que je recommande à tous ceux qui désirent en savoir plus, comprendre comment W. est arrivé au pouvoir, comment l’improbable a été possible, mais aussi comprendre le parcours d’un homme qui aurait été touchant s’il n’avait été Président des Etats-Unis. Malheureusement.
Critique de "Parlez-moi de la pluie" d'Agnès Jaoui
Agathe Villanova (Agnès Jaoui), féministe nouvellement engagée en politique, revient pour dix jours dans la maison de son enfance, dans le sud de la France, aider sa sœur Florence (Pascale Arbillot) à ranger les affaires de leur mère, décédée un an auparavant.
Agathe n'aime pas cette région, elle en est partie dès qu'elle a pu mais les impératifs de la parité l'ont parachutée ici à l'occasion des prochaines échéances électorales.
Dans cette maison vivent Florence, son mari, et ses enfants mais aussi Mimouna (Mimouna Hadji), que les Villanova ont ramenée avec eux d'Algérie, au moment de l'indépendance et qui a élevé les enfants.
Le fils de Mimouna, Karim (Jamel Debbouze), et son ami Michel Ronsard (Jean-Pierre Bacri) entreprennent de tourner un documentaire sur Agathe Villanova, dans le cadre d'une collection sur "les femmes qui ont réussi".
C’est un mois d'Août gris et pluvieux : ce n’est pas normal…mais rien ne va se passer normalement.
« Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps
Le beau temps me dégoute et m'fait grincer les dents
Le bel azur me met en rage
Car le plus grand amour qui m'fut donné sur terr'
Je l'dois au mauvais temps, je l'dois à Jupiter
Il me tomba d'un ciel d'orage »
Voilà les premiers vers de la chanson « L’orage » de Georges Brassens dont le titre du film est tiré. De l’orage surgit la vérité, parfois l’amour mais avant d’en arriver là les personnages de « Parlez-moi de la pluie » auront dû affronter des humiliations ordinaires et non moins blessantes, leurs certitudes parfois erronées ou une injustice lancinante, une condescendance.
Je revoyais le magnifique et intemporel « César et Rosalie » de Claude Sautet avant-hier, encore, pour la énième fois, avec toujours cette même envie de suivre les personnages, de les connaître même, et même si Agnès Jaoui récuserait peut-être cette comparaison (n’aime-t-elle pas plutôt, aussi, Kusturica, où par bribes visuelles et musicales, son film m’a aussi fait songer ?), je trouve que leurs films ont cela en commun de donner vie et profondeur à des personnages à tel point qu’on imagine leur passé, leur avenir, une existence réelle, qu’on les découvre différemment à chaque visionnage, dans toute leur touchante ambivalence. Et puis Claude Sautet aussi aimait « parler de la pluie ». Dans chacun de ses films ou presque, elle cristallisait les sentiments, rapprochait les êtres.
Ce qu’on remarque en premier, c’est donc cela : le sentiment d’être plongés dans l’intériorité des personnages, de les connaître déjà ou de les avoir rencontrés ou d’avoir envie de les rencontrer tant les scénaristes Bacri et Jaoui les humanise. Karim et Mimouna sont victimes du racisme, d'autant plus terrible qu'insidieux, Agathe du sexisme et des préjugés concernant sa condition de femme politique, Michel de ne pas exercer pleinement son métier ni d’avoir pleinement la garde de son fils, Florence de ne pas être assez aimée… Chaque personnage est boiteux, que son apparence soit forte ou fragile.
La caméra d’Agnès Jaoui est plus nerveuse qu’à l’accoutumée comme si les doutes de ses personnages s’emparaient de la forme mais c’est quand elle se pose, reprend le plan séquence qu’elle est la plus poignante et drôle : vivante. Comme dans cette scène où Karim, Michel, Agathe se retrouvent chez un agriculteur qui les a « recueillis » : scène troublante de justesse, ne négligeant aucun personnage, aucun lieu commun pour mieux le désarçonner, en souligner l’absurdité.
L’écriture de Bacri et Jaoui est toujours nuancée, la complexité des êtres, leurs faiblesses que leur écriture précise dissèque devient ce qui fait leur force. Les dialogues sont toujours aussi ciselés, peut-être moins percutants et acerbes que dans le caustique et si touchant « Un air de famille » de Cédric Klapisch, plus mélancolique aussi. Jaoui et Bacri ont décidément le goût des autres à tel point qu’ils nous font aimer et comprendre leurs imperfections, et forcément nous y reconnaître. Aucun rôle n’est négligé. Le second rôle n’existe pas. L’écriture de Jaoui et Bacri n’a pas son pareil pour faire s’enlacer pluie et soleil, émotion et rire, force et faiblesse : pour faire danser l’humanité sous nos yeux. Jaoui et Bacri n’ont pas leur pareil pour décrire la météo lunatique des âmes.
Jamel Debbouze n’a jamais été aussi bien filmé, n’a jamais aussi bien joué : dans la retenue, l’émotion, la conviction. Adulte, enfin.
Le personnage d’Agathe incarné par Agnès Jaoui est une salutaire réponse au poujadisme toujours régnant qui voudrait qu’ils soient « tous pourris » et rend hommage à l’engagement parfois compliqué que constitue la politique.
Drôle, poétique, touchant, convaincant : cette pluie vous met du baume au cœur. On en ressort l’âme ensoleillée après que se soit dissipée la brume qui pesait sur celles de ses personnages que l’on quitte avec regrets, heureux malgré tout de les voir cheminer vers une nouvelle étape de leur existence qui s’annonce plus radieuse.
Si comme l’écrivait Kirkegaard cité dans le film, l’angoisse est le possible de la liberté. La pluie sur les âmes sans doute est-elle le possible de son soleil, teinté d’une bienheureuse mélancolie à l’image de ce film réconfortant, brillamment écrit et réalisé.
Critique de "Coluche l'histoire d'un mec" d'Antoine de Caunes
Septembre 1980. Dans quelques mois les Français éliront un nouveau Président de la République. Pendant ce temps, Coluche triomphe tous les soirs au Théâtre du Gymnase. "Comique préféré des Français", il est au sommet de sa gloire... Toujours prêt à provoquer un peu plus, il décide, pour rire, poussé par son entourage aussi, de poser sa candidature à la Présidence de la République. Les sondages s'affolent, sa cote monte en flèche jusqu’à atteindre le score incroyable de 16%. Et si finalement un clown se faisait élire Président ? Lui-même commence à y croire...peut-être un peu trop…
Clamons-le, proclamons-le d’emblée et acclamons-le : François-Xavier Demaison est absolument sidérant. Il dévore l’écran, (ré)incarne Coluche, lui donne une nouvelle dimension, gigantesque, le fait revivre à sa manière, nous fait retrouver sa gestuelle si particulière, sa voix pourtant inimitable, sa démarche si singulière. Il s’est glissé dans le costume Coluche tout en y apportant sa personnalité. La performance (encore que le terme soit mal choisi, car jamais justement contrairement à l’actrice principale d’un biopic, césarisée-oscarisée, jamais on a l’impression d’assister à une performance) est remarquable. Et si le film devait avoir une raison d’exister ce serait celle-là et uniquement celle-là : donner à Demaison un rôle à la (dé)mesure de son talent. Et puis j’aime bien ceux qui, comme Demaison, vont au bout de leurs rêves, s’échappent d’une vie tracée pour prendre des risques et surtout celui, grisant, de vivre de leur passion, quelle que soit l’issue (François-Xavier Demaison a abandonné son métier d’avocat fiscaliste à Manhattan suite au 11 septembre 2001), et surtout pas par souci de plaire ou de reconnaissance mais simplement pour être fidèle à ce qu’ils sont profondément. « Celui qui se perd dans sa passion est moins perdu que celui qui perd sa passion ». Oui, résolument.
Voilà pour l’essentiel. Pour le reste…pour le reste, il me déplait de ne pas aimer un film quand ses créateurs semblent aussi passionnés mais c’est ainsi. Je me suis profondément ennuyée, suis toujours restée à distance et ai eu aussi l’impression qu’Antoine de Caunes restait lui aussi toujours à distance de son sujet, par peur de l’égratigner peut-être, par peur d’écorner l’image qu’il admirait à l’évidence. La caméra à l’épaule ne suffit pas à nous bousculer ni vraiment à refléter l’agitation qui semblait régner autour de Coluche (sa maison était constamment envahie par ses amis motards, journalistes, acteurs…).
Est-ce parce que je serais imperméable à l’humour de Coluche (mais pas hermétique au personnage qu’Antoine de Caunes rend indéniablement attachant), je n’ai pas ri un seul instant. Même si à l’évidence le but n’était pas d’écrire une comédie mais « l’histoire d’un mec » engagé dans un combat trop grand pour lui qui n’appartenait à d’autre parti qu’à « celui d’en rire » et allait se retrouver dans une histoire sérieuse, qu’il allait d’ailleurs finir par prendre au sérieux, un combat qui allait finalement le dépasser.
De ce film émane une profonde mélancolie, sans doute celle de l’artiste très entouré face à sa solitude, ses responsabilités, ses doutes, ses contradictions qui passe de l’insouciance à la gravité. Peut-être est-ce d’ailleurs un aspect qu’il aurait été intéressant de creuser, notamment en montrant le rôle vampirique de l’entourage qui reste malheureusement ici une masse grégaire et informe (la plupart des personnages n’ayant pas de noms). Si François-Xavier Demaison dévore l’écran, son personnage dévore aussi malheureusement les autres personnages qui n’ont pas l’espace pour exister. Antoine de Caunes s’en défend en disant que le personnage central est Coluche et que faire exister chaque personnage aurait été une perte de temps. C’est la première raison pour laquelle j’ai pensé à « Parlez-moi de la pluie » dans lequel chaque personnage existe réellement même s’il n’apparaît que peu à l’écran sans être tout à fait un film choral. La deuxième raison pour laquelle j’y ai pensé c’est évidemment eu égard à l’image de la politique et du politique qui en ressort, à l’opposé de l’image véhiculée par Coluche du « un pour tous, tous pourris » comme le disait l’humoriste, une image un peu facile, sans doute dans l’air du temps. Que Coluche ait été victime de pressions et même d’intimidations n’est pas un scoop, il est néanmoins amusant de le voir courtisé par tous les partis et hommes politiques ( de Lalonde à Attali), et même parfois de le voir en rencontrer certains dont les convictions sont opposées aux siennes, de le voir parler de sujets sérieux avec dérision, d’être pris très au sérieux par ses interlocuteurs, de finalement être rattrapé par l’attente et l’espoir qu’il a soulevés, et surtout de voir l’obstacle qu’il constitue alors pour ceux à qui il prend des voix, et l’importance que prend alors ce qui, au départ, était une plaisanterie.
Peut-être l’aspect impersonnel du film est-il aussi lié au fait qu’il s’agisse à l’origine d’un projet de producteurs (Edouard de Vesinne et Thomas Anargyros), un scénario préalablement commandé au journaliste Diastème qui devait être un biopic du comique et qu’Antoine de Caunes a eu l’intelligence de transformer et concentrer sur cette période intéressante, où « l’histoire de ce mec » rencontre l’Histoire, une Histoire qui ne supporte pas que les comiques s’en mêlent.
A défaut d’être un grand cinéaste avec un univers propre (mais peut-être cela viendra-t-il) Antoine de Caunes démontre son talent de réalisateur appliqué (notamment dans la reconstitution d’une époque, ici plutôt réussie, bande originale à l’appui, la musique ayant été ici confiée à Ramon Pipin un des musiciens de Coluche), capable de s’adapter à tous les genres (fantastique avec « Les morsures de l’aube », suspense historique avec « Monsieur.N »-le plus réussi et sous-estimé à mon avis-, la comédie avec « Désaccord parfait ») et un bon directeur d’acteurs : Léa Drucker dans le rôle de Véronique Colucci apparaît peu mais impose sa belle présence, Denis Podalydès et Olivier Gourmet sont toujours aussi justes… et puis François-Xavier Demaison, phénoménal, je ne me lasse pas de le répéter…
|
Rappelons que l’équipe du film a probablement eu des sueurs froides, Paul Lederman, l'ancien producteur et imprésario de Coluche ayant engagé une procédure judiciaire à l'encontre de la société Cipango, productrice du film invoquant l'utilisation en sous-titre du film de la formule "l'histoire d'un mec", formule qu'il dit lui appartenir en tant qu'éditeur du sketch Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma. L'imprésario a non seulement réclamé que cette mention soit retirée du titre mais aussi que Cipango lui verse la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon. C’est Olivier Gourmet qui tient son rôle dans le film mais son nom avait volontairement été remplacé car Paul Lederman n'avait pas donné son accord pour que son patronyme soit utilisé dans le film.
Le mardi 14 octobre 2008, la veille de la sortie en salles, le Palais de Justice de Paris a débouté Paul Lederman. Tout est bien qui finit bien…
|
Critique de "Président" de Lionel Delplanque
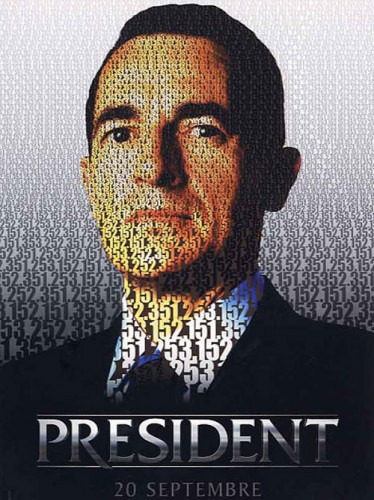
Il y a quelques jours sortait Président de Lionel Delplanque. A quelques mois des Présidentielles, quel sujet plus opportuniste ? Et surtout quel traitement plus opportuniste ? Le cynisme est à la mode. Et chez certains partis extrémistes, il consiste à mettre tous les hommes politiques dans le même panier, à ressortir le poujadiste « tous pourris ». On accordera au film le bénéfice du doute en disant que ce n’était pas volontaire mais c’est exactement le sens dans lequel va ce film à la morale douteuse.
Président nous fait suivre les pas d’un jeune président interprété par Albert Dupontel, un président idéaliste (il veut résorber la dette de l’Afrique) et (car ?) calculateur (il obtient des marchés publics à des marchands d’armes pour financer sa campagne, il ira jusqu’à faire tuer son père spirituel pour conserver le pouvoir). Derrière lui, un jeune idéaliste (Jérémie Rénier, toujours convaincant) qui, pour venger la mort de son père anarchiste décédé en prison, va séduire la fille du président (décidément bien naïve) lequel président va le prendre comme conseiller. Rien de plus facile alors pour ledit conseiller de faire main basse sur des secrets défense (je crois que nous pouvons sérieusement nous inquiéter si les secrets défense sont aussi facilement accessibles) dans le but de ternir l’image du président. Evidemment comme le pouvoir corrompt et fascine, (quel scoop !!) le jeune idéaliste va tomber sous le charme de cet homme charismatique (ou du moins censé l’être) et plus encore du pouvoir qu’il symbolise, tellement grisé par le pouvoir qu’il va abandonner brusquement tous ses idéaux avec une célérité déconcertante.
Prenez et remaniez les pires travers et zones d’ombres de nos hommes politiques (le suicide d’un conseiller dans son bureau de l’Elysée, les écoutes téléphoniques, le trafic d’armes, les liaisons, le mariage de façade ), assaisonnez de quelques répliques empruntées à d’anciens présidents (L’expression "Un continent humilié, un continent martyrisé." faisant ainsi référence au célèbre discours du général De Gaulle à la Libération de Paris ; la phrase que prononce Albert Dupontel à certaines personnes de son entourage "Vous n'êtes pas le meilleur, vous êtes le seul", étant celle que Valéry Giscard d'Estaing répétait aux jeunes ambitieux qui l'entouraient ; le Président parle de "veaux" à propos des Français comme l’avait fait De Gaulle etc), prenez un acteur dans le vent pour crédibiliser le tout, ajoutez une photographie froide comme le pouvoir, léchée et glaciale en clair obscur pour souligner les zones d’ombre au cas où nous n’aurions pas bien compris, et à l’issue d’un tel film (dont l’acteur principal dit lui-même ne jamais voter !!) vous vous dîtes forcément, malheureusement, que cela ne sert à rien de voter.
C’est facile et dangereux d’aller dans le sens du vent. Lionel Delplanque a certainement oublié le 21 Avril 2002. Pas moi. Il y a des amnésies périlleuses, des vents qui peuvent provoquer des cyclones. Faire du cinéma c’est aussi être responsable. On ne peut pas toujours arguer du caractère fictionnel pour se dédouaner. Le film s’intitule Président, et se complait dans l’abstraction, histoire de bien insister sur son caractère universel, les contradictions d’un homme au pouvoir, certes intéressantes si elles avaient été un peu plus nuancées !
Comme il est humain le Président est allergique à la lumière (allergie reliée à un évènement qui a forgé son destin et sa personnalité) et il adore sa fille, évidemment.
Comment dénoncer la démagogie quand on en fait soi-même à ce point preuve comme le fait Delplanque dans son film ? Mais d’ailleurs est-ce cela le propos du film ? Parce que, au fond, que veut-il VRAIMENT nous dire ?
Ce président semble tout droit sorti des Guignols de l’info qui eux, au moins, ont le mérite d’être souvent drôles et de se présenter d’emblée comme caricaturaux, et donc de permettre le décalage.
Ce blog est avant tout destiné à mettre en lumière des coups de cœur et rares sont les films que j’ai ouvertement critiqués mais devant la complaisance des critiques envers celui-ci, pour une fois, je n’ai pu m’en empêcher, ce film m’ayant profondément agacée, pour les raisons évoquées ci-dessus. Quant à Dupontel, malgré tout le talent dont il a fait preuve par le passé, il interprète ici un président bien maniéré et bien fade, au vocabulaire bien restreint pour l'énarque qu'il est forcément supposé être, et finalement bien peu charismatique au regard de l’engouement que ce personnage suscite. Heureusement Claude Rich, Jérémie Rénier et Jackie Berroyer par leurs prestations d’hommes dans les coulisses du pouvoir rehaussent le niveau.
Retrouvez également cet article à la une de mon nouveau blog http://inthemoodlemag.com .
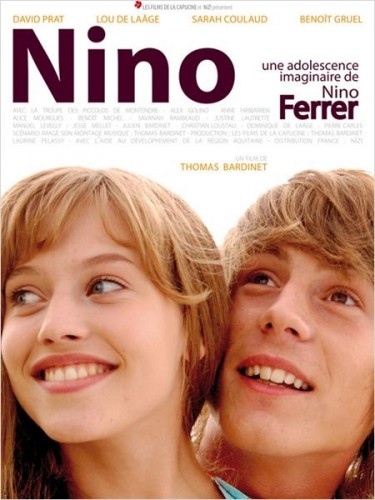





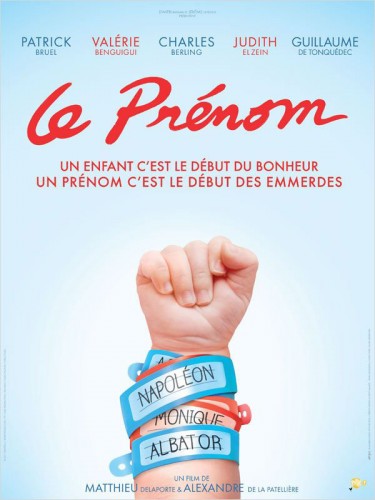
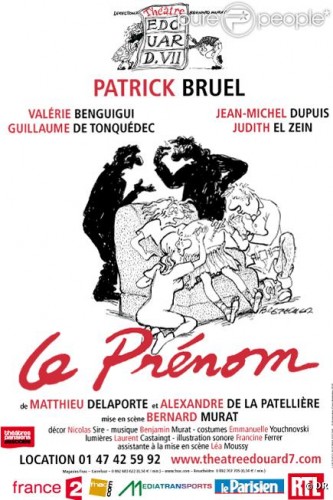





 A l'occasion de la Présidentielle 2012 et à J-7 du premier tour, comme je ne souhaite pas parler politique sur ce blog, je vais néanmoins célèbrer la campagne en vous proposant ci-dessous quelques critiques de films sur la politique déjà parues sur ce blog, des films "sur" la politique et non des films politiques car, d'une certaine manière, tous les films ou en tout cas une grande majorité pourraient répondre à cette seconde définition.
A l'occasion de la Présidentielle 2012 et à J-7 du premier tour, comme je ne souhaite pas parler politique sur ce blog, je vais néanmoins célèbrer la campagne en vous proposant ci-dessous quelques critiques de films sur la politique déjà parues sur ce blog, des films "sur" la politique et non des films politiques car, d'une certaine manière, tous les films ou en tout cas une grande majorité pourraient répondre à cette seconde définition.