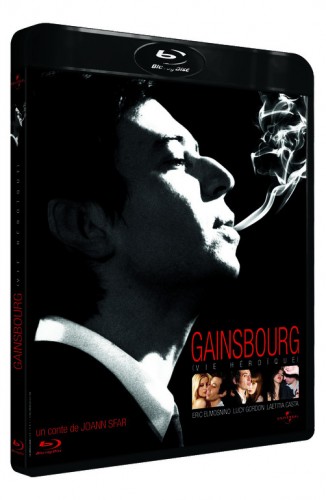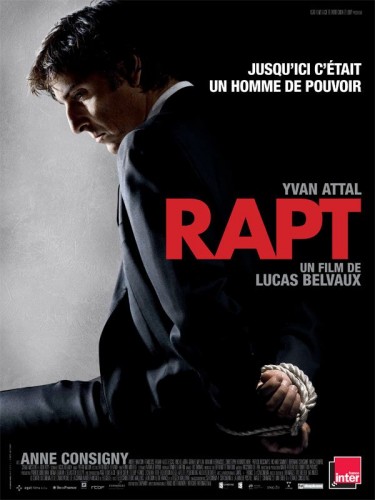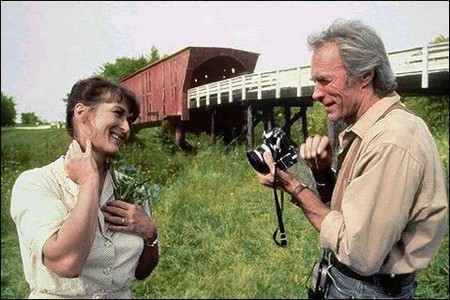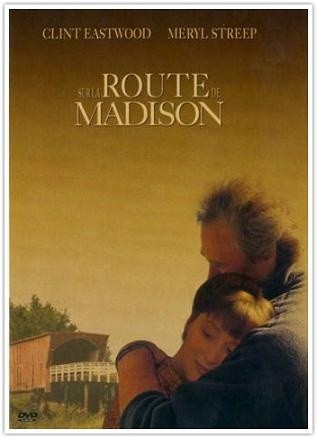Critique de GAINSBOURG (Vie héroïque) de Joann Sfar à 20H40 sur OCS Max ce jeudi 19 novembre 2015
Avec Gainsbourg, idole et référence de plusieurs générations mais aussi proche d'un certain nombre de personnalités encore vivantes, le sujet était a priori aussi opportuniste que délicat. Joann Sfar a donc eu l'excellente idée (apparemment suggérée par Jane Birkin pour bien signifier que les dialogues et situations ne sont pas authentiques) de donner à son film l'appellation de « conte », désamorçant d'avance toutes les polémiques et s'autorisant ainsi une composition libre. Une liberté dont était épris celui dont il retrace une partie du parcours artistique et des amours souvent célèbres et tumultueuses. Ou quand le sujet et la forme se confondent subtilement. D'où l'idée aussi judicieuse de cette « gueule » qui accompagne Gainsbourg, un Gainsbarre omniprésent, son double maléfique, sa face obscure, son Mister Hyde.
Tout commence dans le Paris occupé des années 1940 où Serge Gainsbourg s'appelle encore Lucien Ginsburg, fils d'immigrants russes juifs forcé de porter l'étoile jaune ...
Difficile d'expliquer pourquoi ce film au scénario pourtant imparfait m'a autant touchée et embarquée, séduite comme tant l'ont été par un Gainsbourg à l'apparence pourtant si fragile. Sans doute cette fameuse magie du cinéma. Certainement aussi l'interprétation incroyable d'Eric Elmosnino qui ne singe pas Gainsbourg mais s'approprie magistralement sa personnalité, sa gestuelle, son mélange d'audace et de fragilité touchantes. Certainement cette photographie d'une beauté redoutable. Ces scènes qui exhalent le charme provocateur de Gainsbourg. L'éclat troublant et sensuel du couple qu'il forme avec Brigitte Bardot (Laetitia Casta qui, pour ceux qui en doutaient encore, montre à quel point elle est une actrice extraordinaire empruntant même les intonations si particulières de Bardot ) ou avec Jane Birkin (Lucy Gordon, lumineuse qui chante « Le Canari est sur le balcon », chanson tristement prémonitoire -l'actrice s'est récemment suicidée- ). Sans doute encore la force intemporelle de chansons qui ont accompagné des périodes de mon existence comme pour tant d'autres, et la force émotionnelle des réminiscences qu'elles suscitent...
Un film en apparence désordonné et confus comme émergeant des volutes de fumée et des vapeurs d'alcool indissociables de Gainsbourg. Joann Sfar brûle ainsi les étapes de son film comme Gainsbourg le faisait avec sa vie, ce qui aurait pu apparaître comme une faille scénaristique devient alors une trouvaille. Les scènes phares de son existence amoureuse et artistique deviennent alors autant de tableaux de l'existence de celui qui était d'abord destiné à la peinture. Les décors, de l'appartement de Dali à celui de la rue de Verneuil, sont poétiquement retranscrits, entre la réalité et le conte. « Ce ne sont pas les vérités de Gainsbourg qui m'intéressent mais ses mensonges » précise Joann Sfar. Tant mieux parce que les mensonges en disent finalement certainement davantage sur la vérité de son être.
Sans tomber dans la psychologie de comptoir, par touches subtiles, Sfar illustre comment ses blessures d'enfant portant l'étoile jaune intériorisées expliquent sa recherche perpétuelle de reconnaissance d'un pays qui l'a parfois mal compris et quand même adopté, qu'il provoquait finalement par amour (notamment avec sa fameuse "Marseillaise"). Comment Gainsbourg est toujours resté ce Lucien Ginsburg, éternel enfant rebelle.
Le risque était aussi de faire chanter les comédiens avec leurs propres voix, une réussite et puis évidemment il y a la musique et les textes de Gainsbourg, génie intemporel, poète provocateur d'une sombre élégance. Paris audacieux et gagnés pour ce premier film prometteur.
Si comme moi vous aimiez Gainsbourg l'insoumis, ses textes et ses musiques, vous retrouverez avec plaisir son univers musical, et dans le cas contraire nul doute que ce conte vous emportera dans la magie poétique et captivante de cette vie héroïque.