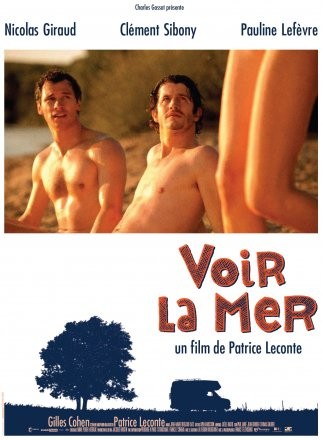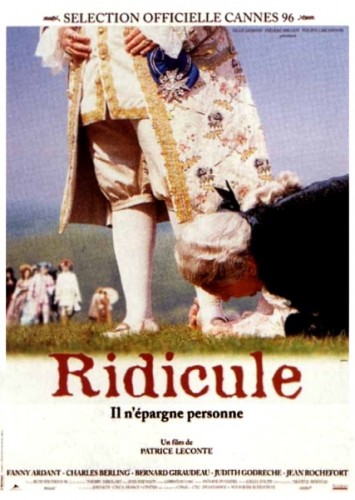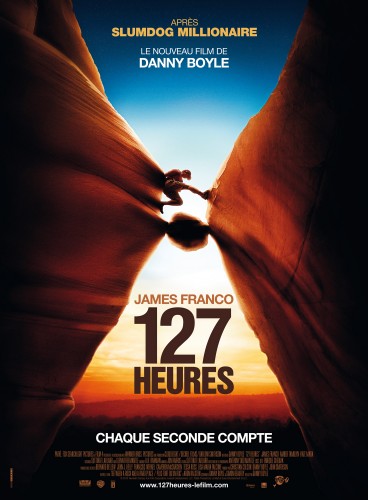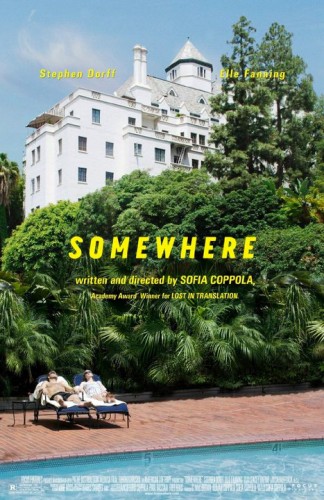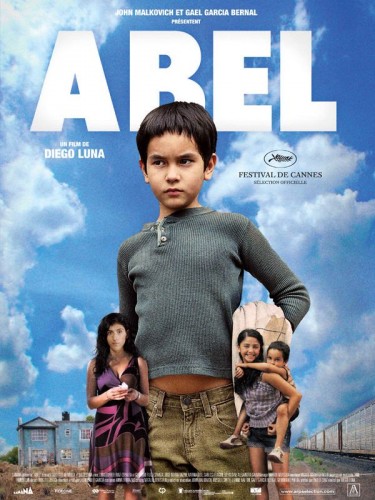Avant-première - Critique de « Harry Potter et les reliques de la mort - 2ème partie » de David Yates avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Alan Rickman …
L’heure est donc venue : celle du dernier épisode, celle de l’affrontement final, celle de l’ultime corps-à-corps entre le bien et le mal, celle du dénouement d’une saga cinématographique qui nous aura tenus en haleine pendant 8 films et pendant10 ans. L’heure de « Harry Potter et les reliques de la mort, 2ème partie ».
Très loin de l’univers coloré des débuts, les premières images donnent le ton. Harry Potter (Daniel Radcliffe) sur la tombe de l’Elfe Dobby. Face à la mort. Celle qu’il devra affronter plus que jamais. Harry doit ainsi maintenant retrouver les 4 Horcruxes, fragments de l’âme de Voldemort grâce auxquels ce dernier a enfermé son âme dans sa quête pour l’immortalité, et les détruire. Voldemort possède l’un d’eux : la baguette de Sureau (qui, avec la pierre de Résurrection et la Cape d’Invisibilité, rendent immortel celui qui les détient toutes trois) réputée comme étant la baguette magique la plus puissante au monde. Trois Horcruxes ont déjà été détruits mais il en reste quatre. Commence alors une ultime course contre le temps et contre la mort pour Harry Potter et ses amis Ron Weasley (Rupert Grint) et Hermione Granger (Emma Watson).
Comment clore une histoire qui a retenu notre souffle pendant tant d’années ? Comment dire adieu à des personnages qui nous ont accompagnés si longtemps ? Par ce qui fait la richesse d’Harry Potter : par un mélange subtil d’émotions poignantes et de spectacle époustouflant et en portant les deux à leur paroxysme, et en nous faisant frissonner de jubilation avec l’un et l’autre. En effet, jamais le spectacle ne se fait au détriment de la psychologie des personnages, d’une complexité rare pour un film d’action (même si Harry Potter est très loin de n’être que cela.) Certes le combat est manichéen, le Bien incarné par Harry Potter et ses amis face au Mal absolu incarné par Voldemort, mais les personnages (à l’exception de ce dernier) eux, ne le sont pas.
Dès le début de ce dernier volet, la sombre beauté des décors (couleurs grisâtres et glaciales d’un théâtre de guerre, spectacle de chaos et de désolation) nous immerge dans une noirceur aussi réjouissante qu’inquiétante et, si la 3D n’y nuit pas, elle n’est pas nécessaire tant cet univers se suffit à lui-même, le recours à la 3D étant d’ailleurs un contre-sens tant « Harry Potter » est une ode au pouvoir de l’imagination et de l’ingéniosité et en particulier ce dernier volet. ( « Ce n’est pas parce que c’est dans ta tête que ce n’est pas réel » lui dit ainsi son mentor).
Plus qu’un simple divertissement abêtissant comme ce à quoi se réduisent de nombreux films d’action (je viens de voir « Super 8 », ceci expliquant peut-être cela, mais j’y reviendrai), est un parcours et une quête initiatiques mais aussi un hymne au courage (évidemment à travers les personnages d’Harry Potter, d’Hermione et Ron mais ici également à travers des personnages comme Neville qui prend une belle ampleur), à l’amitié, à l’amour, à la loyauté (confiance indéfectible d’Harry Potter pour Dumbledore), à la persévérance, à la tolérance ( cf le premier volet des « Reliques de la mort » avec ses « indésirables », ses « rafleurs » et l’extermination souhaitée par Voldemort des « Sang-de-bourbe » -sorciers nés de moldus, donc des non-sorciers, donc rejetés en raison de leurs différences- donnant à voir une lecture historique nous ramenant une soixantaine d’années en arrière.) Hymne aussi à la détermination comme en témoigne l’affiche qui met en scène un Harry Potter en avant, face à la mort et son destin, le regard frondeur, sur un champ de ruines. L’émotion culmine ainsi lors d’un magnifique flashback d’une force émotionnelle incontestable qui fait apparaitre le Professeur Rogue comme le personnage le plus complexe et intéressant et celui qui finalement illustre le mieux tous ces thèmes évoqués précédemment.
Dans cet affrontement final, Harry Potter doit affronter évidemment Voldemort mais aussi le passé et la mort, se délester du poids de ce passé, affronter le danger plutôt que fuir, pour aller vers l’avenir et devenir, enfin vraiment : adulte. Tout comme la magie de l’enfance s’évanouit au fur et à mesure que les années s’écoulent, Poudlard s’effondre et, avec, périclite la magie de l’enfance. Harry Potter en aura parcouru du chemin entre « l’apprenti sorcier » et « les reliques de la mort », entre l’enfant qui découvrait cet univers enchanteur et l’adulte qui le verra s’effondrer, lors d’un combat mortel.
L’humour reste néanmoins présent par petites touches et « Harry Potter » n’en oublie pas d’être ludique pour le spectateur…et pour les acteurs dont la qualité du jeu a grandi avec leurs rôles pour les plus jeunes d’entre eux comme celui d’Emma Watson comme en témoigne la scène où la prude Hermione devient l’arrogante Bellatrix. Le spectacle n’en oublie pas non plus d’être jubilatoire (montagnes russes, dragons géants crachant le feu…) jouant habilement avec nos désirs (voler) et nos peurs (géants, araignées, obscurité) d’enfance. Et si, comme dans le pénultième film, on regarde sa montre, ce n’est pas par ennui mais avec le vain espoir de retarder le moment fatidique, et forcément un peu triste, où cet ultime voyage fantastique et magique (au propre comme au figuré) va devoir s’achever et la réalité reprendre ses droits.
Un dernier périple, époustouflant, grisant, d’une noirceur éblouissante, à couper le souffle, épique et même parfois lyrique, nostalgique (de nombreux personnages reviennent dans ce dernier film parfois juste le temps d’une scène) et mélancolique dont les dernières minutes trop fades, décevantes, et mièvres (mais fidèles au roman), n’arriveront pas à éclipser le souvenir de ce dernier film d’une beauté sombre renversante, ni la puissance visuelle et émotionnelle de cet affrontement final porté par des décors d’une somptueuse noirceur, par la musique d’Alexandre Desplat qui apporte encore une fois sa touche magique, d’émotion ou de suspense, par un scénario qui allie savamment émotion et action, et par des acteurs impliqués. Du grand et beau spectacle. Et surtout…surtout… un magnifique hommage au pouvoir des mots et de l’imagination.
CONCOURS : Et pour célébrer la sortie du film en salles, ce 13 juillet, je vous offre un 2ème DVD de « Harry Potter et les reliques de la mort- 1ère partie ». Pour le remporter, trouver un slogan à cet « affrontement final ». Le meilleur slogan le remportera. Réponses à envoyer à inthemoodforcinema@gmail.com avec, pour intitulé « Concours Potter ». Fin du concours le jour de la sortie du film.