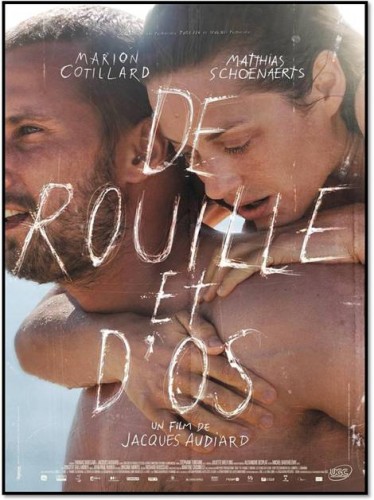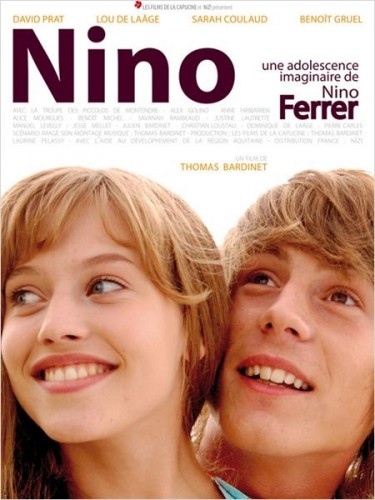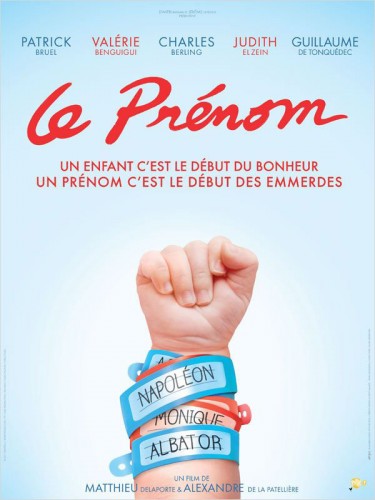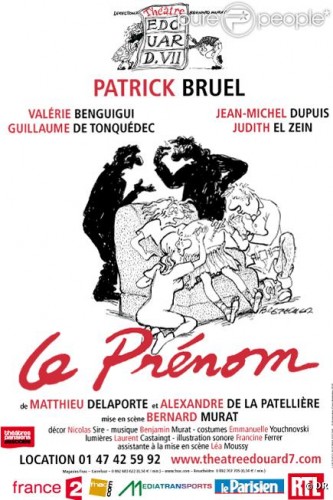Personne encore n’avait eu l'audace ou l'inconscience de s’attaquer au mythe ultime du cinéma dont le prénom seul suffit à l’identifier, Marilyn, alors que, pourtant les biopics fleurissent ces dernières années et même ces dernières semaines ( après « Cloclo » récemment encore). Le seul qui m’ait vraiment enthousiasmée pour l’instant est le « Gainsbourg vie héroïque » de Joann Sfar qui n’est pas une simple transcription sur l’écran de l’existence du chanteur mais une audacieuse et poétique entreprise artistique (voir ma critique ici). Employer le terme de biopic pour « My week with Marilyn » est d’ailleurs inexact puisqu’il s’agit d’une manière plus ou moins habile de le contourner en ne racontant qu’une semaine de la vie de cette dernière.
Cette semaine se déroule au début de l’été 1956 lorsque Marilyn Monroe (Michelle Williams) se rend en Angleterre pour la première fois pour tourner « Le Prince et la danseuse », réalisé par Sir Laurence Olivier (Kenneth Branagh) qui en interprétait aussi le rôle principal, ou la rencontre de deux légendes, l’une du théâtre, l’autre du cinéma qui ne rêvaient finalement d’être que ce que l’autre était (une actrice reconnue pour son talent pour Marilyn, une star pour Sir Laurence Olivier). Marilyn vient de se marier avec le dramaturge Arthur Miller (Dougray Scott). Ce même été, le jeune Colin Clark (Eddie Redmayne), âgé de 23 ans, ne rêve que de découvrir les coulisses d’un tournage de cinéma. Il parvient ainsi à se faire employer comme assistant sur le plateau.
« My week with Marilyn » est adapté de deux livres de Colin Clark « The Prince, the Showgirl and Me » et d’un livre éponyme.
Quel plus beau et à la fois plus impossible personnage de cinéma que Marilyn qui était elle-même, déjà, un personnage dans la vie puisqu’elle interprétait constamment un rôle, se mettant en scène, maquillant son vrai visage (dans tous les sens du terme) ? Le film commence et s’achève sur une image de Marilyn sur l’écran…et ne s’en détachera d’ailleurs guère. Si c’est bien à celle qui se dissimulait derrière ce masque que le film s’attache, il ne parvient pourtant jamais à s’éloigner des clichés se contentant au contraire de les aligner (dans les deux sens du terme, des clichés sur sa personnalité à ceux, visuels, qui l'ont immortalisée).
Velléitaire et déterminée, forte et si fragile, éblouissante et égarée, entourée et si seule, tellement observée et incomprise, orgueilleuse et doutant d’elle-même, enfantine et incarnation suprême de la féminité, manipulatrice et manipulée : Marilyn réunit tous les (fascinants) paradoxes des artistes et les porte à leur paroxysme. De bien belles images dont le film ne parvient jamais à s’éloigner expliquant seulement son besoin d’amour immodéré, sa fragilité et ses failles, sommairement, par le manque de sa mère.
Une vraie fiction sur une artiste « quelconque » aurait été à mon sens beaucoup plus intéressante que ce biopic qui tente, maladroitement, de contourner les règles du genre. Il est vrai que Mankiewicz avec « La Comtesse aux pieds nus » et « Eve » (dans lequel jouait d’ailleurs une certaine Marilyn) avait déjà tout et magnifiquement dit.
Forcément ici tout souffre de la comparaison. Comparaison avec ces films dans lesquels Marilyn irradiait. Comparaison avec son inimitable phrasé et démarche que, malgré son talent et ses efforts, Michelle Williams n’atteindra jamais oscillant entre un mimétisme parfois réussi (lorsqu’elle danse), et parfois frôlant le grotesque (lorsqu’elle minaude).
Si la mise en scène très classique (voix off de rigueur…) relève du téléfilm (Simon Curtis, le réalisateur, vient d’ailleurs de la télévision), la bande originale (Johnny Ace, Nat King Cole, Dean Martin et la composition d’Alexandre Desplat), la touchante naïveté du personnage de Colin (belle découverte que Eddie Redmayne) totalement ébloui et sincèrement touché par la fragilité de Norma Jean et soucieux de la protéger, et la présence toujours charismatique de Judi Dench sauvent le film (contrairement à la terrible erreur de casting de Julia Ormond en Vivien Leigh).
Le seul intérêt de ce film s’inscrivant dans la mouvance actuelle d’un cinéma nostalgique et du biopic (et qui ne prend guère de risques en s’assurant l’intérêt du public acquis à la cause du personnage) est finalement de nous donner envie de revoir les films avec Marilyn, et notamment “Le Prince et la Danseuse” dont les scènes de tournage sont recréées ici (avec la présence étouffante de Paula Strasberg).
Un jeu de mise en abyme et de mimétisme décevant qui ne fait que renforcer le mystère fascinant des artistes dont Marilyn incarnait si bien les troublants paradoxes et que le film de Michel Hazanavicius décrit magnifiquement en mettant en scène la solitude et l’orgueil dévorants des artistes dans "The Artist". Revoyez plutôt « The Artist » ou « La Comtesse aux pieds nus ».
Remarque: Marilyn Monroe figure aussi sur l'affiche du 65ème Festival de Cannes. Retrouvez mon article à ce sujet, ici.
Critique de « La Comtesse aux pieds nus » en bonus ci-dessous.

Ce film fait partie de mes premiers souvenirs cinématographiques, des premiers films m’ayant marquée, en tout cas, et que je n’avais pas revu depuis un moment : « La Comtesse aux pieds nus » (en vo « The Barefoot Contessa »), un film de 1954 de Joseph L.Mankiewicz, écrit, réalisé et produit par Joseph L.Mankiewicz (avec Franco Magli, pour la production), ce qui est loin d’être un simple détail puisque « La Comtesse aux pieds nus » est la première production de Joseph L.Mankiewicz qui s’était ainsi affranchi de la tutelle des grands studios américains (Il avait auparavant réalisé des films pour la 20th Century-Fox et pour la Metro-Goldwyn-Mayer.) en fondant sa propre société « Figaro Inc. ».

Ce film fit parler de lui bien avant sa sortie en raison des similitudes du scénario avec la vie de Rita Hayworth (star de la Columbia) parmi d’autres similitudes frappantes avec le cinéma d’alors comme la ressemblance entre l’antipathique Kirk Edwards et Howard Hughes. Le rôle fut même proposé à Rita Hayworth qui, en raison de la ressemblance avec sa propre existence justement, refusa.
« La Comtesse aux pieds nus » débute, en Italie, un sinistre jour de pluie à l’enterrement de la star hollywoodienne Maria d’Amato née Maria Vargas (Ava Gardner). Le scénariste et réalisateur Harry Dawes (Humphrey Bogart) se souvient de leur première rencontre alors qu’elle travaillait comme danseuse, dans un cabaret de Madrid, alors que ce dernier cherchait une nouvelle vedette pour le compte du producteur et milliardaire Kirk Edwards (Warren Stevens). Face à la statue de Maria, aux pieds symboliquement dénudés, alternent ensuite les récits d’Oscar Muldoon (Edmond O’Brien), l’agent de publicité, de Harry Dawes et de son mari, le comte Vincenzo Torlato-Favrini (Rossano Brazzi) qui dissimule un douloureux secret…à cause duquel Maria perdra ses dernières illusions, et la vie.

Dès le départ, le récit est placé sous le sceau de la fatalité et de la tragédie. La pluie implacable. L’enterrement sous un ciel grisâtre. L’atmosphère sombre. La voix poignante et traînante d’Humphrey Bogart. Cette statue incongrue, d’une blancheur immaculée. La foule qui se presse, vorace, pour assister à sa dernière scène, ultime cynique ironie du destin pour Maria, éprise d’absolu et de liberté, qui voit même son enterrement lui échapper, en tout cas l’enfermer dans un rôle, chacun, là encore, cherchant à se l’approprier.
Au-delà de ses ressemblances avec des personnalités ayant réellement existé, « La Comtesse aux pieds nus » est un classique pour de nombreuses raisons, à commencer par l’originalité de sa construction, ses flashbacks enchâssés qui permettent d’esquisser un portrait de Maria qui, malgré tout, reste d’une certaine manière insaisissable. Ces récits sont encore une fois une manière de se l’approprier, de l’enfermer, de décrire « leur » Maria même si Harry Dawes lui voue une amitié sincère, seul personnage réellement noble, désintéressé, au milieu de ces univers décadents. Mankiewicz avait déjà utilisé ce procédé dans « Eve », autre chef d’œuvre sans concessions, sur l’univers du théâtre cette fois, et démonstration cruelle mais terriblement juste sur l’arrivisme (j’en ai observé un rayon dans ce domaine…).
Mankiewicz décrit en effet, à travers le parcours de Maria (trois portraits d’une même femme) trois univers distincts : celui du cinéma hollywoodien, des grandes fortunes sur la Riviera et de l’aristocratie italienne, trois univers à la fois dissemblables et semblables dans leur décadence, tous trois théâtres de faux-semblants, de lassitude et de désenchantement. Maria, si lumineuse, semble égarée dans ces mondes qui l’emprisonnent.
Mankiewicz définissait « La Comtesse aux pieds nus » comme une « version amère de Cendrillon ». Il multiplie ainsi les symboles, clins d’œil au célèbre conte de fée : les chaussures (mais qui ici sont haïes par Maria pour qui elles symbolisent la boue à laquelle elle a voulu échapper), son rêve d’amour idéalisé, son mariage avec un comte (mais pas vraiment de conte puisqu’il s’avèrera être une tragédie). Le rêve se transforme constamment en amertume jusqu’à sa mort, jusqu’au dernier plan, dans ce cimetière, où, statufiée, emprisonnée dans une image infidèle, elle reste seule face à la foule qui s’éloigne et au cinéma qui reprend ses droits.

La photographie (du chef opérateur anglais Jack Cardiff) même (à l’exception des images de l’enterrement) rappelle les couleurs chatoyantes d’un conte de fée, ce qui n’en fait pas pour autant un film suranné mais, au contraire, en fait une oeuvre particulièrement intemporelle dans la description de ces univers, éternels théâtres de vanités même si Mankiewicz dira que « le prince charmant aurait dû, à la fin, se révéler homosexuel, mais je ne voulais pas aller aussi loin » , limitant la modernité du film (même si deux plans y font référence) mais aussi dans la description de la solitude de l’artiste, auréolé de mystère.
La mise en abîme, les flashbacks, l’intelligence des ellipses, la qualité de la voix off, la juste description de théâtre de faux semblants, les similitudes avec la réalité du cinéma hollywoodien de l’époque, tout cela en fait un classique mais, sans doute, sans les présences d’Humphrey Bogart et d’Ava Gardner n’aurait-il pas laissé une telle empreinte dans l’histoire du cinéma. Le premier interprète à la perfection ce personnage doucement désenchanté, mélancolique, lucide, fidèle, intègre, à la fois figure paternelle, protectrice et même psychanalyste de Maria. Et que dire d’Ava Gardner ? Resplendissante, étincelante, elle illumine le film, empreinte, à l’image de celui-ci, de beauté tragique, et symbolise la liberté entravée. Personnage de conte de fée aux rêves brisés pour qui rien ne semblait impossible, même transformer la lune en projecteur et qui, peut-être, n’aura été heureuse et elle-même que l’espace d’une danse, sublime et qu’elle sublime, au milieu de gitans, bohême, libre, animale, sensuelle, et l’instant d’un regard croisé ouvrant sur un océan de possibles.
Ne pas oublier non plus Edmond O’Brien qui reçut l’Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle masculin, en 1954. Mankiewicz fut, quant à lui, nommé pour la meilleure histoire et le meilleur scénario original.
En revoyant « La Comtesse aux pieds nus », des années après l’avoir revu de nombreuses fois, j’ai à nouveau été marquée par sa beauté désespérée, par sa justesse, et même par sa modernité, par la voix traînante et inimitable de Bogart, par l’élégance lumineuse et triste d’Ava Gardner, par le mystère de ce personnage noble épris d’absolu, être insaisissable et « féérique», presque irréel, dont, finalement, personne ne sondera les contours. Che sara sara : ce qui doit être sera, vieux dicton italien cité dans le film aux allitérations et assonances (et évidemment à la signification) portant la même beauté traînante et mélancolique que cette « Comtesse aux pieds nus » au destin fatal et à la magie tragique et non moins ensorcelante.
Retrouvez également cet article sur mon nouveau blog "In the mood - Le Magazine": http://inthemoodlemag.com/2012/04/14/critiques-my-week-with-marilyn-de-simon-curtis-et-la-comtesse-aux-pieds-nus-de-mankiewicz/