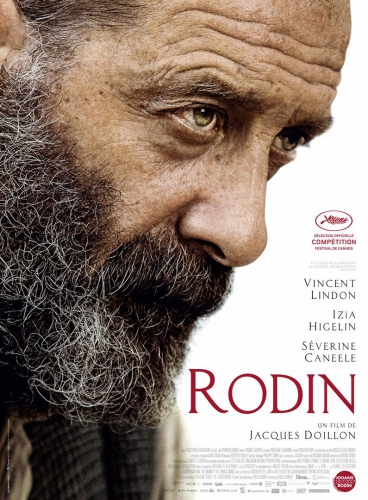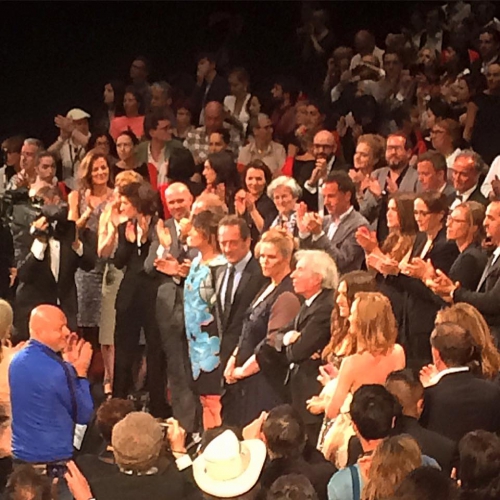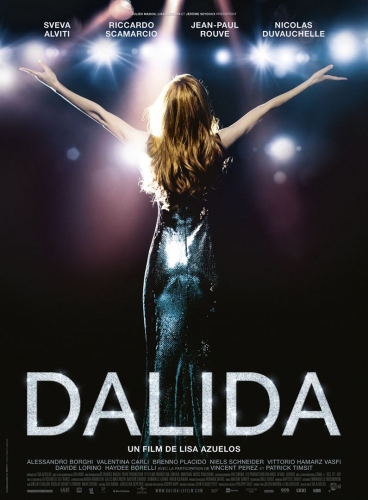J’ai vu ce film il y a une dizaine de jours et j’ai attendu pour vous en parler me disant que, peut-être, la magie qui n’a pas opéré lors de la projection se révèlerait à moi a posteriori… Alors ?
Le synopsis d’abord. «La La Land » nous emmène au cœur de Los Angeles, et suit deux personnages : une actrice en devenir prénommée Mia (Emma Stone) qui, entre deux castings, sert des boissons à des actrices dans la cafétéria où elle travaille, située dans les célèbres studios de la vil et Sebastian (Ryan Gosling), passionné de jazz et talentueux musicien, qui est contraint de jouer la musique d’ascenseur qu’il déteste pour assurer sa subsistance. Elle rêve de rôles sur grand écran. Lui de posséder son propre club de jazz. Elle aime le cinéma d’hier, lui le jazz qui, par certains, est considérée comme une musique surannée. Ces deux rêveurs mènent pourtant une existence bien loin de la vie d’artistes à laquelle ils aspirent… Le hasard les fait se rencontrer sans cesse, dans un embouteillage d’abord, dans un bar, et enfin dans une fête. Ces deux idéalistes tombent amoureux…
Le film débute par un plan séquence virevoltant, jubilatoire, visuellement éblouissant. Sur une bretelle d’autoroute de Los Angeles, dans un embouteillage qui paralyse la circulation, une musique jazzy s’échappe des véhicules. Des automobilistes en route vers Hollywood sortent alors de leurs voitures, soudain éperdument joyeux, débordants d’espoir et d’enthousiasme, dansant et chantant leurs rêves de gloire. La vue sur Los Angeles est à couper le souffle, la chorégraphie millimétrée est impressionnante et d’emblée nous avons envie de nous joindre à eux, de tourbillonner, et de plonger dans ce film qui débute par ces réjouissantes promesses. A ma grande déception, rien n’égalera ensuite cette scène époustouflante.

Après ses 7 récompenses aux Golden Globes, « La La Land » totalise 14 nominations aux Oscars : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure chanson... Deux films seulement avaient auparavant atteint un tel nombre de nominations, « Titanic » de James Cameron en 1997 et « Eve » de Joseph L. Mankiewicz en 1951, un chef-d’œuvre passionnant, tableau cruel et lucide de la vie d’actrice. Décidément, les Oscars affectionnent les films sur le cinéma.

Le cinéma affectionne la mise en abyme, ce qui a d’ailleurs souvent produit des chefs d’œuvre. Il y a évidemment « La comtesse aux pieds nus » de Mankiewicz, « Etreintes brisées » de Pedro Almodovar « La Nuit américaine de Truffaut », « Sunset Boulevard » de Billy Wilder, « Une étoile est née » de George Cukor et encore « Chantons sous la pluie » de Stanley Donen et Gene Kelly, deux films auxquels « The Artist » de Michel Hazanivicius se référait également. Le film de Stanley Donen et Gene Kelly (comme beaucoup d’autres et comme le cinéma de Demy) est aussi largement cité dans « La la land » (comme dans la photo ci-dessous). Les points communs sont également nombreux entre La la land et « The Artist ».

« The Artist » raconte ainsi l’histoire de George Valentin (Jean Dujardin), une vedette du cinéma muet qui connait un succès retentissant…mais l’arrivée des films parlants va le faire passer de la lumière à l’ombre et le plonger dans l’oubli. Pendant ce temps, une jeune figurante, Peppy Miller (Bérénice Béjo) qu’il aura au départ involontairement placée dans la lumière, va voir sa carrière débuter de manière éblouissante. Le film raconte l’histoire de leurs destins croisés. Comme « La la land », « The Artist » est un hommage permanent et éclatant au cinéma. Hommage à ceux qui ont jalonné et construit son histoire, d’abord, évidemment. De Murnau à Welles, en passant par Borzage, Hazanavicius cite brillamment ceux qui l’ont ostensiblement inspiré. Hommage au burlesque aussi, avec son mélange de tendresse et de gravité, et évidemment, même s’il s’en défend, à Chaplin qui, lui aussi, lui surtout, dans « Les feux de la rampe », avait réalisé un hymne à l'art qui porte ou détruit, élève ou ravage, lorsque le public, si versatile, devient amnésique, lorsque le talent se tarit, lorsqu’il faut passer de la lumière éblouissante à l’ombre dévastatrice. Le personnage de Jean Dujardin est aussi un hommage au cinéma d’hier : un mélange de Douglas Fairbanks, Clark Gable, Rudolph Valentino, et du personnage de Charles Foster Kane (magnifiques citations de « Citizen Kane ») et Bérénice Béjo, avec le personnage de Peppy Miller est, quant à elle, un mélange de Louise Brooks, Marlène Dietrich, Joan Crawford…et nombreuses autres inoubliables stars du muet. Michel Hazanavicius signe là un hommage au cinéma, à sa magie étincelante, à son histoire, mais aussi et avant tout aux artistes, à leur orgueil doublé de solitude, parfois destructrice. Des artistes qu’il sublime, mais dont il montre aussi les troublantes fêlures et la noble fragilité. Parce qu’il est burlesque, inventif, malin, poétique, et touchant. Parce qu’il montre les artistes dans leurs belles et poignantes contradictions et fêlures. Rarement un film aura aussi bien su en concentrer la beauté simple et magique, poignante et foudroyante. Foudroyante comme la découverte de ce plaisir immense et intense que connaissent les amoureux du cinéma lorsqu’ils voient un film pour la première fois, et découvrent son pouvoir d’une magie ineffable, omniprésente ici.

Malheureusement je n’ai pas été foudroyée par « La La Land ». Bien sûr, les hommages à l’âge d’or de la comédie musicale se multiplient. Sebastian tournoie admirablement autour d’un lampadaire, référence revendiquée à « Singing in the rain ». Et les deux amoureux s’envolent dans les airs comme dans « Moulin rouge ». Deux exemples parmi tant d’autres. Chazelle, au-delà de la comédie musicale, rend aussi hommage à l’âge d’or hollywoodien tout entier notamment avec la scène de l’Observatoire Griffith, clin d’œil au chef-d’œuvre de Nicholas Ray, « La Fureur de vivre ». Et Mia cite « L’impossible Monsieur bébé », « Les Enchaînés », « Casablanca » sans parler de la réalisation qui rend elle aussi hommage au cinéma d’hier, fermeture à l’iris y comprise.


Si j’ai fait cette parenthèse, c’est en raison des nombreux points communs entre les deux films, deux films qui ont eu les honneurs des Oscars, et si le film de Michel Hazanavicius m’a transportée, emportée, enthousiasmée, même après de nombreux visionnages, celui de Damien Chazelle m’a souvent laissée au bord de l’autoroute…au point même (ce qui ne m’arrive quasiment jamais au cinéma) de parfois m’ennuyer. Paradoxalement, le film en noir et blanc de Michel Hazanavicius m’aura semblé plus étincelant que le film si coloré de Damien Chazelle. J’avais pourtant sacrément envie de les aimer ces deux rêveurs idéalistes, guidés par un amour et des aspirations intemporels.
C'est la troisième fois que Ryan Gosling et Emma Stone sont partenaires de jeu au cinéma après « Crazy, Stupid, Love » et « Gangster Squad ». Ici, c’est Emma Stone qui crève littéralement l’écran comme c’était d’ailleurs déjà le cas dans les films de Woody Allen « Magic in the moonlight » et « L’homme irrationnel ». Ici, elle est remarquable, notamment dans les scènes de casting, lorsqu’elle est écoutée d’une oreille distraite alors que le « casteur » regarde un assistant lui faire des signes derrière la porte tandis que face caméra elle passe d’une émotion à l’autre, et montre toute l’étendue de son talent, indéniable. Une des très belles scènes du film, d’ailleurs. Ryan Gosling réalise lui aussi une performance impressionnante ayant appris tous les morceaux de piano du film.

Damien Chazelle montre et transmet une nouvelle fois sa fascination pour le jazz, mais aussi pour les artistes qui endurent souffrances et humiliations pour tenter de réaliser leurs rêves. « Whiplash », le film précédent de Damien Chazelle, notamment couronné au Festival du Cinéma Américain de Deauville, est ainsi exemplaire dans sa précision et l’exigence à l’image de la musique qu’il exalte et sublime. Comme son personnage, Andrew Nieman (à une lettre près Niemand, personne en Allemand) qui semble avoir une seule obsession, devenir quelqu’un par la musique. Assouvir sa soif de réussite tout comme le personnage interprété par J.K Simmons souhaite assouvir sa soif d’autorité. Une confrontation explosive entre deux desseins, deux ambitions irrépressibles, deux folies. La réalisation s’empare du rythme fougueux, fiévreux, animal de la musique, grisante et grisée par la folie du rythme et de l’ambition, dévastatrice, et joue judicieusement et avec manichéisme sur les couleurs sombres, jusque dans les vêtements: Fletcher habillé en noir comme s’il s’agissait d’un costume de scène à l’exception du moment où il donne l’impression de se mettre à nu et de baisser la garde, Andrew habillé de blanc quand il incarne encore l’innocence puis de noir à son tour et omniprésence du rouge (du sang, de la viande, du tshirt d’un des « adversaires » d’Andrew) et des gros plans lorsque l’étau se resserre, lorsque le duel devient un combat impitoyable, suffocant. Le face à face final est un véritable combat de boxe (et filmé comme tel) où l’immoralité sortira gagnante : la dictature et l’autorité permettent à l’homme de se surpasser… La scène n’en est pas moins magnifiquement filmée transcendée par le jeu enfiévré et exalté des deux combattants.
Etrange critique me direz-vous que la mienne qui consiste à parler d’autres films pour donner mon opinion sur celui-ci. Peut-être, justement, parce que de là provient ma déception, après l’électrique et captivant « Whiplash » qui déjà évoquait -magnifiquement- les ambitions artistiques de ses personnages, et malgré tous les chefs-d’œuvre auxquels il se réfère ce « La La Land » ne m’a pas projetée dans les étoiles malgré la caméra virevoltante qui, constamment, cherche à nous étourdir et à nous embarquer dans sa chorégraphie.
Les personnages secondaires, comme le scénario, manquent à mes yeux de consistance pour être totalement convaincants. Sans doute me rétorquera-t-on que Mia et Sebastian sont tout l’un pour l’autre, et que le reste du monde n’existe pas pour eux et n’existe donc pas pour le spectateur. Si j’ai cru à l’amour de l’art de ces deux-là, je n’ai pas réussi à croire en leur histoire d’amour. Certes la sympathique mélodie composée par Justin Hurwitz nous trotte dans la tête longtemps après la projection. Certes le travail sur le son est intéressant et les transitions sont habiles (comme ce bruit de klaxon qui succède à celui du four qui siffle à nous percer les tympans). Certes certaines scènes sont particulièrement réussies (la scène d’ouverture, les castings de Mia, les plans de Sebastian jouant dans un halo de lumière, ou encore cet échange de regards chargés de regrets et, peut-être, de possibles).
Le film devient d’ailleurs intéressant vers la fin quand il évoque cette dichotomie entre les rêves et la réalité, les idéaux et les concessions à son idéalisme que nécessite souvent la concrétisation de ses rêves (dont on réalise alors qu’ils n’étaient qu’illusion d’un bonheur dont la réalisation des rêves en question a nécessité l’abandon comme le montre la séquence - déjà vue ailleurs mais efficace- de ce qu’aurait été la vie si…).

Sans doute la nostalgie d’une époque insouciante, l’utopie de revivre une période révolue où les spectateurs allaient au cinéma pour voir des "vedettes" glamours interprétant des personnages sans aspérités (dont les noms sur l’affiche suffisaient à inciter les spectateurs à découvrir le film en salles), évoluant dans un monde enchanté et enchanteur à la Demy (sans les nuances de ses personnages, plus complexes), sans doute le besoin de légèreté (dans les deux sens du terme), sans doute la rencontre entre une époque troublée, sombre, cynique, et un mélo coloré, léger, lumineux expliquent-ils le succès retentissant de ce film aussi bien en salles qu’aux Golden Globes et dans ses nominations aux Oscars. Comme un feu d'artifice qui nous éblouirait et, un temps, occulterait la réalité. Je n’ai pas succombé au charme, pourtant certain, de "La la land", peut-être parce que, à la joie feinte et illusoire, je préfère la mélancolie (qui y affleure un peu tard), mais ce n’est pas une raison suffisante pour vous dissuader d'aller le voir...