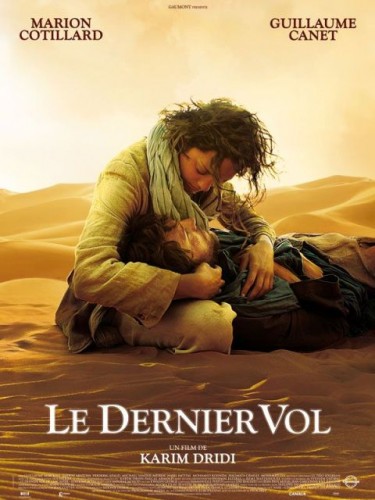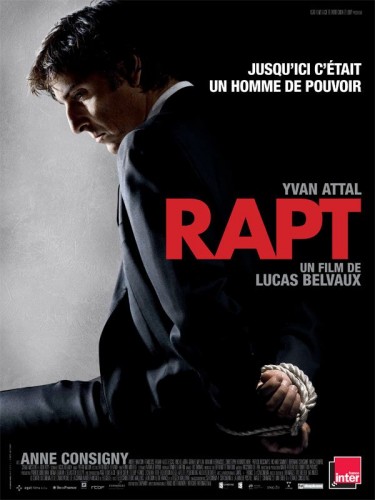"La Rafle" (critique du film et vidéos de la réalisatrice Rose Bosch): au-delà du cinéma...
Je vous ai déjà parlé de "La Rafle" lors de l'avant-première au siège de Gaumont, il y a quelques semaines, et je vous en parlerai à nouveau d'ici sa sortie, mercredi 10 mars prochain, simplement parce que je pense qu'un film comme celui-là est au-delà du cinéma, au-delà de ses qualités ou défauts (et je n'ai d'ailleurs pas dit qu'il en était dépourvu), qu'il est simplement nécessaire et les révoltants, incultes et odieux commentaires antisémites récemment retrouvés suite à ma critique ne font que me renforcer dans cette idée...
Retrouvez ci-dessous, ma critique du film, la vidéo de la réalisatrice Rose Bosch avant la projection ainsi que le récit de Joseph Weismann dont l'histoire est retracée dans le film.
Il y a une dizaine de jours, un irresponsable politique ou pseudo se gargarisait de ce qu'il considérait être comme une bonne plaisanterie à propos d'une salle trop exigüe pour son meeting : « La prochaine fois, on prendre le Vel d'Hiv » se réjouissait-il béatement. Scandalisée, je me suis dit que des politiques, eux responsables, allaient réagir. Rien. Alors, bien sûr, on peut toujours se dire qu'ils ont préféré ne pas s'abaisser à répondre à la provocation mais quand la provocation méprise l'horreur innommable et la mémoire de ceux qui l'ont vécue, je pense qu'il est coupable de ne pas réagir et qu'on s'élève au contraire à le faire. Là aussi, là déjà commence peut-être le devoir de mémoire, en ne laissant pas souiller un passé déjà tellement mis à mal, en ne laissant pas passer pour plaisanterie, certes déjà affligeante, pour ce qui est beaucoup plus : une négation abjecte de l'Histoire comme c'était le cas ici ou une ignorance de l'Histoire, comme cela risque d'être souvent le cas si on ne fait rien pour que cette mémoire demeure vive. C'est pour cette raison qu'un film comme « La Rafle », indépendamment de ses qualités et de ses défauts cinématographiques me semble avant tout nécessaire, même indispensable.
Rose Bosch, ancienne journaliste d'investigation, a donc décidé de réaliser un film sur la Rafle du Vel d'Hiv, un projet qu'elle porte depuis 5 ans.
Eté 1942. 16 et 17 juillet. Joseph a 11 ans et, comme 13000 autres juifs, ils sera raflé et emmené au Vélodrome d'Hiver. Entre le Vel d'Hiv et le camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, « La Rafle » suit les destins réels des victimes et des bourreaux. Tous les personnages du film ont existé, d'Annette (Mélanie Laurent, meilleure que jamais), l'infirmière dans le film qui, assistante sociale de la Croix rouge dans la réalité, sera reconnue comme Juste, à Jo (Joseph Weismann dans la réalité -voir son témoignage poignant en bas de cet article-), arrêté avec toute sa famille.
Rose Bosch, avec l'aide de Serge Klarsfeld est entrée en contact avec trois témoins encore vivants : l'un des pompiers du Vel d'Hiv, Joseph Weismann et Anna Traube. Tous les faits et « anecdotes » du film sont véridiques.
On se doute de la difficulté, de l'investissement, de l'engagement même quand on décide de traiter un tel sujet qui dépasse largement le cadre cinématographique... Comment dire l'indicible ? Comment représenter l'inconcevable ? Comment faire comprendre l'incompréhensible ? Comment représenter ce qui n'est pas envisageable ?
Malgré tout, cela demeure du cinéma, il fallait donc choisir un point de vue qui revêt ici une importance d'autant plus cruciale qu'il devait être au service de la vérité historique et du devoir de mémoire. Celui de Rose Bosch a été de privilégier le hors-champ et le point de vue des enfants. Un parti pris intéressant pour tenter de nous faire appréhender l'inimaginable. Les personnages disparaissent. Brutalement. Choc fracassant et violent. On ne sait rien ou presque de ce qu'ils adviennent comme c'était le cas à l'époque pour ces familles et ces pères de familles (très juste Gad Elmaleh) qui ne pouvaient imaginer l'impensable et l'insoutenable. Ils s'évanouissent dans un effroyable silence. Représenter l'horreur aurait de toute façon été en-deçà et infidèle à la réalité.
L'innocence des enfants, leur ignorance de ce qui se passe renforce encore la brutalité, l'inhumanité mais aussi l'absurdité de cette tragédie d'autant que les jeunes acteurs sont tous remarquables. La promiscuité, la contagion, la terreur, les suicides qui furent la réalité du Vel d'Hiv sont là aussi essentiellement hors-champ. Tout cela est en partie invisible comme cela était incompréhensible pour ceux qui vivaient cette tragédie, a fortiori les enfants.
Les scènes de rafle, le déchirement des enfants séparés de leurs parents sont bouleversantes. Cette impression d'urgence, de chaos et de folie est renforcée par la caméra à l'épaule et contraste avec les scènes qui précèdent dans un Montmartre où résonnent des airs joyeux. Ces différences de dispositifs de filmage permettent aussi de bien saisir les contrastes révoltants, entre Hitler qui se goinfrait au Berghof tandis qu'au Vel d'Hiv on ne mangeait pas à sa faim, entre Bousquet et/ou Pétain et/ou Laval qui discutaient tranquillement de milliers de vies envoyées à la mort comme d'une vulgaire question pratique et ceux qui luttaient pour vivre.
Mais « La Rafle » c'est aussi le parti pris d'évoquer la collaboration française que l'on a si longtemps minimisé, et en particulier celle qui a conduit au Vel d'Hiv, un Vel d'Hiv méticuleusement préparé et planifié dont la contrepartie pour Vichy était notamment le contrôle de la police française. Une rafle réalisée par des fonctionnaires de police français. 7000 hommes y ont ainsi participé. Mais Rose Bosch a aussi choisi de rendre hommage aux Justes, notamment à travers le personnage de l'infirmière Annette, de montrer que l'humanité et l'inhumanité ont, l'une et l'autre, dévoilé leurs visages extrêmes. S'il ne faut pas oublier la responsabilité de la France, il ne faut pas oublier non plus que sur 25000 juifs qui étaient destinés au Vel d'Hiv et qui figuraient sur les fichiers de la préfecture, 12000 furent sauvés, sans doute avec l'aide d'autres Français.
Le seul vrai bémol concerne la musique excessive (en particulier à la fin) et redondante et surtout inutile quand le sujet comme celui-ci se suffit à lui-même, un bémol qui reflète la difficulté des choix quand on décide de traiter des faits réels par la fiction. La musique vient alors ajouter un élément de fiction supplémentaire, presque en contradiction avec le parti pris de la cinéaste (même défaut ou en tout cas même choix que dans « La Môme »- dont Ilan Goldman est aussi scénariste- qui force l'émotion là où elle surgit d'elle-même). De même, les scènes de « ceux qui ont orchestré » sont filmées et jouées avec trop d'emphase, le dispositif cinématographique venant s'ajouter à des scènes en elles-mêmes grandiloquentes et démentes de ces destins de milliers d'êtres humains décidés presque avec désinvolture par des criminels autour d'une table.
Un film qui n'en demeure pas moins indispensable car pédagogique (et qui, je pense, nécessite d'être vu dans les écoles mais avec beaucoup d'explications pour l'accompagner, pour expliquer ce hors-champ invisible et tu), évidemment poignant, notamment grâce à une excellente distribution (même Jean Reno, dans un contre-emploi).
Un film à l'issue de la projection duquel résonne un assourdissant silence mais qui a le grand mérite de donner de la voix à ceux qui se sont opposés mais aussi à des responsabilités trop longtemps tues et occultées. La responsabilité de la France dans la Shoah ne fut ainsi officiellement reconnue qu'en 1995, soit 50 ans après la fin de la guerre !
Pour que plus personne ne puisse dire ou même laisser dire la moindre « plaisanterie » sur le Vel d'Hiv. Pour que plus personne n'ignore ce que fut La Rafle du Vel d'Hiv. Pour que plus personne n'ignore ou ne méprise ceux qui l'ont planifié, ceux qui en ont été les victimes et ceux qui s'y sont opposés.
En complément, je vous conseillerais :
« Monsieur Klein » de Joseph Losey, démonstration implacable de l'absurdité effroyable de l'holocauste et en particulier du Vel d'Hiv. Ainsi que « La liste de Schindler », l'incontournable chef d'œuvre de Spielberg. Evidemment « Le Dictateur » de Chaplin, « Le Chagrin et La Pitié » de Marcel Ophüls, « Au revoir les enfants » de Louis Malle, « Nuit et brouillard » d'Alain Resnais, La vie est belle de Roberto Benigni. « Le Pianiste » de Roman Polanski. Sur la Résistance : « L'armée des ombres » de Jean-Pierre Melville
Vidéos de la présentation du film par sa réalisatrice Rose Bosch:
Sortie en salles : le 10 mars
J'ai également retrouvé ce texte de Joseph Weismann, un témoignage bouleversant sur la Rafle du Vel d'Hiv. Cliquez sur "lire la suite" pour le lire.