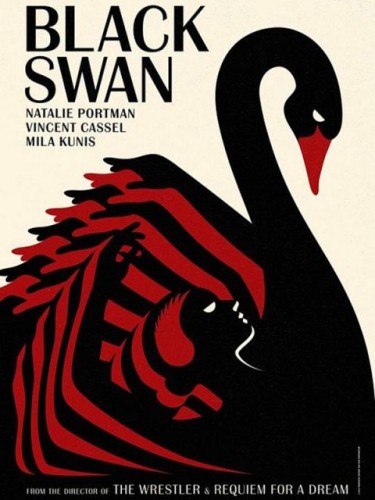La masterclass de Nathalie Baye au Gaumont Parnasse reportée au 25 janvier
 |
| Nathalie Baye © Maxime Bruno / Canal + |
Toujours dans le cadre du partenariat avec le Gaumont Parnasse, je vous proposais récemment de gagner vos places pour la master class d'une grande actrice française (et pour moi une des trois plus grandes) deux fois césarisée meilleure actrice française, pour "La Balance" et "Le Petit Lieutenant": Nathalie Baye.
Cette master class devait avoir lieu le 13 décembre à 20H et est reportée au 25 janvier, les gagnants pour le 13 restent les mêmes pour le 25 et bien entendu vous pourrez retrouver ici mon compte rendu de cette master class.
Filmographie de Nathalie Baye:
1972 : Brève rencontre à Paris de Robert Wise
1972 : Faustine et le Bel Été de Nina Companeez
1973 : La nuit américaine de François Truffaut
1974 : La Gueule ouverte de Maurice Pialat
1974 : La Gifle de Claude Pinoteau
1975 : Le Voyage de noces de Nadine Trintignant
1975 : Un jour, la fête de Pierre Sisser
1976 : Mado de Claude Sautet
1976 : La Dernière Femme de Marco Ferreri
1976 : Le Plein de super d'Alain Cavalier
1977 : L'Homme qui aimait les femmes de François Truffaut
1977 : Monsieur papa de Philippe Monnier
1977 : La Communion solennelle de René Féret
1978 : Mon premier amour de Elie Chouraqui
1978 : La Chambre verte de François Truffaut
1979 : La Mémoire courte de Eduardo de Gregorio
1979 : Sauve qui peut (la vie) de Jean-Luc Godard
1980 : Une semaine de vacances de Bertrand Tavernier
1980 : La Provinciale de Claude Goretta
1980 : Je vais craquer de François Leterrier
1981 : L'Ombre rouge de Jean-Louis Comolli
1981 : Une étrange affaire de Pierre Granier-Deferre
1981 : Beau-père de Bertrand Blier
1981 : Le Retour de Martin Guerre de Daniel Vigne
1982 : La Balance de Bob Swaim
1982 : J'ai épousé une ombre de Robin Davis
1984 : Notre histoire de Bertrand Blier
1984 : Rive droite, rive gauche de Philippe Labro
1984 : Détective de Jean-Luc Godard
1985 : Le Neveu de Beethoven de Paul Morrissey
1985 : Lune de miel de Patrick Jamain
1987 : En toute innocence de Alain Jessua
1987 : De guerre lasse de Robert Enrico
1989 : Le Roi blessé de Damiano Damiani
1989 : L'Affaire Wallraff de Bobby Roth
1989 : Gioco al massacro de Damiano Damiani
1990 : Le Pinceau à lèvres de Bruno Chiche
1990 : La Baule-les-Pins de Diane Kurys
1990 : Un week-end sur deux de Nicole Garcia
1991 : La Voix de Pierre Granier-Deferre
1992 : Mensonge de François Margolin
1992 : Le Visionarium de Jeff Blyth
1992 : Les Contes sauvages de Gérald Calderon
1994 : La Machine de François Dupeyron
1995 : La Mère de Caroline Bottaro
1996 : Enfants de salaud de Tonie Marshall
1997 : Paparazzi de Alain Berbérian
1998 : Food of Love de Stephen Poliakoff
1998 : Si je t'aime, prends garde à toi de Jeanne Labrune
1999 : Vénus beauté (institut) de Tonie Marshall:Angèle
1999 : Une liaison pornographique de Frédéric Fonteyne
2000 : Ça ira mieux demain de Jeanne Labrune
2000 : Selon Matthieu de Xavier Beauvois
2000 : Barnie et ses petites contrariétés de Bruno Chiche
2000 : Absolument fabuleux de Gabriel Aghion
2002 : Arrête-moi si tu peux (Catch Me if You Can) de Steven Spielberg:la mère de Léonardo Di Carprio
2002 : La Fleur du mal de Claude Chabrol
2002 : France Boutique de Tonie Marshall
2002 : Les Sentiments de Noémie Lvovsky
2003 : Une vie à t'attendre de Thierry Klifa
2004 : 36, avenue des acacias de Martial Fougeron
2005 : L'Un reste, l'autre part de Claude Berri
2005 : Le Petit Lieutenant de Xavier Beauvois
2006 : The Ant Bully de John A. Davis : voix
2006 : Acteur de Jocelyn Quivrin
2006 : La Californie de Jacques Fieschi
2006 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet
2007 : Michou d'Auber de Thomas Gilou
2007 : Mon fils a moi de Martial Fougeron
2007 : Le Prix à payer d'Alexandra Leclère:
2008 : Passe-passe de Tonie Marshall
2008 : Les Bureaux de Dieu de Claire Simon
2008 : Cliente de Josiane Balasko : Judith
2009 : Visages de Tsai Ming-liang
2010 : Ensemble, c'est trop de Léa Fazer:Marie-France
2010 : De vrais mensonges de Pierre Salvadori
2010 : Small World de Bruno Chiche
2011 : Laurence Anyways de Xavier Dolan