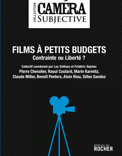In the mood for news: quelques informations cinématographiques...
-Comme le film que je viens de voir ne vaut pas la peine d’être évoqué, exceptionnellement aujourd’hui ce sera une note avec quelques informations cinématographiques en vrac.
-D’abord, je voulais vous parler de deux sites internet. Le premier a été créé par un blogueur et est assez impressionnant de par la qualité et la quantité des informations liées au septième art qu’il recèle. Vous y trouverez une gigantesque base de données sur les films et les filmographies, des quiz, des news, vous pourrez aussi lire de nombreuses critiques liées à un film en particulier. Le but du site est « de partager le cinéma entre amis ». Ce site est en effet très interactif et vous pourrez y ajouter des informations concernant un film, signifier les films dont vous êtes fans, créer vos propres quiz etc. Un site ludique et informatif très « in the mood for cinema » sur lequel je vous recommande donc de vous inscrire. Ce site s’intitule « Cinefriends ». (Cliquez sur le nom pour y accéder).
-
-En vous rappelant que le Ciné club de SciencesPo, mercredi prochain, organise une avant-première exceptionnelle ouverte à tous, de « Nuit de chien » de Werner Shroeter (Lion Spécial du Jury de la Mostra de Venise 2008), suivie d’un débat avec l’équipe du film (Amphi Boutmy, 27 rue Saint-Guillaume, Paris 75006, à 17H, un conseil : arrivez un peu en avance) voici un bref compte rendu du débat organisé lors de la 61ème journée dédicaces de SciencesPo, débat dont le thème était « Le passage à l’écran : l’adaptation tue-t-elle le livre ? ».
 Pour y répondre Paulo Branco (producteur), Josée Dayan (réalisatrice et productrice), Mamadou Mahmoud N’Dongo (écrivain et scénariste), Laurent Aknin (historien et critique de cinéma) ont répondu présents. Le débat était animé par le journaliste et chroniqueur littéraire Hubert Artus. Dommage que les rangs du grand amphi Boutmy aient été aussi clairsemés, pour ne pas dire quasiment vides, pour un débat qui s’est avéré passionnant en particulier en raison des deux formes de cinéma, relativement différentes, pour ne pas dire opposées (bien que s’accordant sur certains points) que défendaient le producteur indépendant Paulo Branco et la réalisatrice (qui a expliqué qu’elle était aussi productrice) de téléfilms Josée Dayan (qui a également réalisé pour le cinéma et notamment « Cet amour-là » , d’ailleurs une adaptation du roman de Yann Andrea sur la relation de ce dernier avec Marguerite Duras).
Pour y répondre Paulo Branco (producteur), Josée Dayan (réalisatrice et productrice), Mamadou Mahmoud N’Dongo (écrivain et scénariste), Laurent Aknin (historien et critique de cinéma) ont répondu présents. Le débat était animé par le journaliste et chroniqueur littéraire Hubert Artus. Dommage que les rangs du grand amphi Boutmy aient été aussi clairsemés, pour ne pas dire quasiment vides, pour un débat qui s’est avéré passionnant en particulier en raison des deux formes de cinéma, relativement différentes, pour ne pas dire opposées (bien que s’accordant sur certains points) que défendaient le producteur indépendant Paulo Branco et la réalisatrice (qui a expliqué qu’elle était aussi productrice) de téléfilms Josée Dayan (qui a également réalisé pour le cinéma et notamment « Cet amour-là » , d’ailleurs une adaptation du roman de Yann Andrea sur la relation de ce dernier avec Marguerite Duras).
Josée Dayan avec la gouaille et le franc-parler qui la caractérise a tout d’abord évoqué son profond respect pour l’écriture, en admettant qu’elle ne savait pas écrire un scénario, ajoutant que très peu de metteurs en scène le savent et que les scénarii, lorsqu’ils sont écrits par les réalisateurs, en souffrent bien souvent. Selon cette dernière « on ne peut pas décider du jour au lendemain qu’on est scénariste ou dialoguiste ». Ce qu’elle préfère, c’est « le rapport aux acteurs. » Elle a ainsi annoncé qu’elle allait adapter « Baisers de cinéma » d’Eric Fottorino pour le cinéma, notamment parce qu’à la télévision, la dispersion de l’attention du téléspectateur nécessite des récits plus construits, plus droits, plus linéaires qu’au cinéma.
Pour Laurent Aknin, la principale différence entre cinéma et télévision provient du fait « qu’un livre est une langue, que le cinéma est un langage. » Pour lui, il ne peut pas y avoir de trahison car ce sont deux modes d’expression totalement différents. Rares sont donc les romans inadaptables…à l’exception peut-être de « La disparition » de Georges Perec (qui ne contient pas une seule fois la lettre e). Pour lui il n’est pas dommageable de supprimer des personnages mais en revanche il ne faut pas manquer des passages ou des personnages que le lecteur-spectateur serait fâché de ne pas retrouver.
 Paulo Branco, à l’inverse de Josée Dayan, a déploré la « dictature du scénario ». Pour cette dernière, un grand nombre de films passant en salles sont complètement ratés en raison de leurs « scénarii ineptes ». Elle a ajouté qu’elle aimait être « emportée » par un film , oublier qu’elle est elle-même réalisatrice, ce qui lui arrive très rarement aujourd’hui, ajoutant s’être « emmerdée » pendant toute la première heure de « La graine et la mulet » d’Abdellatif Kechiche (cliquez ici pour accéder à ma critique de « La Graine et le mulet »), au contraire de Paulo Branco qui estime que ce rythme particulier est justement une des richesses du film, que ce rythme a délibérément été choisi par le réalisateur, ce à quoi Josée Dayan a répliqué que « l’ennui peut devenir une fascination ».
Paulo Branco, à l’inverse de Josée Dayan, a déploré la « dictature du scénario ». Pour cette dernière, un grand nombre de films passant en salles sont complètement ratés en raison de leurs « scénarii ineptes ». Elle a ajouté qu’elle aimait être « emportée » par un film , oublier qu’elle est elle-même réalisatrice, ce qui lui arrive très rarement aujourd’hui, ajoutant s’être « emmerdée » pendant toute la première heure de « La graine et la mulet » d’Abdellatif Kechiche (cliquez ici pour accéder à ma critique de « La Graine et le mulet »), au contraire de Paulo Branco qui estime que ce rythme particulier est justement une des richesses du film, que ce rythme a délibérément été choisi par le réalisateur, ce à quoi Josée Dayan a répliqué que « l’ennui peut devenir une fascination ».
Pour Laurent Aknin, le cinéma est le reflet souvent en avance de quelque chose.
Pour Mamadou Mahmoud N’Dongo, les téléfilms américains ont ainsi préparé l’élection d’Obama. Pour lui le cinéma est « une écriture visuelle ». Il a aussi évoqué l’influence du cinéma dans son écriture littéraire.
Josée Dayan a précisé que ce n’était pas pour autant qu’elle n’aimait pas la Nouvelle Vague citant pour exemple « les films avec Jeanne Moreau », « Les Amants » de Louis Malle (celui-ci faisant pour elle partie de la Nouvelle Vague), les films de Jacques Demy, « Le Mépris » ou « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard, « Hiroshima mon amour » d’Alain Resnais. Pour elle, les réalisateurs actuels sont les héritiers de la Nouvelle Vague sans avoir la même aptitude. Josée Dayan a terminé en disant que « si le cinéma français va si mal (il me semblait pourtant qu’il ne s’en tirait pas trop mal, voir mon bilan de l’année cinéma 2008) c’est parce que le cinéma français est mal écrit. » Elle a ajouté que malheureusement les producteurs sont désormais à la solde des chaînes (en ce qui concerne l’influence, souvent déplorable, des chaines, je ne peux qu’acquiescer) et donc qu’il ne peut plus rien y avoir de personnel…prenant bien soin de souligner que Paulo Branco était l’exception qui confirmait la règle…
- Puisque d’adaptation il est question, une dernière information pour aujourd’hui : « Largo Winch » aura bien une suite (sortie en salles le 17 décembre, cliquez ici pour lire ma critique de « Largo Winch » de Jérôme Salle). Ce scénario sera de nouveau réalisé par Jérôme Salle. Il sera adapté du septième tome de la bande dessinée de Jean Van Hamme et Philippe Francq « La Forteresse de Makiling ». Cette fois-ci l’histoire se déroulera en Birmanie, toujours avec Tomer Sisley dans le rôle principal, il aura cette fois pour charge de libérer son ami Simon (absent du premier épisode filmique) d’une des prisons les plus dangereuses du pays.
Puisque d’adaptation il est question, une dernière information pour aujourd’hui : « Largo Winch » aura bien une suite (sortie en salles le 17 décembre, cliquez ici pour lire ma critique de « Largo Winch » de Jérôme Salle). Ce scénario sera de nouveau réalisé par Jérôme Salle. Il sera adapté du septième tome de la bande dessinée de Jean Van Hamme et Philippe Francq « La Forteresse de Makiling ». Cette fois-ci l’histoire se déroulera en Birmanie, toujours avec Tomer Sisley dans le rôle principal, il aura cette fois pour charge de libérer son ami Simon (absent du premier épisode filmique) d’une des prisons les plus dangereuses du pays.
To be continued…
Sandra.M