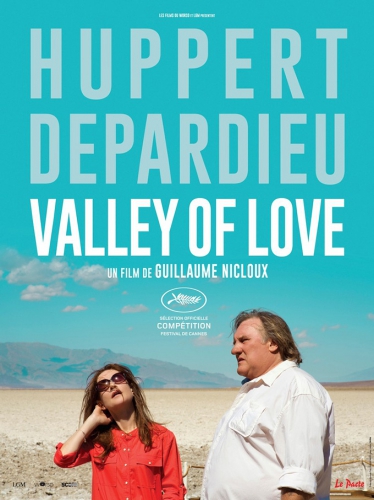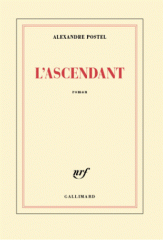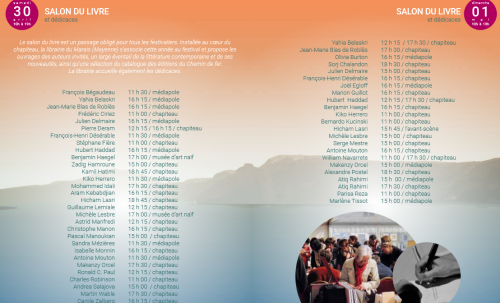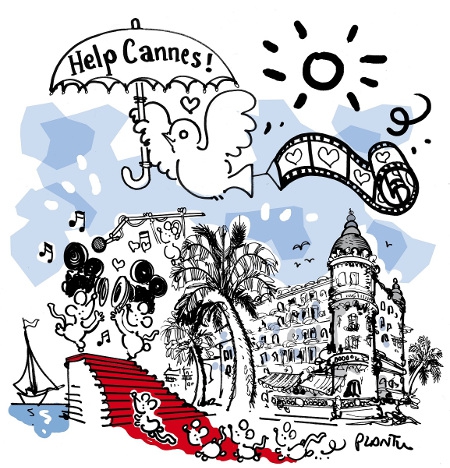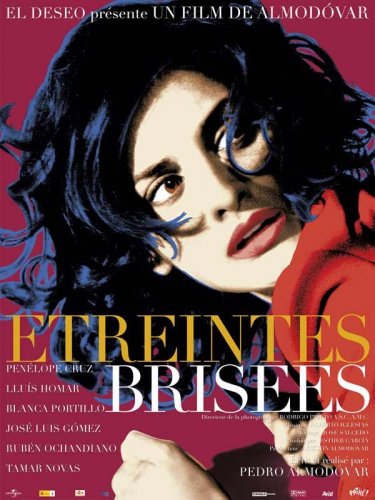L'affiche officielle du film de cette 69ème édition que j'attends le plus, à savoir "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan, vient d'être dévoilée. « Ce n’est que la deuxième fois que Xavier Dolan est en compétition » a précisé Thierry Frémaux lors de la conférence de presse afin de devancer les critiques des éternels rabat-joie. Chaque film du jeune surdoué démontre son immense talent. Tous ses films ont été sélectionnés en section parallèle ou à Un Certain Regard (à l’exception de « Tom à la ferme ») . En 2014, il figurait pour la première fois en compétition officielle avec « Mommy » (ma critique, ci-dessous à cette occasion) pour lequel il avait reçu le prix du jury avant d’être membre du jury en 2015. « Juste la fin du monde » est l’ adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Jean-Luc Lagarce avec une prestigieuse distribution : Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Gaspard Ulliel. Le film raconte l’après-midi en famille d’un jeune auteur qui, après 12 ans d’absence, retourne dans son village natal afin d’annoncer aux siens sa mort prochaine.


Critique de MOMMY de Xavier Dolan


Petite digression avant d’évoquer le film : je me souviens avoir lu dans le petit journal du Festival Lumière, en 2014, que Xavier Dolan est « un très grand fan » d’Un cœur en hiver de Claude Sautet, alors projeté à Lyon dans le cadre de la rétrospective consacrée à ce dernier, accessoirement mon film préféré dont je ne me lasse pas de vous parler et dont vous pourrez retrouver ma critique, en cliquant ici. Voilà qui me rassure, moi qu’on regarde toujours avec circonspection (au mieux) quand je parle de ce film avec passion.
Mommy, c’est Diane Després (Anne Dorval), surnommée…Die (l’ironiquement bien nommée), une veuve qui hérite de la garde de son fils, Steve, un adolescent TDAH impulsif et violent (Antoine-Olivier Pilon). Ils tentent de surmonter leurs difficultés, notamment financières. Sur leurs routes, ils vont trouver Kyla (Suzanne Clément), l’énigmatique voisine d’en face, qui va leur venir en aide.
Il y a des films, rares, singuliers, qui possèdent ce supplément d’âme ineffable, qui exhalent cette magie indicible (la vie, au fond, cette « vitalité » dont Truffaut parlait à propos des films de Claude Sautet, on y revient…) qui vous touchent en plein cœur, qui vous submergent d’émotion(s). Au-delà de la raison. Oui, c’est cela : un tourbillon d’émotions dévastatrices qui emportent notre raison avec elles. Comme un coup de foudre…Un coup de foudre cinématographique est comme un coup de foudre amoureux. Il rend impossible toute raison, tout raisonnement, il emporte notre rationalité, nous transporte, nous éblouit, et nous donne une furieuse envie d’étreindre le présent et la vie. Et de croire en l’avenir.
La situation vécue par Diane et son fils est âpre et chaotique mais Xavier Dolan l’auréole de lumière, de musique et d’espoir. Dès les premières minutes, avec ces éclats de lumière et du soleil qui caressent Diane, la magie opère. Xavier Dolan nous happe dans son univers pour ne plus nous lâcher jusqu’à la dernière, bouleversante, seconde. Un univers éblouissant, étourdissant, dans la forme comme dans le fond qui envoûte, électrise, bouleverse, déroute. En un quart du seconde, il nous fait passer du rire aux larmes, mêlant parfois les deux, mêlant aussi l’emphase et l’intime (il n’est finalement pas si étonnant que Titanic soit un de ses films de prédilection) avec pour résultat cette émotion, ce mélodrame poignant, poétique, fougueux, étincelant, vivace. Débordant de vie.
Certaines scènes (nombreuses) sont des moments d’anthologie, parfois à la frontière entre (mélo)drame et comédie. Il y a notamment cette scène onirique qui raconte ce que la vie aurait pu être « si » Steve n’avait pas été malade et qui m’a bouleversée. Que peut-il y avoir de plus bouleversant que de songer à ce que la vie pourrait être « si »…? Ou encore cette scène où, dans un karaoké, si fier, Steve chante Andrea Bocelli, sous les quolibets, et alors que sa mère a le dos tourné, nous faisant éprouver avec lui la douleur qu’il ressent alors, la violence, contenue d’abord, puis explosive.
Mommy, c’est donc Anne Dorval qui incarne avec une énergie débordante et un charme et un talent irrésistibles cette mère révoltée, excentrique et pudique, exubérante, malicieuse, forte et blessée qui déborde de vitalité et surtout d’amour pour son fils. Suzanne Clément, plus en retrait, mal à l’aise avec elle-même (elle bégaie) et la vie, est tout aussi touchante et juste, reprenant vie au contact de Diane et son fils, comme elle, blessé par la vie, et communiquant difficilement. Ces trois-là vont retrouver l’espoir au contact les uns des autres, se charmer, nous charmer. Parce que si le film raconte une histoire dramatique, il déborde de lumière et d’espoir. Un film solaire sur une situation sombre, à la fois exubérant et pudique, à l’image de Diane.
Le film ne déborde pas seulement de lumière et d’espoir mais aussi d’idées brillantes et originales comme le format 1:1 qui n’est pas un gadget ou un caprice mais un vrai parti pris formel qui crée une véritable résonance avec le fond (Xavier Dolan l’avait déjà utilisé sur le clip College Boy d’Indochine en 2013) sans parler de ce format qui se modifie au cours du film (je vous laisse découvrir quand et comment, scène magnifique) quand l’horizon s’élargit pour les trois protagonistes. Par ce procédé et ce quadrilatère, le visage -et donc le personnage- est au centre (tout comme il l’est d’ailleurs dans les films de Claude Sautet, et si Un cœur en hiver est mon film préféré, c’est notamment parce que ses personnages sont d’une complexité passionnante). Grâce à ce procédé ingénieux, rien ne distrait notre attention qui en est décuplée.
Les films de Xavier Dolan, et celui-ci ne déroge pas à la règle, se distinguent aussi par une bande originale exaltante, entraînante, audacieuse, judicieuse, ici Céline Dion, Oasis, Dido, Sarah McLachlan, Lana del Rey ou encore Andrea Bocelli. Un hétéroclisme à l’image de la folie joyeuse qui réunit ces trois êtres blessés par la vie qui transporte littéralement le spectateur.
Bien sûr plane l’ombre d’Elephant de Gus Van Sant mais ce film et le cinéma de Xavier Dolan en général ne ressemblent à aucun autre. Sur les réseaux (a)sociaux (je repense à cette idée de Xavier Dolan -qui, comme Paolo Sorrentino et Pedro Almodovar, dans le cadre du Festival Lumière, comme le veut désormais la tradition du festival, a été invité à tourner sa version de « La sortie des usines Lumière »,- qui a choisi de demander à ses acteurs d’un jour de se filmer eux-mêmes pour montrer le narcissisme et l’égoïsme des réseaux dits sociaux), certains critiquent la précocité de Xavier Dolan encensée par les médias. Sans doute de la jalousie envers son indéniable talent. D’ailleurs, plus que de la précocité, c’est une maturité qui m’avait déjà fascinée dans Les amours imaginaires. Je m’étais demandée comment, à 21 ans, il pouvait faire preuve d’autant de perspicacité sur les relations amoureuses. Je vous recommande au passage Les amours imaginaires, cette fantasmagorie pop et poétique sur la cristallisation amoureuse, sur ces illusions exaltantes et destructrices, sublimes et pathétiques, un film enivrant et entêtant comme… un amour imaginaire.
Mommy est le cinquième film, déjà, de Xavier Dolan. C’est d’autant plus fascinant qu’il ne se « contente » pas de mettre en scène et de diriger, magistralement, ses acteurs mais qu’il est aussi scénariste, monteur, producteur, costumier. Ici, il ne joue pas (en plus de tout cela, c’est aussi un très bon acteur), se trouvant trop âgé pour le rôle d’Antoine-Olivier Pilon qui crève d’ailleurs littéralement l’écran et dont le personnage, malgré ses excès de violence et de langage, emporte la sympathie du spectateur.
Vous savez ce qu’il vous reste à faire (le film est encore à l’affiche) si vous voulez, vous aussi, ressentir les frissons savoureux procurés par le poignant Mommy de Dolan, fable sombre inondée de lumière, de musique, de courage, quadrilatère fascinant qui met au centre son antihéros attachant et sa mère dans un film d’une inventivité, maturité, vitalité, singularité, émotion rares et foudroyantes de beauté et sensibilité. Un coup de foudre, vous dis-je.
Les mots de Xavier Dolan lors de son discours de clôture du Festival de Cannes ont profondément résonné en moi. Un discours qui résume toute la force et la beauté de la création artistique, la violence et la légèreté surtout qu’elle suscite, qui permet de croire que, malgré les terribles vicissitudes de l’existence, tout est possible. Tout reste possible. Merci Xavier Dolan pour ce moment d’émotion sincère et partagé, pour ces films à votre image, vibrants de vie, de passion, de générosité, d’originalité, de folie, de singularité, d’intelligence. J’aurais aimé vous dire tout cela lorsque je vous ai croisé lors du dîner/buffet de clôture au lieu de passer mon chemin. Mais redoutant que mes mots ne soient à la hauteur de mes émotions et de la vôtre, j’ai préféré me taire et rester avec les mots si vibrants de votre discours dont voici un extrait :
« Une note pour les gens de mon âge, les jeunes de ma génération. Ce sont les notes des dernières années dans ce monde de fous. Malgré les gens qui s’attachent à leurs goûts et n’aiment pas ce que vous faites, mais restez fidèles à ce que vous êtes. Accrochons nous à nos rêves, car nous pouvons changer le monde par nos rêves, nous pouvons faire rire les gens, les faire pleurer. Nous pouvons changer leurs idées, leurs esprits. Et en changeant leurs esprits, nous pouvons changer le monde. Ce ne sont pas que les hommes politiques et les scientifiques qui peuvent changer le monde, mais aussi les artistes. Ils le font depuis toujours. Il n’y a pas de limite à notre ambition à part celles que nous nous donnons et celles que les autres nous donnent. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais. Et puisse ce prix en être la preuve la plus rayonnante ».