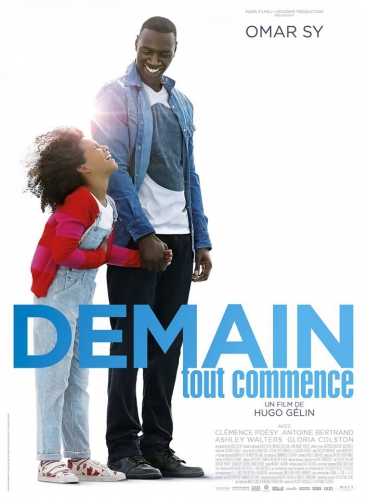22ème cérémonie des Lumières, prix de la presse internationale 2017 : liste des nommés
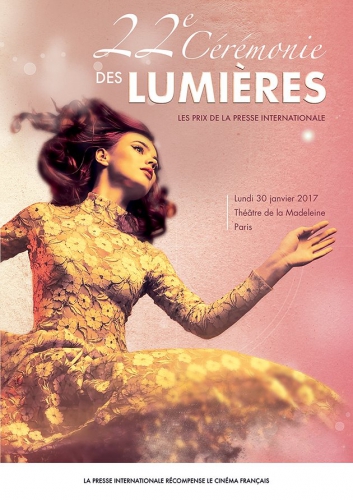
Les films « Elle », « La mort de Louis XIV », « Rester vertical », « Une vie, « La danseuse », « Frantz », « Nocturama », « Les ogres » ou encore « Ma vie de Courgette », « Juste la fin du monde » et « Mal de pierres » arrivent en tête des nominations pour les 22èmes Lumières de la presse internationale, les prix annuels qui seront remis au Théâtre de la Madeleine le lundi 30 janvier 2017.
Ces nominations me réjouissent puisque sont nommés les films que je vous ai recommandés cette année dont vous pourrez retrouver mes critiques en cliquant sur leurs titres ci-dessous (et même si l'absence de "Frantz" dans certaines catégories notamment meilleur film et meilleur acteur me semble une aberration...). Je me réjouis en revanche des nombreuses nominations pour "Mal de pierres" dont je vous avais dit tout le bien que j'en pensais lors de sa projection cannoise suite à laquelle le film avait été injustement méprisé.
"Juste la fin du monde" de Xavier Dolan
"Mal de pierres" de Nicole Garcia
Les réalisateurs Bertrand Bonello, Stéphane Brizé, Léa Fehner, Alain Guiraudie, Albert Serra et Paul Verhoeven ; les actrices Judith Chemla, Marion Cotillard, Virginie Efira, Isabelle Huppert, Sidse Babett Knudsen et Soko ; les acteurs Pierre Deladonchamps, Gérard Depardieu, Nicolas Duvauchelle, Jean-Pierre Léaud, Omar Sy, James Thierrée et Gaspard Ulliel figurent aussi parmi les nommés dans cette première sélection qui illustre la richesse et la grande diversité du cinéma français et francophone sorti en salles en 2016.
Plus de 80 films concouraient pour les nominations aux Lumières de la presse internationale. Pour donner toutes les chances aux films marquants de l’année, l’Académie des Lumières a mis à disposition de ses membres - une centaine de correspondants représentant plus de vingt pays -, une vidéo library en partenariat avec Cinando / Le Marché du Film de Cannes. Le site a déjà reçu près de 800 visites.
Après avoir incorporé la musique et le documentaire l’an passé, les Lumières de la presse internationale, créées en 1995 à l’initiative de Daniel Toscan du Plantier et du journaliste américain Edward Behr, réserveront un prix pour la première fois au cinéma d’animation.
Liste des nommés:
Film
Elle, de Paul Verhoeven
La mort de Louis XIV, de Albert Serra
Nocturama, de Bertrand Bonello
Les ogres, de Léa Fehner
Rester vertical, de Alain Guiraudie
Une vie, de Stéphane Brizé
Réalisateur
Bertrand Bonello - Nocturama
Stéphane Brizé - Une vie
Léa Fehner - Les ogres
Alain Guiraudie - Rester vertical
Albert Serra - La mort de Louis XIV
Paul Verhoeven - Elle
Actrice Judith Chemla - Une vie
Marion Cotillard - Mal de pierres
Virginie Efira - Victoria
Isabelle Huppert - Elle
Sidse Babett Knudsen
- La fille de Brest
Soko - La danseuse
Acteur Pierre Deladonchamps - Le fils de Jean
Gérard Depardieu - The End
Nicolas Duvauchelle - Je ne suis pas un salaud
Jean-Pierre Léaud - La mort de Louis XIV
Omar Sy et James Thierrée - Chocolat
Gaspard Ulliel - Juste la fin du monde
Scénario
David Birke - Elle
Léa Fehner, Catherine Paillé et Brigitte Sy - Les ogres
Emilie Frèche et Marie-Castille Mention-Schaar - Le ciel attendra
Alain Guiraudie - Rester vertical François Ozon - Frantz
Céline Sciamma - Ma vie de Courgette
Image
Christophe Beaucarne - Mal de pierres
Benoît Debie - La danseuse
Antoine Héberlé - Une vie
Léo Hinstin - Nocturama Pascal Marti - Frantz
Jonathan Ricquebourg - La mort de Louis XIV
Révélation masculine
Damien Bonnard - Rester vertical
Corentin Fila et Kacey Mottet Klein - Quand on a 17 ans
Finnegan Oldfield - Bang Gang Toki Pilioko - Mercenaire
Sadek - Tour de France
Niels Schneider - Diamant noir
Révélation féminine
Oulaya Amamra et Déborah Lukumuena - Divines
Paula Beer - Frantz
Lily Rose Depp - La danseuse Manal Issa - Peur de rien
Naomi Amarger et Noémie Merlant - Le ciel attendra
Raph - Ma Loute
Premier film Apnée, Jean-Christophe Meurisse
La danseuse, Stéphanie di Giusto
Diamant noir, Arthur Harari
Divines, Houda Benyamina
Gorge cœur ventre, Maud Alpi
Mercenaire, Sacha Wolff
Film francophone Belgica, Felix van Groeningen
La fille inconnue, Jean Pierre et Luc Dardenne
Hedi, Mohammed Ben Attia
Juste la fin du monde, Xavier Dolan
Mimosas, Oliver Laxe
Les Premiers, les Derniers, Bouli Lanners
Film d'animation
La jeune fille sans mains, Sébastien Laudenbach
Louise en hiver, Jean-François Laguionie
Ma vie de Courgette, Claude Barras
La tortue rouge, Michael Dudok de Wit
Tout en haut du monde, Rémi Chayé
Documentaire
Le bois dont les rêves sont faits, Claire Simon
Dernières nouvelles du cosmos, Julie Bertuccelli
Merci Patron !, François Ruffin
La sociologue et l’ourson, Etienne Chaillou et Mathias Théry
Swagger, Olivier Babinet
Voyage à travers le cinéma français, Bertrand Tavernier
Musique
Sophie Hunger - Ma vie de Courgette
Ibrahim Maalouf - Dans les forêts de Sibérie
Laurent Perez del Mar - La tortue rouge
ROB - Planétarium
Philippe Rombi - Frantz
Gabriel Yared - Juste la fin du monde