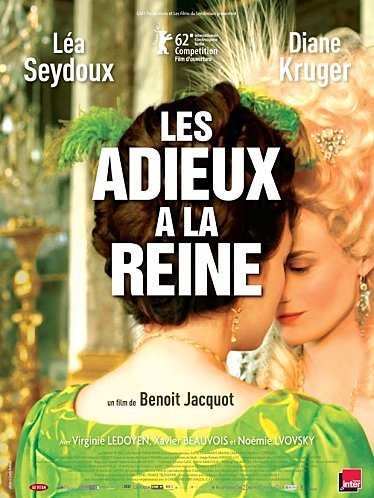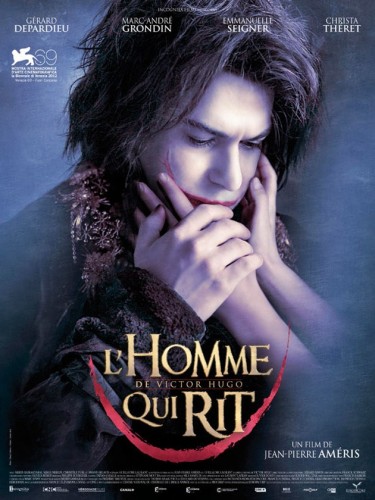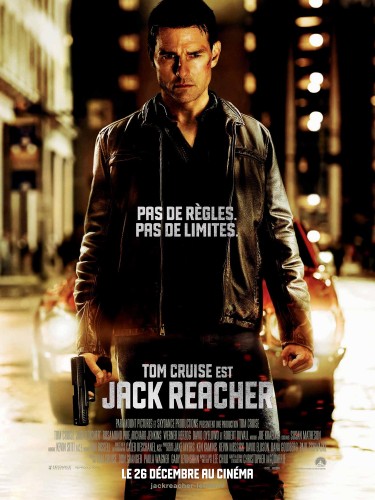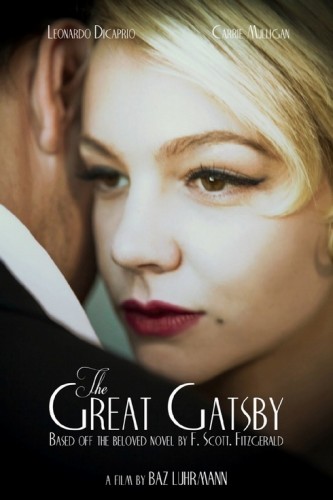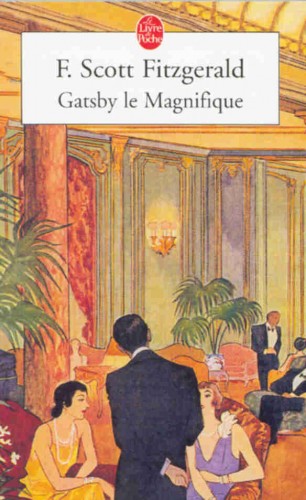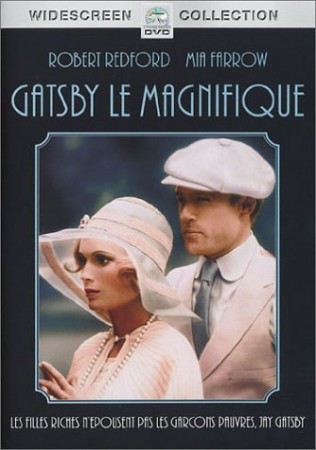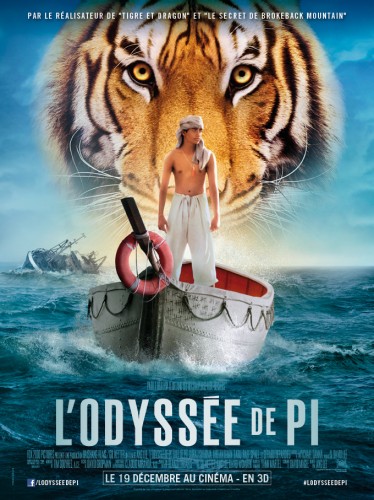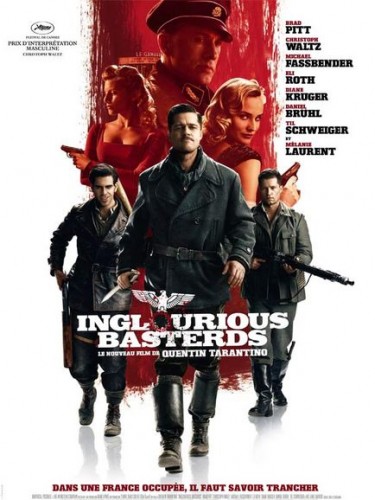Mon bilan cinématographique, festivalier, culturel et bloguesque de l’année 2012 et mon top cinéma (les 15 meilleurs films de 2012)

A quelques jours du dénouement de 2012, l’heure est venue de faire le bilan de cette année culturelle (essentiellement cinématographique mais pas seulement, vous trouverez aussi un peu de théâtre et de musique), festivalière et bloguesque pour ma 9ème année de blog(s), une nouvelle année personnellement tumultueuse mais illuminée par de multiples pérégrinations festivalières, des découvertes cinématographiques, de beaux projets et par la passion du cinéma plus que jamais là, plus que jamais exaltante, plus que jamais la source de magnifiques rencontres sur l’écran et en dehors. J'espère vraiment avoir réussi à vous la faire partager. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes différents blogs et j'en suis flattée et vous en remercie. Vous êtes ainsi également désormais plus de 3100 à suivre mon compte twitter principal (@moodforcinema).
Je vous propose donc, ci-dessous un retour en mots, en photos et en vidéos sur les meilleurs moments de cette année 2012, une année encore une fois très « in the mood for cinema » avant de vous livrer, à la fin de cet article, mon top 15 de l’année cinéma dont je réalise qu’il est très français ou en tout cas francophone, la preuve que si le cinéma français n’a pas fait des miracles en terme d’entrées en salles cette année, il a proposé un cinéma audacieux et particulièrement enthousiasmant, avec de belles révélations puisque dans ce top figurent 4 premiers films (dont trois français). N’hésitez pas à laisser votre top dans les commentaires !
«Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans « Amour » de Michael Haneke, la palme d’or du Festival de Cannes 2012. Les films qui sont dans ce top, même si un jour je les oublie, j’en suis certaine, m’auront laissé des sentiments forts et indélébiles. Je vous les recommande.
J'en profite pour vous souhaiter à tous une très joyeuse année 2013 riches de rêves et de passions... et bon courage à ceux qui vont s'atteler à la lecture de ma logorrhée en espérant qu'elle n'en sera néanmoins pas tout à fait une...
UNE ANNEE DE FESTIVALS ET D’EVENEMENTS CINEMATOGRAPHIQUES
Les festivals ont plus que jamais jalonné cette année. C’est là que tout a commencé pour moi, il y a une bonne dizaine d’années. Jamais alors je n’aurais imaginé continuer à les parcourir tant d’années après et surtout à y être ainsi immergée.
Outre les rendez-vous habituels, j’aurais eu le plaisir de faire partie de deux jurys cette année, celui de la critique internationale du Festival du Film Asiatique de Deauville, en mars 2012, et celui du Festival International du Film de Boulogne Billancourt, en avril 2012 et je peux d’ores et déjà vous annoncer que je ferai partie de deux autres jurys pour lesquels j’ai été sollicitée l’an prochain, notamment le jury du Festival du Film Merveilleux en juin 2013.
Ces festivals auront été l’occasion de belles découvertes cinématographiques. Un bon festival c’est ainsi souvent comme un grand film, il vous laisse heureux et exténué, joyeusement nostalgique et doucement mélancolique, riche d’émotions et de réflexions, souvent contradictoires, et il faut souvent un peu de recul pour appréhender ces multiples réflexions et émotions qu’il a suscitées, pour découvrir quelles images auront résisté à l’écoulement du temps, aux caprices de la mémoire, à ce flux et flot d’informations ininterrompues.
En cliquant sur leurs intitulés, vous pourrez accéder aux comptes-rendus complets des différents festivals et évènements auxquels j’ai assisté cette année et dont vous ne trouverez qu’un bref extrait ou résumé ci-dessous.
FESTIVAL DU FILM ASIATIQUE DE DEAUVILLE 2012

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
La mélancolie douce, la beauté presque réfractaire de Deauville en mars, d’une violence et d’un charme mêlés et subreptices, m’a comme chaque année envoûtée même si les thèmes du festival étaient particulièrement sombres pour cette 14ème édition du Festival du Film Asiatique de Deauville qui fut pour moi la 11ème.

© Copyright Sandra Mézière
Deuil (surtout), fuite inexorable et vaine, quête d’identité, perte d’innocence : les thèmes des films de la compétition de cette édition 2012 ont pourtant brossé le portrait de sociétés et d’êtres étouffés par le malheur, la pauvreté, en quête d’un ailleurs et d’espérance bien souvent inaccessibles.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Etait ainsi projeté à Deauville « Himizu » du japonais Sono Sion, adaptation du manga éponyme. Coup de cœur (et de poing) de ce festival, d’une rageuse, fascinante, exaspérante et terrifiante beauté. Ce film, d’une folie inventive et désenchantée, d’un romantisme désespéré, d’un lyrisme tragique et parfois grandiloquent, est porté par l’énergie du désespoir. Il s’achève sur un cri d’espoir vibrant et déchirant. Sublime. Ravageur. La possibilité d’un rêve. Ce film a remporté le prix de la critique internationale auquel je me réjouis de n’être pas tout à fait étrangère.

© Copyright Sandra Mézière
Voix étouffées, cris d’espoir ou de douleur, parole tue, condamnée ou jaillissante : tout en faisant souvent preuve d’une économie de mots, cette compétition 2012 a traduit avec beaucoup de subtilité le désarroi de personnages enfermés, étouffés, le plus souvent par la misère sociale, qu’elle soit fruit de la dictature ou de catastrophes personnelles ou naturelles. Un cinéma de contrastes, d’oxymores même : de douce violence et de silences bavards. Un cinéma de qualité en tout cas, malgré sa noirceur qui laissait parfois filtrer une lueur d’espoir d’autant plus belle et éclatante et ravageuse, à l’image de celle de la fin de « Himizu », sans aucun doute l’image qui restera de cette compétition cinématographiquement réjouissante.
Cliquez ici pour lire le compte-rendu complet du Festival du Film Asiatique de Deauville 2012.
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BOULOGNE BILLANCOURT
« La Philosophie de ce Festival est de privilégier tout ce qui fait aimer la vie » avait ainsi déclaré Claude Pinoteau, le Président d’honneur de ce festival, dans son édito. Mais Boulogne-Billancourt c’est avant tout et surtout une compétition, cinq films très différents avec pour point commun de « souffler positif », cinq films parmi lesquels le jury dont j'ai eu le plaisir de faire partie avait la lourde et passionnante tâche de décerner les prix du meilleur réalisateur, du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Si les sujets étaient parfois sombres : maladie d’Alzheimer, solitude, perte de l’innocence, conflit-israélo palestinien en arrière-plan, ou même invasion nazie, les cinéastes en compétition, par la légèreté, la folie poétique, la lumière, la musique cherchaient avant tout à donner de l’espoir. Cinq histoires dans lesquelles les personnages partaient en quête d’un autre ou d’eux-mêmes.

Ci-dessus, le jury du Festival du Film de Boulogne-Billancourt 2012: Thomas Clément, Didier Allouch et moi-même.
Nous avons attribué le prix de la meilleure actrice à la jeune comédienne Lou de Laâge pour le film « Nino, une adolescence imaginaire de Nino Ferrer » de Thomas Bardinet, ce dont je me réjouis d’autant plus qu’elle irradiait déjà dans le très beau premier film de Frédéric Louf « J’aime regarder les filles» dont je vous ai parlé à maintes reprises. Dans ce film, elle interprète Natacha, comédienne au théâtre comme dans la vie. Ce film possède toute la fraîcheur, l’innocence et la violence mêlées de l’adolescence, toute la fragilité aussi. Le réalisateur Thomas Bardinet a fait de ce qui aurait pu être un défaut une force : du manque de moyens (il occupe tous les postes du film et a tourné sans équipe technique), de la photographie parfois très sombre émane la sensation de voir une adolescence telle qu’elle est dans le souvenir, au milieu d’une sorte de brouillard qui, à la fois, l’idéalise et la radicalise, comme dans un conte. Le décor est parfois inexistant tout comme les parents le sont d’ailleurs (nous ne voyons jamais leurs visages) pour laisser la part belle au jeu, aux visages des jeunes interprètes qui interprètent un texte volontairement très écrit, de manière un peu théâtrale, comme dans les films de Rohmer, référence assumée, le ton rappelant fortement ses contes moraux. Si toute la distribution est remarquable, Lou de Laâge est indéniablement au-dessus du lot et confirme la révélation de «J’aime regarder les filles » tant elle dévore l’écran. Située dans les années 50 l’intrigue a un caractère intemporel, presque anachronique. Les métaphores parfois un peu simplistes comme le papillon de la fin pour signifier le passage à l’âge adulte, au lieu de faire tomber le film dans la mièvrerie lui donne une jolie candeur parfaitement assumée, mélange de gravité et de légèreté propre à cet âge. Un réalisateur à suivre qui a su sublimer ses jeunes interprètes et tirer profit des limites budgétaires. Pour moi, la plus belle et rafraîchissante surprise de ce festival…

Les lauréats du Festival International du Film de Boulogne-Billancourt 2012 et notamment Mehdi Dehbi et Jules Sitruk à qui j'ai eu le plaisir de remettre leurs prix.
Pour le prix du meilleur acteur, il nous a été impossible de départager Mehdi Dehbi et Jules Sitruk dans «Le Fils de l’autre » de Lorraine Lévy. Si, comme moi, vous avez vu « La folle histoire de Simon Eskenazy », certainement n’avez-vous pas pu oublier Mehdi Dehbi qui y interprétait avec pudeur et nuance un jeune travesti alors que son rôle aurait pu facilement tomber dans la caricature et la vulgarité. Dans «Le fils de l’autre », il porte un message plein d’espoir, celui d’une réconciliation a priori impossible que sa personnalité faîte de deux identités réunit. Son jeu est d’une sensibilité, d’une justesse, d’un magnétisme tellement éclatants, au-delà du message, qu’il nous était impossible de ne pas le primer.
Face à lui, Jules Sitruk fait également preuve d’une belle maturité et présence et d’une émotion communicative. Ce film efficace et émouvant plein de bienveillance sur la quête d’identité et de la réconciliation avec soi et « l’autre » que Lorraine Lévy revendique comme « idéologique » et non «politique» a également reçu le prix du public.
C’est à un film espagnol que nous avons choisi d’attribuer le prix du meilleur film: «Crebinsky » de Enrique Otero. Si ce film a remporté les suffrages des deux jurys, c’est notamment parce que c’est celui qui possède l’univers le plus marqué, et qui témoigne le plus d’un vrai parti pris, d’un point de vue et d’un regard de cinéaste. Enrique Otero assume ses multiples références : à Chaplin, Jeunet, Kusturica…des références à la hauteur desquels il est évidemment difficile d’arriver mais de ce film se dégage un charme burlesque, une folie poétique, une singularité loufoques incontestables… Un cinéaste à suivre !
Enfin, nous avons choisi d’attribuer une mention spéciale au film australien « Lou » de Belinda Cheyko (ce film a également reçu le prix du meilleur film du jury jeunes). D’un sujet qui aurait pu être scabreux, Belinda Cheyko, par une mise en scène d’une étonnante maîtrise et sensibilité pour un premier film, signe un film lumineux, tendre, plein de délicatesse, un nouveau départ plein d’espoir porté également par la jeune Lily Bell-Tindley parfaitement dirigée à l’image des autres enfants du film.
Ce festival possède décidément tous les pouvoirs et en plus de « souffler » positif, souffle aussi un peu de magie puisque, comme Woody Allen dans « La rose pourpre du Caire », il permet aux acteurs de sortir de l’écran et nous rejoindre. J’ai donc eu le plaisir de remettre leurs prix sur scène à Jules Sitruk et Mehdi Dehbi…
Et puis il y a eu les rendez-vous habituels : le Festival de Cannes, le Festival du Cinéma Américain de Deauville, le Festival du Film Asiatique de Deauville, le Festival Paris Cinéma, le Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz. La découverte d’un nouveau festival aussi : le Champs-Elysées Film Festival. Cette année, j’ai délaissé les festivals de Cabourg et Dinard mais j’ai également été fidèle à deux rendez-vous incontournables que sont désormais LES PRIX LUMIERES et les CESAR.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière


© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Cannes, c’est la vie en concentré. Plus belle et plus violente. Plus déconcertante et exaltante. Plus dérisoire et urgente. Comme sur l’écran, tout y est plus triste, plus tragique, plus intense, tellement excessif. Chacun se pare d’un masque, souvent de vanité, parfois d’hypocrisie, me faisant songer à cette citation de Molière tellement à propos à Cannes « L’hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu ». Cannes, « c’est une joie et une souffrance », pourrais-je dire en paraphrasant Truffaut. La joie de vivre au rythme de sa passion. La souffrance de voir des passions moins nobles l’emporter. La joie de faire taire la réalité. La joie de voir la vie ressembler à du cinéma. La joie d’être immergée dans un monde de cinéma et de se plonger dans des regards et des univers de cinéastes captivants, dérangeants, en tout cas éminemment talentueux. La joie de partager sa passion, de passer ses journées au rythme du cinéma. Oui, la joie l’emporte forcément.

© Copyright Sandra Mézière
Une certitude subsiste : que j’aime Cannes et le cinéma à la folie, toujours et encore et malgré tout, ce vertige émotionnel et cinématographique qui vous enivre, mais beaucoup moins ceux qui font le leur et le prennent pour prétexte à l’expression de leurs frustrations, beaucoup moins ceux qui se gavent et se grisent, beaucoup moins ceux qui piétinent les autres et leur orgueil pas même pour un quart d’heure cher à Warhol.
C’est ainsi pourtant pour mon 12ème Festival de Cannes, avec la même émotion que les autres fois, comme une réminiscence de la première que je suis entrée à nouveau dans le célèbre Grand Théâtre Lumière ( la première fois, c’était en 2001, c’était pour « Marie-Jo et ses deux amours » de Guédiguian, cette année-là un certain Nanni Moretti avait obtenu la palme d’or pour « La chambre du fils ») songeant à tous les films qui y ont été présentés, à tous les cinéastes qui ont émergé aux yeux du monde, à toute l’émotion contenue ou déployée dans cette salle depuis tant d’années, à tant d’applaudissements qui si souvent m’ont donnée la chair de poule, la réalité rejoignant le cinéma, se confondant presque avec celui-ci lorsque la lumière se rallume et que l’écran laisse entrevoir les visages qui y figuraient quelque secondes plus tôt, dans une autre réalité.

© Copyright Sandra Mézière
Résonnent encore en moi : cette phrase de Bérénice Béjo à l’ouverture : «Tais-toi, toi qui dis à ton enfant qu’il ne faut pas rêver, que ce n’est pas possible» ou encore la voix assurée de Beth Ditto rendant hommage à Marilyn (égérie de l’affiche 2012 , Marilyn ; un mélange de force et de fragilité, d’ombre et de lumière, de glamour masquant la mélancolie, finalement à l’image du festival) en reprenant la chanson d’Elton John.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Ce furent 11 jours de chocs et d’éblouissements cinématographiques, d’exquise et troublante confusion entre fiction et réalité enlacées en un tango langoureux annihilant frontières et repères, où la vie fut alors exaltante, palpitante, grisante. Comme au cinéma…

© Copyright Sandra Mézière
Comme chaque année, j’ai frissonné en entendant pour la première fois, la musique de Saint-Saëns, le cœur battant, comme pour un rendez-vous amoureux, à la fois doucement inquiète, et exaltée à l’idée de cet état second dans lequel je savais déjà que cette immersion cinématographique me plongerait. 11 jours à être déroutée, aimantée inexorablement vers ce Grand Théâtre Lumière, cette « bulle au milieu du monde dans laquelle on se réfugie, on se cache blottie contre un siège rouge dans le noir d’une grande salle » comme l’a si bien dit Bérénice Béjo. Une bulle qui nous isole du monde (quoi, il existerait un monde en dehors de Cannes ?), bulle délicieusement égocentrique, bulle qui paradoxalement nous éloigne du monde même si les films, justement, nous en rappellent l’état, cette année souvent désorienté, sur fond de crise, en quête d’un amour désespéré. Une parenthèse enchantée qui nous plonge pourtant dans un monde désenchanté.

« Amour », la palme d’or 2012 signée Michael Haneke est un film tragique, bouleversant, universel qui nous ravage, un film lucide, d’une justesse et d’une simplicité remarquables, tout en retenue. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans le film, comme je vous le rappelais en introduction de ce bilan de l'année. C’est aussi ce qu’il nous reste de ce film, l’essentiel, l’Amour avec un grand A, pas le vain, le futile, l’éphémère mais l’absolu, l’infini. Un film éprouvant et sublime, d’une beauté tragique et ravageuse que vous hante et vous habite longtemps après la projection, après ce dernier plan d’une femme seule dans un appartement douloureusement vide. Un film d’Amour absolu, ultime. Et puis il y a la musique de Schubert, cet Impromptu que j’ai si souvent écouté et que je n’entendrai sans doute plus jamais de la même manière. L’Amour absolu, un cri d’amour ultime et désespéré qui montre ce qui est « caché » avec une infinie pudeur et délicatesse alors que tant, à Cannes, s’enivrent de rencontres et plaisirs éphémères.
A Cannes comme ailleurs, ce fut un cinéma particulièrement morose et pessimiste cette année mais aussi des œuvres exprimant une quête d’amour(s) effrénée et souvent désespérée. Le festival fut, comme chaque année, le révélateur ou la confirmation de grands films et auteurs et le reflet clairvoyant et souvent terrible de la société, une société en perte et quête de repères.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

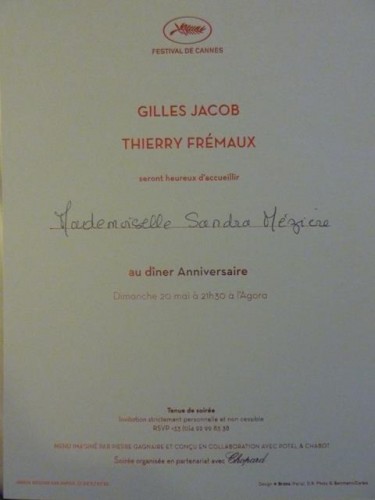
Si je devais moi aussi m’attarder sur la géographie des visages comme le fit Gilles Jacob dans son documentaire que je vous recommande vivement «Une journée particulière » (que je remercie au passage de m’avoir fait vivre parmi les plus beaux moments de cette année cinématographique 2012 s’il me fait à nouveau l’honneur de me lire), je retiendrais pêle-mêle : celui de William Hurt dans le film de Sandrine Bonnaire, enragé de douleur indicible, d’amour massacré, de folie désespérée ; le beau visage de Raphaël Personnaz, ravagé par la culpabilité dans « Trois mondes » ; celui d’Isabelle Huppert, fantaisiste et mélancolique à souhait dans le film ludique et rohmerien de Hong Sang-Soo. Celui de Robert Pattinson, judicieusement cynique et sinistre, présent dans tous les plans de « Cosmopolis », une vraie révélation. Celui de Mahmoud, le cavalier de la place Tahrir, dans le sublime et significatif dernier plan de « Après la bataille » ; ceux d’Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant douloureusement enlacés dans leur tendre et ultime amour jusqu’au dernier souffle dans le film d’Haneke. Celui d’Emilie Dequenne sur la musique de Julien Clerc, saisissant de douleur et d’émotion dans "A perdre la raison" (au passage, signalons que face à elle une autre révélation de Cannes, Tahar Rahim est sidérant de justesse et Niels Arestrup plus inquiétant que jamais). Le regard attendrissant, opiniâtre et frondeur de Hushpuppy (incroyable présence et maturité de la jeune Quvenzhané Wallis) qui lutte, et s’invente un univers magique, imprégnant tout le film de son riche imaginaire. Si je devais retenir une musique, ce serait un Impromptu de Schubert que j’aimais déjà tant désormais indissociable du film d’Haneke, infiniment triste et beau. La voix puissante de Beth Ditto à l’ouverture. La musique de Mark Snow d’une puissance émotionnelle renversante dans « Vous n’avez encore rien vu».
Cliquez ici pour lire mon bilan du Festival de Cannes 2012
FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Pour la 19ème année consécutive, Deauville fut pour moi un rendez-vous incontournable et cette année une douce parenthèse enchantée. Le tableau de la société américaine dressé par les films en compétition était pourtant souvent sombre là aussi, évoquant la plupart du temps une société qui se déshumanise, aux frontières de l’absurde, une société de solitude(s), parfois même au milieu de la multitude, de personnages en détresse avec, néanmoins, au contraire des films de ces deux dernières années, en commun, une note d’espoir, à leur dénouement… Une édition en tout cas très réussie. Il m’en reste les souvenirs des planches sous un soleil étincelant, presque irréel, toujours auréolées de leur douce mélancolie ; des visages radieux honorés de l’hommage que le festival leur a rendu (Harvey Keitel, William Friedkin, Salma Hayek, Liam Neeson) ; des images de films aussi ( comme celles des excellents « Una noche », « Les bêtes du sud sauvage », « Elle s’appelle Ruby », « The we and the I ») .

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Malgré tant d’années de festivals, à Deauville et ailleurs, je crois que j’avais oublié à quel point un festival, et celui-ci en particulier, vous éloigne du tumulte de l’existence et du monde, et vous plonge dans un doux cocon d’irréalité qui vous donne l’impression que tout devient possible, y compris que que cinéma et existence s’entrelacent et vous plongent dans un exquis chaos. Cela tombe bien : mon autre coup de cœur de ce festival 2012 (avec « Les Bêtes du Sud sauvage » de Benh Zeitlin, le grand lauréat de cette édition 2012) évoquait les « rêves qui deviennent réalité» et cette danse troublante et périlleuse entre le créateur et sa création, le rêve et la réalité. Il s’agit de « Elle s’appelle Ruby » qui reste d’ailleurs dans mon top 15 de cette année.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Cliquez ici pour lire mon bilan du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012.
CHAMPS-ELYSEES FILM FESTIVAL

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Cette année 2012 aura aussi vu naître un nouveau festival de cinéma : le Champs-Elysées Film Festival. Rappelons brièvement le principe du Champs-Elysées Film Festival (et rappelons aussi qu’il n’a rien à voir avec l’autre festival de cinéma parisien, LE FESTIVAL PARIS CINEMA qui a fêté cette année ses 10 ans) dont le principe est de proposer des projections dans les salles de cinéma de la plus belle avenue du monde, au total plus de 150, et notamment une sélection de films indépendants américains mais aussi de films sélectionnés aux Oscars ou encore de films sélectionnés par le président d’honneur du Festival, Lambert Wilson. Ce festival a donné lieu à de belles master class et notamment celles de Donald Sutherland ou M.Madsen.
FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES REALISATEURS DE ST-JEAN-DE-LUZ
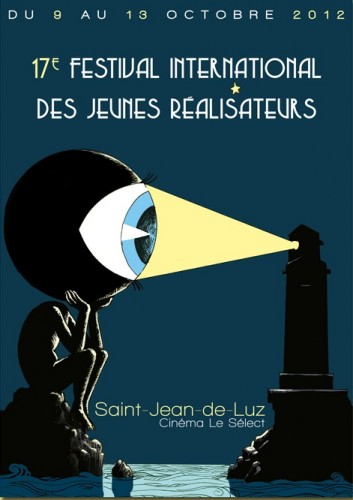

© Copyright Sandra Mézière
Pour la 2ème année consécutive, j’ai ainsi eu le plaisir d’être invitée à Saint-Jean-de-Luz pour le Festival International des Jeunes Réalisateurs qui, comme son nom l’indique (partiellement), a pour (réjouissant) principe de projeter des premiers et deuxièmes films de jeunes (du moins dans leurs carrières) cinéastes. Les 10 films en compétition étaient particulièrement divers dans leurs styles même si s’en dégageaient des thématiques communes : le poids de la religion et des traditions, parfois leurs contradictions, la maladie (physique ou mentale), le deuil, et souvent une forme d’enfermement (dans la religion, la prison, la guerre, la solitude). Des sujets lourds certes mais traités souvent avec dérision, par l’absurde, la poésie et en tout cas la plupart du temps avec beaucoup de sensibilité.
Le palmarès a couronné les meilleurs films de cette édition avec, néanmoins, un oublié : « Le voyage de Monsieur Crulic » de la cinéaste Roumaine Anca Damian, un film atypique qui mêle fiction, animation, documentaire et qui a d’ailleurs récolté de nombreux prix en festivals de cinéma.
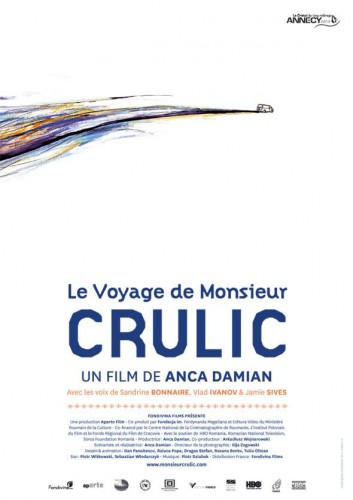
LA révélation de cette édition 2012, c’est le film de Sandrine Bonnaire « J’enrage de son absence » (que j’avais vu à Cannes et que j’ai revu avec autant de plaisir et d’émotion). Pour son premier film, dès la première seconde, elle fait preuve d’une maitrise étonnante, d’une manière de nous « impliquer » dans son drame, avec intensité et empathie. La tension est croissante. Le regard à la fois doux et perdu, un peu fou mais surtout fou d’amour et de la rage de l’absence de William Hurt (prix d’interprétation du festival) auquel sa caméra s’accroche souvent, y est pour beaucoup. Sa prestation est une des plus magistrales qu’il m’ait été donné de voir. Son personnage un des plus bouleversants de tendresse, de détresse, d’humanité, aux portes de la folie. Il va peu à peu s’enterrer, se recroqueviller au propre comme au figuré, pour aller au bout de cette détresse. En plus d’être une grande comédienne, Sandrine Bonnaire s’affirme donc ici comme une grande cinéaste en devenir. Elle filme la violence de la douleur avec une rage à la fois douce et âpre, sans jamais lâcher ses personnages tout comme cette douleur absolue ne les lâche jamais. Paradoxalement, un film qui fera du bien à tous ceux qui ont connu ou connaissent la douleur ineffable, étouffante et destructrice du deuil malgré un dernier plan d’une tristesse déchirante.
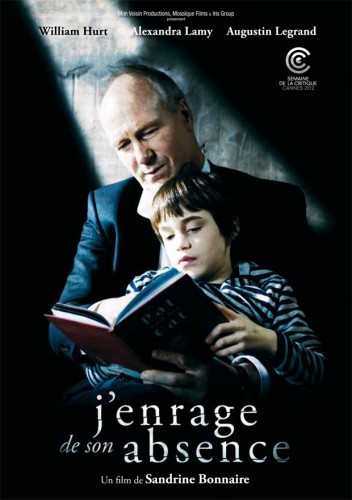
C’est aussi de quête de liberté dont il était question dans le très beau « Syngue Sabour, pierre de patience», réalisation franco-afghane d’Atiq Rahimi (primé en 2004 à Saint-Jean-de-Luz pour « Terres et cendres ») qui a reçu le Chistera du meilleur film avec cette adaptation de son roman.

UN NOUVEAU BLOG : INTHEMOODFORFILMFESTIVALS.COM

Après tant de festivals parcourus, après tant d’années à vivre au rythme de ma passion (et j’espère bien que ce n’est qu’un début), après tant de participations à des jurys de festivals de cinéma (14, désormais, 10 suite à des concours d'écriture et 4 en tant que blogueuse), je crois commencer à bien connaître le sujet des festivals de cinéma et il m’est apparu comme une évidence que je devais créer ce blog pour vous faire partager ces informations et cette passion.
Je vous invite donc à découvrir ce blog créé en juillet 2012 : In the mood for film festivals ( http://inthemoodforfilmfestivals.com ). Vous y trouverez de nombreux articles mais aussi des bons plans sur tous les festivals de cinéma.
Ce nouveau blog sera consacré entièrement au Festival de Cannes à partir de la fin mars jusqu’à fin Mai 2013. Ce nouveau blog possède également son compte twitter @moodforfilmfest même si mon compte twitter principal reste @moodforcinema.
Je vous rappelle aussi que mon blog principal est désormais http://inthemoodlemag.com .
DE BELLES RENCONTRES, CONFERENCES, INTERVIEWS, MASTER CLASS

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière
Cette année, j’ai eu le plaisir d’assister à de nombreuses conférences de presse (à Paris, Cannes, Deauville), master class, et de réaliser quelques interviews mais aussi de faire de très belles rencontres (pas forcément évoquées sur le blog). Les plus beaux moments furent sans doute : l’interview de John Malkovich, d’Anthony Delon, la conférence de presse en petit comité de Woody Allen, celle de Michel Bouquet (article à venir concernant cette dernière), et quelques conférences du Festival de Cannes dont celle des lauréats.

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière

© Copyright Sandra Mézière (La seule "photo" qui me reste de ma rencontre avec Woody Allen...)

© Copyright Sandra Mézière
Vingt-quatre ans après avoir interprété Valmont dans le magnifique film de Stephen Frears « Les Liaisons dangereuses », adapté du chef d’œuvre éponyme de Choderlos de Laclos, John Malkovich l’a mis cette année en scène au Théâtre de l’Atelier. Une idée qu’il a eue avant même de jouer Valmont dans le film de Stephen Frears, rôle auquel il doit sa notoriété et une interprétation à laquelle les futurs Valmont lui doivent d’être condamnés à une cruelle comparaison tant il est indissociable de ce rôle dans lequel il était aussi époustouflant, charismatique que machiavélique. J’ai eu le plaisir de découvrir la pièce lors de sa répétition générale puis de pouvoir interviewer John Malkovich, après la représentation.
Ah, ce texte ! Le vertige sensuel, cruel, intemporel des mots, de l’œuvre, sa clairvoyance sur la duplicité des apparences. Un texte bouleversant de lucidité, de beauté, de cruauté, que cette mise en scène singulière, surprenante, a donné, je l’espère, envie de découvrir à ceux qui ne le connaissaient pas encore et qui, peut-être, mésestiment le pouvoir de l’écriture et des mots, peut-être, finalement, les seuls vainqueurs.
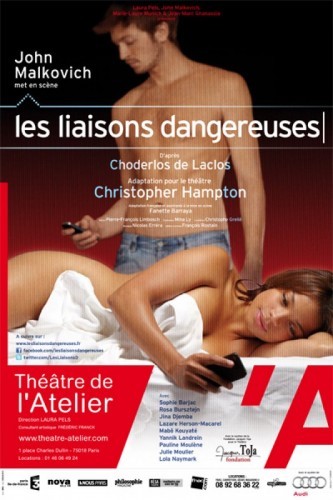
Cliquez ici pour lire ma critique intégrale de la pièce et le compte-rendu de cette rencontre.
© Copyright Sandra Mézière© Copyright Sandra Mézière
© Copyright Sandra Mézière
C’est pour la pièce « Panik » que j’ai réalisé une interview impromptue d’Anthony Delon. L’histoire de trois personnages démunis, dans l’air du temps qui vous font oublier celui qui passe et vous interroger sur une époque vorace, cynique, mais surtout sur ce que ces caractéristiques masquent. Une comédie qui vaut surtout par ses trois comédiens particulièrement impliqués et une mise en scène remarquable. Après la représentation, on m’a proposé d’interviewer Anthony Delon. Perfectionniste, j’étais partagée entre l’envie de refuser pour n’avoir pas eu la possibilité de préparer cette interview en raison de son caractère impromptu (et dire qu’il y a tant de questions que, avec le recul, j’aurais aimé lui poser…) et l’envie d’interviewer ce remarquable comédien que l’on réduit encore trop à son nom mais qui a bel et bien une identité et un talent singuliers. Cette interview aura au moins eu le mérite de la spontanéité de l’instant (malgré mes onomatopées redondantes, mes digressions et interventions parfois superflues).
Cliquez ici pour lire le compte-rendu complet de la pièce et de l'interview.
THEATRE ENCORE…

Je tenais à reprendre ici quelques lignes de mon article sur cette pièce en espérant que cela vous incitera à la voir. Jamais larmoyante, la pièce est caustique, tendre parfois, cruelle, lucide, drôle, poignante, et nous emporte dans son tourbillon pour nous laisser bouleversés, songeant à nos propres spectres, à la nécessité, parfois, de laisser ou faire tomber les masques et surtout, malgré leur poids, à la nécessité de « se souvenir des terribles choses », nous laissant aussi avec en tête, le souvenir de cette interprétation exceptionnelle et bouleversante de Zabou Breitman (et qui m’a éblouie et terrassée), ce tourbillon de colère, de vie, de folie, de révolte et, enfin, avec le souvenir d’une citation comme une note d’espoir désenchantée : «Vous pouvez tout emporter, vous n’emporterez jamais nos désirs ! ».
Cliquez ici pour lire ma critique complète de la pièce

C’est mon troisième coup de cœur théâtral de l’année avec « Les Liaisons dangereuses » et « La Compagnie des spectres ».
2H30 incroyables (presque trop courtes !), une satire burlesque et enchantée, extravagante, poétique comme un film de Kaurismäki, délirante, déjantée et musicale comme un film de Kusturica, d’une absurdité irrésistible comme un film de Tati mais une absurdité signifiante comme un livre de Ionesco, qui vous fera faire un tour de manège étourdissant, avec de formidables comédiens dont l’étendue du talent a rarement été aussi bien exploitée grâce à une mise en scène qui transcende un texte intemporel et une confirmation, une révélation pour certains : Pierre Niney,Impressionnant. Epoustouflant. « Prodigieux » comme je l’ai entendu à l’entracte. Les adjectifs me manquent. Comme si De Funès avait rencontré Belmondo et comme s’ils avaient créé ce talent unique qui ne ressemble d’ailleurs ni à l’un ni à l’autre mais rappelle le premier par une mécanique de drôlerie très particulière, et le second par l’énergie et la modernité singulières de son jeu…et avec un zeste de Buster Keaton pour le mélange de burlesque et poésie. Oui, rien que ça. J’ai rarement vu une telle performance qui est d’autant plus impressionnante qu’elle semble être réalisée avec une facilité déconcertante. Il chante, danse, saute, s’énerve, minaude, charme, s’échappe, revient, fait des sauts insensés…le tout avec une ingénuité remarquable. Ce n’est évidemment pas seulement une performance physique mais ça l’est aussi. La vivacité et la précision de son jeu, et de ses gestes, renforcent la modernité et le caractère intemporel de la pièce. Ne serait-ce que pour dire deux fois de manières très différentes et tout aussi irrésistibles, « Le dévouement est la plus belle coiffure d’une femme », réplique déjà drôle en elle-même, il montre l’étendue de son jeu. Le rôle nécessite déjà une énergie débordante mais la mise en scène ne lui facilite vraiment pas la tâche se terminant par des obstacles infranchissables pour le commun des mortels. Si vous voulez le voir au cinéma, il est actuellement à l’affiche dans l’excellent « Comme des frères » et prénommé aux César comme meilleur espoir après une nomination pour « J’aime regarder les filles » l’an dernier, et également nommé aux prix Lumières 2013 et parmi les trois nommés au prix Patrick Dewaere 2013. C’est beaucoup me direz-vous mais c’est mérité, à le voir dans ce rôle qu’il sublime réellement, auquel il apporte modernité, ingénuité et énergie doucement folles. Chaque comédien apporte néanmoins sa pièce à cet édifice respectant ainsi la devise latine de la Comédie Française « Simul et singulis » (« Ensemble et singuliers »). . J’ai passé un moment magique qui m’a fait oublier les vicissitudes de l’existence et qui m’a en même temps rappelé mon amour immodéré du théâtre, et son pouvoir magique, justement, qui consiste notamment à nous permettre d’être ainsi en même temps magnifiquement là et sublimement ailleurs. Vraiment. Alors, ne laissez pas passer cette chance de le vivre vous aussi puisque la pièce est à l’affiche jusqu’en janvier.
Cliquez ici pour accéder à ma critique complète de la pièce.
UN PEU DE MUSIQUE
Si je ne devais que garder 5 musiques pour faire la bande-son de cette année, ce serait :
-You and You (découvert au Mathurin Live Contest)
-Archimède (Les Lavallois qui prennent leur envol et à qui j’ai consacré un article ici )
-Revolver (pas seulement parce qu’ils signent la bo d’un de mes coups de coeur cinématographique de l’année précité)
- La BO des Bêtes du Sud sauvage (une musique qui exacerbe la force lyrique et poétique de ce sublime film, également dans mon top 15 de l'année)
-Lou Doillon (la découverte 2012)
EN ROUTE POUR 2013
2013 sera plus que jamais pour moi une année cinématographique, je compte en tout cas tout faire pour.. De nouvelles voies professionnelles s’ouvrent à moi et d'enthousiasmantes sollicitations dont j'espère qu'elles aboutiront même si je ne peux vous en parler pour l’instant.
J’ai par ailleurs désormais un agent .

Mon recueil en ligne sur MyMajorCompany est toujours ouvert à l’édition participative et que ce projet puisse voir le jour ou non, cela ne m’empêchera pas de continuer à me consacrer à ma passion dévorante pour l’écriture.
Quelques textes seront d’ailleurs mis en ligne ailleurs (je vous en dirai plus prochainement) notamment ceux avec lesquels j'ai remporté des concours de nouvelles, comme celui-ci en début d'année. En attendant, vous pouvez toujours soutenir mon projet sur MyMajorCompany.
Je compte aussi développer un concept en lien avec mon site Inthemoodforluxe.com (mais pour l'instant, je suis encore en quête de financements) parce que c’est grâce à ce site que je peux rester libre, et continuer à faire de mon mieux pour vous livrer un contenu de qualité (ou du moins que j'espère tel) sur mes 5 blogs cinéma. Au passage, sachez que vous pouvez actuellement y gagner deux séjours vip dans des hôtels "in the mood for luxe" et des cocktails à l'hôtel Scribe.
J’en profite d’ailleurs pour lancer un appel puisque je recherche des partenariats notamment pour le Festival de Cannes 2013.
En 2013, plus que jamais, j'espère donc continuer à vivre de mes passions pour le cinéma et l'écriture, avec le même enthousiasme et la même liberté, ici ou ailleurs, de continuer à pouvoir raconter des histoires réelles ou fictives.
TOP 15 de l’année cinéma 2012

Dans ce top 15, je réalise que trois films exploitent et exaltent le pouvoir de l’art, des mots et de l’écriture : « Vous n’avez encore rien vu », « Elle s’appelle Ruby », « Dans la maison ». Un classement que j'ai eu beaucoup de mal à mettre dans un ordre particulier et qui pourrait s'inverser demain parce qu’il m’est impossible de choisir entre des films si différents, en revanche si je devais choisir le film de l’année, celui qui m’a le plus transportée, émue, éblouie, ce serait sans doute « Vous n’avez encore rien vu » d’Alain Resnais.
Plusieurs premiers films dans ce classement : « Louise Wimmer », « J’enrage de son absence », « Les Bêtes du Sud sauvage » et « Comme des frères », quatre révélations dans des genres très différents mais trois films coups de cœur et de poing à leur manière.
Il n’y a pas de critères objectifs qui ont guidé le choix de ces 15 films si ce ne sont ceux de l’empreinte laissée, de l’émotion sur le moment et/ou de la réflexion, des qualités de réalisation, de scénario, de jeu… et parfois tout cela à la fois pour certains. J’espère qu’une sélection aux César permettra à certains de connaître le succès qu’ils auraient mérité et à côté duquel ils sont passés. Je pense notamment à « Une bouteille à la mer » et "Louise Wimmer". Retrouvez mon top 15 ci-dessous avec les critiques des films et vos commentaires et classements sont les bienvenus dans les commentaires.
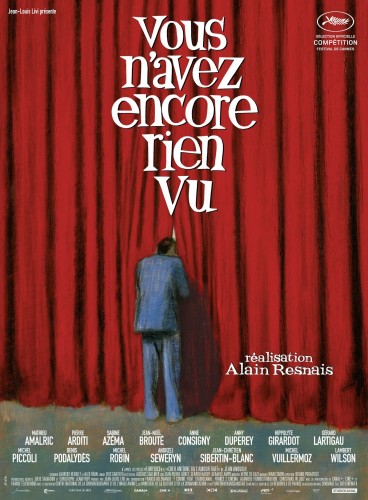
Disons-le d’emblée, le film d’Alain Resnais était mon énorme coup de cœur de cette édition 2012 du Festival de Cannes avec « A perdre la raison » de Joachim Lafosse (section Un Certain Regard) et « J’enrage de son absence » de Sandrine Bonnaire (Semaine de la Critique). Bien sûr, il est difficile d’évincer (et de comparer) avec « Amour » et « De rouille et d’os » qui m’ont également enthousiasmée mais ce film a (et a suscité) ce quelque chose en plus, cet indicible, cet inexplicable que l’on pourrait nommer coup de foudre.
Après tant de grands films, des chefs d’œuvres souvent même, Alain Resnais prouve une nouvelle fois qu’il peut réinventer encore et encore le dispositif cinématographique, nous embarquer là où on ne l’attendait pas, jouer comme un enfant avec la caméra pour nous donner à notre tour ce regard d’enfant émerveillé dont il semble ne s’être jamais départi. A bientôt 90 ans, il prouve que la jeunesse, l’inventivité, la folie bienheureuse ne sont pas questions d’âge.
Antoine, homme de théâtre, convoque après sa mort, ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions d’Eurydice, pièce qu’il a écrite. Il a enregistré, avant de mourir, une déclaration dans laquelle il leur demande de visionner une captation des répétitions de cette pièce: une jeune troupe lui a en effet demandé l’autorisation de la monter et il a besoin de leur avis.
Dès le début, la mise en abyme s’installe. Les comédiens appelés par leurs véritables noms reçoivent un coup de fil leur annonçant la mort de leur ami metteur en scène. Première répétition avant une succession d’autres. Puis, ils se retrouvent tous dans cette demeure étrange, presque inquiétante, tel un gouffre un peu morbide où leur a donné rendez-vous Antoine. Cela pourrait être le début d’un film policier : tous ces comédiens réunis pour découvrir une vérité. Mais la vérité qu’ils vont découvrir est toute autre. C’est celle des mots, du pouvoir et de la magie de la fiction.
Puis, se passe ce qui arrive parfois au théâtre, lorsqu’il y a ce supplément d’âme, de magie (terme que j’ai également employé pour « Les bêtes du sud sauvage« , autre coup de coeur de 2012, mais aussi différents soient-ils, ces deux films ont cet élément rare en commun), lorsque ce pouvoir des mots vous embarque ailleurs, vous hypnotise, vous fait oublier la réalité, tout en vous ancrant plus que jamais dans la réalité, vous faisant ressentir les palpitations de la vie.
En 1942, Alain Resnais avait ainsi assisté à une représentation d’ « Eurydice » de Jean Anouilh de laquelle il était sorti bouleversé à tel point qu’il avait fait deux fois le tour de Paris à bicyclette. C’est aussi la sensation exaltante que m’a donné ce film!
Chaque phrase prononcée, d’une manière presque onirique, magique, est d’une intensité sidérante de beauté et de force et exalte la force de l’amour. Mais surtout Alain Resnais nous livre ici un film inventif et ludique. Il joue avec les temporalités, avec le temps, avec la disposition dans l’espace (usant parfois aussi du splitscreen entre autres « artifices »). Il donne à jouer des répliques à des acteurs qui n’en ont plus l’âge. Cela ne fait qu’accroître la force des mots, du propos, leur douloureuse beauté et surtout cela met en relief le talent de ses comédiens. Rarement, je crois, j’aurais ainsi été émue et admirative devant chaque phrase prononcée quel que soit le comédien. A chaque fois, elle semble être la dernière et la seule, à la fois la première et l’ultime. Au premier rang de cette distribution (remarquable dans sa totalité), je citerai Pierre Arditi, Lambert Wilson, Anne Consigny, Sabine Azéma mais en réalité tous sont extraordinaires, aussi extraordinairement dirigés.
C’est une des plus belles déclarations d’amour au théâtre et aux acteurs, un des plus beaux hommages au cinéma qu’il m’ait été donné de voir et de ressentir. Contrairement à ce qui a pu être écrit ce n’est pas une œuvre posthume mais au contraire une mise en abyme déroutante, exaltante d’une jeunesse folle, un pied-de-nez à la mort qui, au théâtre ou au cinéma, est de toutes façons transcendée. C’est aussi la confrontation entre deux générations ou plutôt leur union par la force des mots. Ajoutez à cela la musique de Mark Snow d’une puissance émotionnelle renversante et vous obtiendrez un film inclassable et si séduisant (n’usant pourtant d’aucune ficelle pour l’être mais au contraire faisant confiance à l’intelligence du spectateur).
Ce film m’a enchantée, bouleversée, m’a rappelé pourquoi j’aimais follement le cinéma et le théâtre, et les mots. Ce film est d’ailleurs au-delà des mots auquel il rend pourtant un si bel hommage. Ce film aurait mérité un prix d’interprétation collectif, un prix de la mise en scène…et pourquoi pas une palme d’or (il est malheureusement reparti bredouille du palmarès de ce Festival de Cannes 2012) ! Ces quelques mots sont bien entendu réducteurs pour vous parler de ce grand film, captivant, déroutant, envoûtant, singulier. Malgré tout ce que je viens de vous en dire, dîtes-vous que de toutes façons, « Vous n’avez encore rien vu ». C’est bien au-delà des mots. Et espérons que nous aussi nous n’avons encore rien vu et qu’Alain Resnais continuera encore très longtemps à nous surprendre et enchanter ainsi. Magistralement.
2. « A perdre la raison » de Joachim Lafosse

Présenté au Festival de Cannes 2012 dans la sélection Un Certain Regard dans le cadre de laquelle je l’ai découvert, puis en avant-première au Festival Paris Cinéma où je l’ai revu (avec la même émotion), « A perdre la raison » est un des grands chocs cinématographiques de cette année 2012, et même sans doute le seul film de cette année auquel sied le substantif « choc ». Peut-être équivalent à celui éprouvé à la fin de « Melancholia « , l’année précédente. C’est dire ! Même si le film de Joachim Lafosse ne va pas jusqu’à relever de l’expérience comme celui de Lars Von Trier, il vous laisse avec une émotion dévastatrice et brutale, une réflexion aussi, qui vont bien au-delà de la salle de cinéma.
Murielle (Emilie Dequenne) et Mounir (Tahar Rahim) s’aiment passionnément. Elle est belle, féminine, joyeuse, lumineuse. Il est incontestablement charmant. Depuis son enfance, le jeune homme vit chez le Docteur Pinget (Niels Arestrup), qui lui assure une vie matérielle aisée après s’être marié avec la sœur marocaine de celui-ci, pour lui permettre d’avoir des papiers. Murielle et Mounir décident de se marier. D’abord, réticent, le Docteur accueille la jeune femme chez lui. Le jeune couple n’en déménagera jamais, pas plus à la suite des 4 grossesses de la jeune femme. Une dépendance s’installe. Le climat affectif devient irrespirable. L’issue tragique est alors inéluctable…
Joachim Lafosse ne laisse d’ailleurs planer aucun doute sur celle-ci. Dès les premiers plans, Murielle est à l’hôpital et demande à ce qu’ils soient « enterrés au Maroc ». Puis, 4 petits cercueils descendent d’un avion sur le territoire marocain. Entre ces deux plans, Mounir et le Docteur Pinget s’étreignent chaleureusement. La succession de ces trois scènes est d’autant plus cruelle, terrible et bouleversante, a posteriori.
Le film, lui aussi, vous étreint dès ces premiers plans pour ne plus vous lâcher, pourtant Joachim Lafosse ne recourt à aucune facilité pour cela : aucun sensationnalisme, pas plus qu’une photographie sombre annonciatrice du drame à venir. Non, il a eu l’intelligence de recourir à une mise en scène sobre, baignée d’une lumière crue, parfois éblouissante, qui rend d’autant plus terrible la noirceur dans laquelle se retrouve plongée Murielle, et celle du geste qu’elle accomplira. Seul le cadre légèrement chancelant (avec ces plans de portes en amorce, comme si quelqu’un, constamment, dominait, surveillait, instillant une impression malsaine mais impalpable), les gros plans qui enserrent les personnages, les plans séquences qui suggèrent le temps qui s’étire, et quelques plans significatifs comme celui de Murielle en Djellaba, hagarde, à l’extérieur mais filmée derrière une fenêtre à barreaux, laissent entendre qu’elle est emmurée, oppressée, que l’étau se resserre.
Il en fallait du talent, de la délicatesse, pour réussir un film, sur un tel sujet, rendre envisageable l’impensable, sans doute le crime le plus terrible qui soit : l’infanticide. Nous faire comprendre comment cette femme va perdre sa liberté, une raison d’être, et la raison. Du talent dans l’écriture d’abord : le scénario de Joachim Lafosse, Matthieu Reynaert et Thomas Bidegain qui avait nécessité 2 ans et demi d’écriture pour adapter très librement ce fait divers survenu en Belgique en 2007, l’affaire Geneviève Lhermitte, est particulièrement habile, maniant les ellipses et se centrant sur ses trois personnages principaux, aussi passionnants que, chacun à leur manière, terrifiants. Les dialogues sont concis et précis, comme les phrases assénées par Pinget à Murielle qui peuvent sembler tendrement réprobatrices ou terriblement injustes et cruelles selon la perception de la jeune femme. Tout est question de point de vue, de perception, et la nôtre est subtilement amenée à être celle de Murielle, ce qui rend la scène finale (judicieusement hors-champ) d’autant plus brutale. Dans la réalisation évidemment, évoquée précédemment. Dans le choix de la musique qui intervient à chaque transgression.
Dans l’interprétation enfin. Et quelle(s) interprétation(s) ! D’abord, le duo Arestrup- Rahim reformé trois ans après un « Prophète », et leurs prix d’interprétation respectifs. Niels Arestrup est parfait en père de substitution à la présence envahissante, à la générosité encombrante, d’une perversité insidieuse, sachant obtenir tout ce qu’il veut, comme un enfant capricieux et colérique.
Face à lui, Tahar Rahim prouve une nouvelle fois que ses deux prix aux César (meilleur acteur, meilleur espoir) n’étaient nullement usurpés, toujours ici d’une justesse remarquable; il prouve aussi une nouvelle fois l’intelligence de ses choix artistiques. D’abord charmant, puis irascible, un peu lâche, velléitaire, sans être vraiment antipathique, il est lui aussi emmuré dans la protection et le paternalisme ambigu de Pinget, ne voyant pas ou préférant ne pas voir la détresse dans laquelle s’enferme sa femme. (cf aussi ma critique de « Or noir » et celle du film « Les hommes libres »).
Que dire d’Emilie Dequenne ? Elle est sidérante, époustouflante, bouleversante en Médée moderne. Il faudrait inventer des adjectifs pour faire l’éloge de sa prestation. D’abord si lumineuse, elle se rembrunit, s’enlaidit, s’assombrit, se renferme sur elle-même pour plonger dans la folie. Ce n’est pas seulement une affaire de maquillage comme cette scène où elle est à un spectacle de sa fille, outrageusement maquillée, et où ses réactions sont excessives. Non, tout en elle incarne sa désincarnation progressive, cette raison qui s’égare : sa démarche qui en devient presque fantomatique, son regard hagard, ses gestes hâtifs ou au contraire si lents, en tout cas désordonnés. Elle parvient à nous faire croire à l’incroyable, l’impensable ; comment ce personnage lumineux peut s’aliéner et accomplir un acte aussi obscur. Et puis il y a cette scène dont tout le monde vous parlera, mais comment ne pas en parler, tant elle y est saisissante d’émotion : ce plan-séquence où elle chante et pleure en silence, dans sa voiture sur la musique de Julien Clerc. Elle a reçu le prix d’interprétation Un Certain Regard pour ce film. Gageons que ce ne sera pas le dernier.
Lafosse dissèque les rapports de pouvoir entre ces trois êtres, fascinants et terrifiants, métaphore d’un colonialisme dont l’aide est encombrante, oppressante, rendant impossible l’émancipation. La famille devient un Etat dictatorial si bien que le Maroc dont ont voulu absolument fuir Mounir et sa famille apparaît comme le paradis pour Murielle, et ressemble à un Eden onirique dans la perception qui nous est donnée, la sienne. Il y a un soupçon de Dardenne dans cette empathie pour les personnages dont Lafosse tente de comprendre et d’expliquer tous les actes, même les inexplicables, même le pire, même l’ignominie. Du Chabrol aussi dans cette plongée dans les travers de la bourgeoisie, ses perversions, sa fausse affabilité. Et même du Clouzot dans ce diabolisme insidieux. Mais surtout une singularité qui fait que Joachim Lafosse, aucunement moralisateur, est un vrai cinéaste avec son univers et son point de vue propres.
Si vous ne deviez voir que trois films cette année, celui-ci devrait sans aucun doute en faire partie. Bouleversant, il vous hantera et questionnera longtemps après cette plongée étouffante, palpitante et brillante dans cette cellule familiale (la bien nommée) et dans la complexité des tourments de l’âme humaine et vous laissera avec le choc de ce dénouement annoncé mais non moins terrassant.
3. Les Bêtes du sud sauvage" de Benh Zeitlin

« Quand le cinéma est beau comme le vôtre, quand les films sont beaux comme le vôtre, cela rassemble », avait déclaré la présidente du jury Sandrine Bonnaire lors de la cérémonie du palmarès du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2012 lors de laquelle le film avait été couronné du Grand Prix et du prix de la révélation Cartier. C'est en effet un des pouvoirs magiques du cinéma que de pouvoir rassembler ainsi des spectateurs différents dans un tourbillon d'émotions agréablement dévastateur.
Ci-dessus, Benh Zeitlin, lors de la cérémonie du palmarès de Deauville (photo inthemoodfordeauville.com )
A Cannes, déjà, où je l'avais manqué et où le film a notamment été couronné de la caméra d’or, c’était une incessante litanie « il faut voir Les Bêtes du Sud sauvage ». Alors, ce film méritait-il autant de louanges et autant de prix ?
« Les Bêtes du Sud sauvage » est le premier long-métrage de Benh Zeitlin adapté de « Juicy and Delicious», une pièce écrite par Lucy Alibar, une amie de Benh Zeitlin qui a coécrit le scénario avec lui. Il se déroule dans le Sud de la Louisiane, dans le bayou, «le « bathtub », une terre sauvage et âpre où vit Hushpuppy (Quvenzhané Wallis), une petite fille de 6 ans et son père Wink (Dwight Henry). Soudain cette nature rebelle s’emballe, les glaciers fondent, des aurochs apparaissent, le monde s’effondre pour Hushpuppy (la nature qui l’environne mais aussi le sien, son monde, puisque la santé de son père décline) ; elle va alors partir à la recherche de sa mère.
Ne vous fiez pas à mon synopsis réducteur car ce film possède tout ce qu’un synopsis ou une critique ne pourront jamais refléter. Il en va ainsi de certains films, rares, comme de certaines personnes qui possèdent ce charme indescriptible, cette grâce ineffable, ce supplément d’âme que rien ni personne ne pourront décrire ni construire car, justement, il n’est pas le fruit d’un calcul mais une sorte de magie qui surgit presque par miracle (et sans doute grâce à la bienveillance et la sensibilité du regard du cinéaste) comme celle qui peuple les rêves de Hushpuppy.
Dès les premières secondes, malgré la rudesse de la vie qu’il décrit, malgré l’âpreté de cette terre et celle du père de Hushpuppy, ce film vous séduit et vous emporte pour ne plus vous lâcher. C’est à travers les yeux innocents et l’imagination débordante de Hushpuppy que nous sommes embarqués dans cette histoire guidés par sa voix qui nous berce comme un poème envoûtant.
La vie grouille, palpite, dans chaque seconde du film, dans cet endroit où elle est (et parce qu'elle est) si fragile, son cœur bat et résonne comme celui de ces animaux qu’écoute Hushpuppy pour, finalement, faire chavirer le vôtre. Un monde qu'il donne envie de préserver avant que les marées noires ne le ravagent et que la magie n'en disparaisse à jamais.
Son monde est condamné mais Hushpuppy (incroyable présence et maturité de la jeune Quvenzhané Wallis) , avec son regard attendrissant, opiniâtre et frondeur résiste, lutte, et s’invente un univers magique où le feu s’allume au passage d’une belle femme, où elle résiste aux aurochs du haut de ses 6 ans. Benh Zeitlin filme à hauteur d'enfant et du regard d'Hushpuppy imprégnant tout le film de son riche imaginaire.
Film inclassable : autant une histoire d’amour ( d’un réalisateur pour une terre sauvage et noble qui se confond avec la mer dans un tumulte tourmenté que pour ses habitants, fiers et courageux viscéralement attachés à leur terre mais aussi d’une fille pour son père et réciproquement dont les relations sont faites de dureté attendrissante), fantastique ou fantasmagorique que conte philosophique et initiatique, « Les bêtes du sud sauvage » est aussi un poème onirique qui mêle majestueusement tendresse et rudesse (des êtres, de la terre), réalité et imaginaire, violence (des éléments) et douceur (d’une voix), dureté et flamboyance (comme lors de ce défilé d'une gaieté triste pour célébrer la mort). Voilà, ce film est beau et contrasté comme un oxymore.
Un film d'une beauté indescriptible, celle des êtres libres, des êtres qui résistent, des êtres qui rêvent, envers et contre tout, tous et cela s’applique aussi bien au film qu’à celui qui l’a réalisé avec un petit budget et des acteurs non professionnels sans parler des conditions de tournage puisque l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon de BP s’est produite le premier jour du tournage le 20 avril 2010.
Un film universel, audacieux et dense, un hymne à la vie et l’espoir, au doux refuge de l'imaginaire aussi quand la réalité devient trop violente, un film d’une beauté âpre et flamboyante qui vous emmènera loin et vous accompagnera longtemps comme cette voix (texte de la voix off dit par Hushpuppy magnifiquement écrit), ce regard et cette musique qui reflètent ce mélange de force et de magie, de grâce et de détermination ( une musique dont Benh Zeitlin est le coauteur, elle fut même utilisée pour la campagne d’Obama) et, à l'image de son affiche, un feu d'artifices d'émotions. Un film rare qui méritait indéniablement son avalanche de récompenses.
4. Une bouteille à la mer » de Thierry Binisti
J’ai découvert ce film lors du dernier Festival des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean de Luz dans le cadre duquel il était présenté en compétition et où il a d’ailleurs remporté le prix du meilleur film (Chistera d’or). Un vrai coup de cœur. Un coup de foudre, même. Malheureusement, je n’avais pas rédigé de critique à l’époque ou quelques lignes trop brèves. Je n’ai pas la possibilité de le revoir cette semaine mais je vous livrerai une critique plus longue dès que je pourrai retourner le voir. En attendant, ci-dessous, quelques mots qui, je l’espère, vous inciteront à découvrir ce film magnifique et rare.
Adapté du roman de Valérie Zenatti « Une bouteille à la mer de Gaza », c’est l’histoire de Tal (Agathe Bonitzer), une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire où elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire.
« Je m’appelle Tal Lévine, j’ai bientôt 17 ans et j’habite Jérusalem.
Hier soir, il y a eu un attentat près de chez moi […]
Toi qui trouveras cette bouteille, réponds-moi.
Dis-moi où tu l’as trouvée. Qui tu es. Parle-moi de toi. S’il te plaît. »
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux « Gazaman » (Mahmoud Shalaby)… Va alors débuter un échange épistolaire d’abord constitué de doutes, de reproches, d’incompréhension mais qui va finalement les mener sur le chemin d’une liberté et d’une réconciliation apriori impossibles.
Je vous avais déjà parlé du travail de Thierry Binisti à l’occasion de la diffusion du docu-fiction « Louis XV, le soleil noir » qu’il avait réalisé pour France 2 et par lequel j’avais été très agréablement surprise et charmée : un divertissement pédagogique passionnant, de très grande qualité, aussi bien dans le fond que dans la forme, une immersion dans les allées tumultueuses de Versailles et dans les mystérieux murmures de l'Histoire, dans le bouillonnant siècle des Lumières et dans la personnalité tourmentée de Louis XV. Les similitudes entre ce téléfilm et « Une bouteille à la mer » sont d’ailleurs assez nombreuses, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer : Versailles, une prison (certes dorée) pour Louis XV comme peut l’être Gaza pour Naïm, un portrait nuancé de Louis XV comme le sont ceux de Naïm et Tal, une combinaison astucieuse entre fiction et documentaire ( Certaines séquences d’« Une bouteille à la mer » sont ainsi des images d’actualité provenant d’archives diffusées par les médias, comme celles sur la grande manifestation commémorant l’anniversaire de la mort de Yitzhak Rabin filmée sur la place des Rois, au milieu de milliers d’Israéliens manifestant leur désir de paix ) permettant d’explorer le politique et l’intime, l’importance du lieu qui cristallise les tensions et les émotions.
Tout comme le docu-fiction évoqué ci-dessous, « Une bouteille à la mer » ne laisse pas place à l’approximation. Le sujet est ainsi particulièrement documenté, l’auteure Valérie Zenatti (auteure du roman éponyme et coauteure du scénario) a d’ailleurs passé son adolescence en Israël. Il faut d’ailleurs souligner le formidable travail d’adaptation de ce roman épistolaire, genre particulièrement périlleux à adapter. Valérie Zenatti et Thierry Binisti ont fait de ce qui aurait pu être un inconvénient un atout : ces deux voix qui se répondent, à la fois proches et parfois si lointaines, se font écho, s’entrechoquent, se confrontent et donnent un ton singulier au film, grâce à une écriture belle et précise, et sont ainsi le reflet de ces deux mondes si proches et si lointains qui se parlent, si rarement, sans s’entendre et se comprendre.
Un autre grand atout du film est que Thierry Binisti ne tombe jamais dans l’angélisme ni la diabolisation de l’un ou l’autre côté du « mur ». Il montre au contraire Palestiniens et Israëliens, par les voix de Tal et Naïm, si différents mais si semblables dans leurs craintes et leurs aspirations, et dans l’absurdité de ce qu’ils vivent. Il nous fait tour à tour épouser le point de vue de l’un puis de l’autre, leurs révoltes, leurs peurs, leurs désirs finalement communs, au-delà de leurs différences, si bien que nous leur donnons tour à tour raison. Leurs conflits intérieurs mais aussi au sein de leurs propres familles sont alors la métaphore des conflits extérieurs qui, paradoxalement, les rapprochent.
Agathe Bonitzer, grave et candide, épouse parfaitement la belle maturité de son jeune personnage et, face à elle, Mahmoud Shalaby est bouleversant de douceur et de rage mêlées (vous aviez pu le découvrir dans « Les Hommes libres » d'Ismaël Ferroukhi).
La sensibilité avec laquelle ce sujet justement sensible est évoqué rend probable une histoire a priori impossible entre ces deux êtres que tout sépare, pour qui la vie tient à ça : « avoir envie d’aller ou pas au café d’en bas ». Une violence cruellement quotidienne, ce qui ne les empêche pas d’être épris de vie et de désirs, de rêves et d’aspirations, ce que montre très bien ce film à hauteur d’hommes qui, par la « petite » histoire permet d’appréhender la grande. La caméra est au plus près des êtres, de leurs émotions, de leur rage, leurs désirs, leurs douleurs, leur éveil (à la politique, à l’amour) et se fait « carcérale » pour suivre Naïm emprisonné dans les 370 km2 de Gaza (pour 1,6 millions d’habitants !).
Cela commence par le fracas tétanisant d’une bombe et s’achève par une lumière d’espoir bouleversante, un dénouement fiévreux d’une tension palpitante.
Ce dame cornélien, au sens littéral, concilie l’impossible, la douceur et l’âpreté, la modernité des emails et l’archaïsme romanesque de la bouteille à la mer, le romantisme (ou en tout cas le romanesque) et la politique, la raison et les sentiments. Des « liaisons dangereuses » qui possèdent la beauté tragique du roman éponyme de Laclos, outre le fait d’avoir en commun le style épistolaire.
C’est un hymne à la paix et à la tolérance mais aussi au pouvoir et à la magie des mots qui peuvent unir, réunir ceux que tout oppose, si ce n’est leur aspiration à la liberté. Ce sont finalement leurs différences et leur jeunesse qui les réunissent. C’est d’ailleurs la langue, le Français, qui sert de terrain neutre, de pont entre eux. C’est ainsi au Centre Culturel Français de Gaza que s’évade Naïm et ose croire à la liberté, à un avenir meilleur.
Ce film réunit tout ce que j’aime dans le cinéma : une histoire d’amour ou en tout cas d’amitié, apriori impossible, un propos engagé, une réalisation maîtrisée, des acteurs époustouflants, un style épistolaire que et qui sublime(nt) les mots. De l’émotion. De l’espoir. Sans mièvrerie, mais avec beaucoup de sensibilité et de pudeur (aucun cliché, aucune volonté de forcer l’émotion, pourtant ravageuse).
Ce film m’a bouleversée comme je l’ai rarement été ces derniers temps au cinéma. Un film intense d’une douce gravité qui possède et concilie la fraîcheur et l'incandescence de ses jeunes interprètes. Une brillante métaphore d’un conflit a priori insoluble auquel il apporte un vibrant message d’espoir. Un film plus convaincant que n'importe quel discours politique. Deux personnages bouleversants que la réalisation et la direction d’acteurs nous font prendre en empathie ainsi que ceux qui subissent la même situation. Une bouteille à la mer qui nous fait croire à l’impossible. Que des bouteilles à la mer peuvent arriver à destination. Réunir ceux que tout oppose. Et que des milliers de bouteilles, un jour, peut-être, arriveront à faire entendre leurs voix pacifistes et arriveront à briser le fracassant et assourdissant silence après les tonitruantes explosions de terreur et de haine. Un film ensorcelant, poignant comme un poème entremêlant tragédie et espoir, et les réunissant par la beauté lumineuse et clairvoyante des mots. Mon coup de coeur de ce début d'année 2012.
« Une bouteille à la mer » a également été récompensé dans d’autres festivals que celui de Saint-Jean de Luz et en particulier au Festival du film de La Réunion 2011 où il a reçu le Prix du Public ;le Prix Coup de cœur du Jury Jeune ;le Mascarin de la meilleure interprétation masculine à Mahmoud Shalaby.
5. J'enrage de son absence" de Sandrine Bonnaire

Sandrine Bonnaire nous avait déjà bouleversés avec son documentaire consacré à sa sœur autiste, « Elle s’appelle Sabine », un documentaire ni larmoyant ni complaisant, deux écueils dans lesquels il aurait été si facile de tomber. Il s’agissait alors d’un véritable plaidoyer pour la mise en place de structures d’accueil pour les handicapés, aussi un hommage à ceux qui les encadrent, c’était aussi une véritable déclaration d’amour de Sandrine Bonnaire à sa sœur, un cri du cœur déchirant pour celle que 5 années d’hôpital psychiatrique changèrent à jamais mais qui joue un prélude de Bach avec la même facilité sidérante que des années auparavant. Sandrine Bonnaire parvient à nouveau, magistralement, à nous bouleverser avec son premier long-métrage de fiction, en salles le 31 octobre.
Je l’ai découvert dans le cadre de la Semaine de la Critique du Festival de Cannes 2012 et revu la semaine dernière au Festival International des Jeunes Réalisateurs de Saint-Jean-de-Luz où il était présenté en compétition et où William Hurt a reçu le prix d’interprétation masculine.
Sandrine Bonnaire et Alexandra Lamy seront, ce soir, sur France 2, les invités de l’excellente émission « Grand Public » (l’émission sur la culture qui manquait jusqu’alors, à la fois grand public, documentée, distrayante et instructive), interviewées par Aïda Touihri. Retrouvez également ma critique du film ci-dessous ainsi que mes vidéos de présentation du film réalisées à Cannes et Saint-Jean-de-Luz.
Ce film nous raconte l’histoire d’un couple, Jacques (William Hurt) et Mado (Alexandra Lamy), dont le fils est décédé accidentellement, quelques années auparavant. Lorsqu’ils se retrouvent, le père devient obsédé par le petit garçon de 7 ans que Mado a eu d’une autre union. Entre cet homme et ce petit garçon, un lien fort et inquiétant se crée dans le secret d’une cave.
Sandrine Bonnaire, pour son premier film, dès la première seconde, fait preuve d’une maitrise étonnante, d’une manière de nous « impliquer » dans son drame, avec intensité et empathie.
Le regard à la fois doux et perdu, un peu fou mais surtout fou d’amour et de la rage de l’absence, de William Hurt auquel sa caméra s’accroche souvent, y est pour beaucoup. Sa prestation (à juste titre récompensée à Saint-Jean-de-Luz) est une des plus magistrales qu’il m’ait été donné de voir et son personnage, aux portes de la folie, un des plus bouleversants de tendresse, de détresse, d’humanité. Il va peu à peu s’enterrer, se recroqueviller au propre comme au figuré, pour aller au bout de cette détresse. Quant à Augustin Legrand, il impose une belle et forte présence sans oublier le jeune Jalil Meheni, bouleversant dans la tendresse qu’il témoigne à ce deuxième père interprété par William Hurt.
Jamais Sandrine Bonnaire ne tombe dans le pathos, toujours à hauteur de ses personnages, de leur cauchemar dans lequel elle nous enferme peu à peu, créant une tension croissante, bientôt suffocante. Elle ne juge jamais ses personnages mais les comprend, les suit pas à pas dans cette descente aux enfers.
Ce sont aussi deux appréhensions du deuil. L’un qui tait sa douleur et l’autre qui la fait exploser, descend jusqu’au plus profond de celle-ci. Deux personnages abîmés par les terribles vicissitudes de l’existence et d’autant plus humains et touchants.
Sandrine Bonnaire, si elle a certainement appris beaucoup avec tous les grands cinéastes avec lesquels elle a tournés (le prénom de Mado fait ainsi songer au film éponyme de Claude Sautet, d’ailleurs ce mélange des genres peut aussi faire penser à « Quelques jours avec moi » de ce même cinéaste, un film dans lequel Sandrine Bonnaire était d’ailleurs magistrale ; elle filme par ailleurs souvent la nuque et le dos d’Alexandra Lamy comme Claude Sautet avait coutume de le faire, notamment avec Romy Schneider), elle impose, dès son premier film, un style bien à elle, et surtout un regard et un univers, marques des grands cinéastes que d’imposer ainsi d’emblée leur style.
En plus d’être une grande comédienne, Sandrine Bonnaire s’affirme donc ici comme une grande cinéaste en devenir. Elle filme la violence de la douleur avec une rage à la fois douce et âpre, sans jamais lâcher ses personnages tout comme cette douleur absolue ne les lâche jamais. Paradoxalement, un film qui fera du bien à tous ceux qui ont connu ou connaissent la douleur ineffable, étouffante et destructrice du deuil malgré un dernier plan d’une tristesse déchirante.
Avec ce film dramatique, absolument bouleversant, entre drame familial et thriller, à la fois terriblement tendre et terriblement inquiétant, Sandrine Bonnaire met des images sur l’indicible douleur et donne à William Hurt et Alexandra Lamy leurs meilleurs rôles (un premier rôle et une nouvelle fois un beau personnage de mère qui montre toute l’étendue de l’immense talent de cette dernière, à la fois ici sensuelle et terrienne) et signe une première fiction sobre, palpitante, poignante, d’une maîtrise étonnante qui vous fera chavirer d’émotion pour ces beaux personnages enragés de douleur.
6. "Louise Wimmer" de Cyril Mennegun
Je vous avais parlé de mon enthousiasme pour ce film, « Louise Wimmer » de Cyril Mennegun, suite au Festival international des jeunes réalisateurs de Saint-Jean de Luz 2011 dans le cadre duquel il était sélectionné en compétition. Depuis, le film a obtenu pas mal de récompenses. Il reste pour moi un des meilleurs films de l'année .
Synopsis « officiel » : "Après une séparation douloureuse, Louise Wimmer a laissé sa vie d’avant loin derrière elle. A la veille de ses cinquante ans, elle vit dans sa voiture et a pour seul but de trouver un appartement et de repartir de zéro. Armée de sa voiture et de la voix de Nina Simone, elle veut tout faire pour reconquérir sa vie."-
Louise Wimmer c’est une femme comme il y en a tant d’autres, que nous croisons sans le savoir, qui se drapent dans leur fierté pour dissimuler leurs malheurs. Son histoire se déroule par bribes, de judicieuses ellipses qui renforcent le caractère universel du sujet, dramatiquement actuel.
Nous devinons qu’elle s’est retrouvée à la rue suite à une séparation, ce que tout son entourage ignore. Au lieu d’en faire une femme pitoyable, Cyril Mennegun dresse le portrait une femme noble et fière et même au départ un peu antipathique que le spectateur au fil du récit, l'accompagnant dans ses échecs révoltants, prend en empathie. Corinne Masiero incarne magistralement Louise Wimmer dont le visage âpre marqué par la vie en devient beau tant Cyril Mennegun la filme avec justesse, empathie, et dignité. Elle dévore l’écran, nous happe, tant elle donne corps et âme à cette femme qui ressemble à la fois à tant d’autres et aucune autre.
Je partage l’émotion qui a submergé le délégué général du festival de Saint-Jean de Luz quand il a dû interviewer le réalisateur et son actrice juste après la projection. Une belle leçon d’humanité (mais qui, surtout ne se donne pas des airs de leçon). Sans oublier la musique de Nina Simone symbole de liberté et d’emprisonnement aussi puisque c’est la seule musique que Louise peut écouter et qui évoque la même beauté rude et douloureuse que celle de son personnage.
Cyril Mennegun est avant tout réalisateur de documentaires et son expérience nourrit prodigieusement son film qui exhale de troublants accents de réalisme, sa caméra ne quittant pas cette femme. Un film plein de vie, de violence dramatiquement quotidienne aussi, empreint d’un regard jamais complaisant.
Cyril Mennegun a ainsi raconté que c'est après avoir croisé, lors du tournage d'un documentaire, une femme qui s'appelait Corinne et vivait dans sa voiture, mais qu'il n'a "jamais pu filmer" et qu'il a "perdu assez vite", qu'est née l'idée du film, une histoire semble-t-il aussi proche de ce qu’a pu vivre la comédienne (que Cyril Mennegun dit avoir découverte dans un téléfilm diffusé un soir à la télévision). "Ce film est empreint de ce qu'elle est » a-t-il ainsi déclaré.
Un film plein de vie et, comme elle et son incroyable interprète principale (Corinne Masiero), âpre et lumineux. Ce fut le premier grand choc cinématographique de cette année 2012, à découvrir absolument. La découverte d’un cinéaste qui rappelle les plus grands cinéastes du réalisme social britannique et d’une comédienne qui porte ce film magnifiquement bouleversant et tristement universel, et qui s’achève sur une note d’espoir d’une beauté aussi simple que ravageuse.
7. "Les Adieux à la Reine" de Benoit Jacquot
Benoit Jacquot aime adapter des romans et mettre en scène des femmes comme protagonistes de ses films : Virginie Ledoyen dans « La Fille seule », Judith Godrèche dans » La Désenchantée » Isabelle Huppert dans « Villa Amalia », « L'École de la chair », « Les Ailes de la colombe », « Pas de scandale », Isabelle Adjani dans « Adolphe »…
Son dernier film, « Les adieux à la reine », ne déroge pas à la règle puisqu’il s’agit d’une adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas, et puisque c’est à travers le regard paradoxalement innocent et clairvoyant de la jeune Sidonie Laborde ( Léa Seydoux), jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine (Diane Kruger) que nous voyons Versailles, en 1789, à l’aube de la révolution. L’insouciance et la désinvolture y règnent encore tandis que, à l’extérieur, la révolte gronde. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive jusqu’à la Cour, le château se vide. Nobles et serviteurs s’enfuient. Entièrement dévouée à la Reine par qui elle se croit protégée, Sidonie souhaite rester. Benoit Jacquot nous fait vivre à ses côtés ses trois derniers jours à Versailles, les 14,15, 16 juillet 1789 : la fin d’une époque.
Comme souvent, Benoit Jacquot met en scène une réalité étouffante, la solitude de ses personnages et le désir de fuite mais quand cette réalité est celle de Versailles filmé avec une modernité et un réalisme étonnants, cela devient absolument passionnant.
Dès les premiers plans, il capte ainsi notre intérêt et notre empathie en nous mettant à la place de Sidonie (souvent filmée de dos) qui, en trois jours, va grandir en découvrant toute la violence redoutable de Versailles, la lâcheté, la vanité, derrière les visages poudrées, derrière les masques qui tombent.
Que vous aimiez ou pas les films historiques, celui-ci vous happera pour vous conduire dans les dédales mystérieux et inquiétants de Versailles pour ne plus vous lâcher jusqu’à la dernière seconde. D’abord parce que c’est un Versailles loin des clichés que nous fait ici découvrir Benoit Jacquot. Personnage à part entière, Versailles est filmé comme une prison dorée au vernis qui se craquèle, souvent moins clinquante que les fastes de la cour le laissent imaginer, et c’est à travers Versailles, lieu d’un huis-clos étouffant, que nous sont relatées ces trois journées historiques mais c’est aussi la brillante métaphore d’un monde qui se meurt, pourri de l’intérieur, tout comme cet étang apparemment impassible est gangréné par les rats, ou ces tenues dorées sous lesquelles sévissent les moustiques.
A l’image de la monarchie et de la noblesse, Versailles se décompose et derrière l’étincelante galerie des glaces se cachent des couloirs étroits, sombres et humides filmés comme un gouffre obscur et menaçant, tout comme derrière les visages poudrés et les fastes de la cour se dévoile un monde en décomposition. La caméra frémissante de Benoît Jacquot épouse et métaphorise ces frémissements et est si précise qu’il nous donne l’impression de ressentir l’humidité glaçante des couloirs de Versailles où grouille toute cette vie souterraine et fourmillante d’une noblesse qui préfère rester tapie dans des appartements délabrés dans l’ombre du roi plutôt que de vivre à la lumière de ses châteaux, une noblesse qui se contente de cette vie obscure dans l’ombre du roi avec l’obsessionnel espoir de quérir un peu de sa lumière. Intemporelle valse des courtisans qui en plus de la fin d’un monde nous parle du nôtre grâce à la modernité de la mise en scène et du jeu des acteurs qui brouillent judicieusement les repères temporels…
Ensuite, les relations troubles entre les trois femmes (la Reine, Sidonie et Madame de Polignac incarnée par Virginie Ledoyen) composées de domination, d’admiration, de manipulation, d’obsession sont absolument passionnantes car elles résument aussi toute la complexité de cet esprit de cour et des sentiments condamnés par l’intérêt et l’image, le souci des apparences là encore finalement très contemporain. Ces plans de courtisans qui courent pour apercevoir le Roi ou la Reine ou être aperçus d’eux rappellent une époque beaucoup moins lointaine avide d’images et qui s’aveugle dans l’admiration vaine et outrancière d’une autre royauté.
Diane Kruger incarne cette reine frivole (qui pense à un nouveau motif pour ses vêtements quand le peuple meurt et gronde, quand son monde périclite) et capricieuse, prisonnière de Versailles comme de ses bracelets accrochés à ses poignets, qui passe d’un état à l’autre, tantôt horripilante, tantôt bouleversante, comme lorsqu’elle trône, terriblement seule et majestueuse, dans cette pièce soudain tristement luxueuse, illuminée par le feu d’une cheminée, déchirant des lettres, tandis que les vautours rôdent déjà. Symbole d’une époque et d’un monde qui chancèlent, image bouleversante de beauté, de mélancolie, de cruauté mêlées.
Léa Seydoux, avec son visage diaphane, son regard déterminé, est absolument parfaite dans ce rôle de jeune lectrice qui, en trois jours, va vivre un parcours initiatique, passer de l’innocence à la conscience de la dure réalité, de quelqu’un à personne, et qui va fuir dans l’ombre d’une forêt, autant dire mourir puisqu’elle ne vivait que dans l’ombre lumineuse de la Reine et ces adieux à la Reine résonnent douloureusement comme des adieux à une époque, à un monde, à la vie.
Une autre excellente idée est d’avoir concentré l’action sur trois jours, trois jours au cours desquels Versailles passe de la frivolité à la panique. La caméra frénétique de Benoit Jacquot renforce ce sentiment de tension palpable et crée un suspense captivant.
Ajoutez à cela l’excellent scénario de Gilles Taurand, la musique de Bruno Coulais, la caméra vacillante de Benoit Jacquot à l’image de ce qu’elle enregistre, ce monde qui chancèle, et vous obtiendrez un des meilleurs films de cette année, passionnant du début à la fin, férocement moderne, cruellement réaliste, magnifiquement mélancolique, la brillante métaphore de la fin d’un monde, et de l’éternelle valse pathétique des courtisans qui, pour satisfaire leur orgueil et un peu de lumière ( celle de la richesse mais surtout de la célébrité) sont prêts à tout, au mépris des autres et parfois de leur propre dignité. Un tableau d’une tragique élégance aussi fascinant que terriblement cruel et mélancolique, historique et contemporain, instructif et intemporel.
8. "Elle s'appelle Ruby" de J.Dayton et V.Faris

Avec « Little miss sunshine » (dans lequel jouait d’ailleurs également le comédien Paul Dano aussi très marquant dans « There will be blood »), les réalisateurs Jonathan Dayton et Valérie Faris avaient obtenu le Grand Prix du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2006. Six ans plus tard est présenté à Deauville « Elle s’appelle Ruby », un film écrit par Zoe Kazan (petite-fille d’Elia) qui interprète ici le rôle féminin principal.
Calvin (Paul Dano) est un romancier à succès, qui peine à trouver un second souffle et se trouve confronté à la terrible angoisse de la page blanche. Encouragé par son psychiatre à écrire sur la fille de ses rêves, Calvin voit son univers bouleversé par l’apparition littérale de Ruby (Zoe Kazan) dans sa vie, amoureuse de lui et exactement comme il l’a écrite et imaginée.
Comme dans le mythe de Pygmalion et Galathée, dans lequel le sculpteur tombe amoureux de sa statue d’ivoire, Calvin va tomber amoureux de Ruby, l’étonnamment vivante création de son esprit.
« Little miss sunshine » possédait déjà ce supplément d’âme et ce ton particulier qui avaient fait d’une histoire a priori simple un film séduisant, enthousiasmant, duquel vous sortiez le sourire aux lèvres. Ces films sont rares et « Elle s’appelle Ruby » en fait également partie, d’abord parce que c’est presque une leçon d’écriture et par là une sorte de mise en abyme puisque le film tout entier est une métaphore de la création, Ruby étant la création de l’imagination débordante de Calvin, créature qu’il façonne selon ses rêves, qui prend vie puis lui échappe pour, peut-être, ne plus lui appartenir.
Un personnage qui aime Scott Fitzgerald, qui possède autant d’accents « Woodyalleniens » (Calvin consulte un psy, est plutôt maladroit avec l’existence et va trouver refuge dans ses rêves qui vont devenir réalité comme dans « La Rose pourpre du Caire » ou « Minuit à Paris ») était condamné à me plaire. Quant au personnage féminin, soigneusement écrit par Zoe Kazan, il ne se contente pas d’être une potiche mièvre (comme trop souvent dans les comédies romantiques) mais une jeune femme terriblement vivante.
« Elle s’appelle Ruby » n’est pas seulement une splendide métaphore de l’écriture, des vicissitudes des artistes et des rapports entre le créateur et sa création (Zoe est en effet une forme de projection de Calvin, une vision idéalisée et l’amour qu’elle lui inspire fait écho à l’état extatique dans lequel peut plonger l’écriture) c’est aussi un film magnifiquement écrit, qui vous emporte, vous déroute, assimile la magie de l’amour et de l’écriture qui possèdent ce pareil pouvoir de vous emmener ailleurs, de vous transporter, une magie que possède aussi ce film.
Tour à tour bouleversant ( comme dans cette scène où Calvin « dicte » ses actes à sa créature, dans un tourbillon violent et déchainé, presque cruel, une sorte de danse endiablée), irrésistible ( la scène avec la mère et le beau-père de Calvin dont je vous laisse découvrir les interprètes), plein de fantaisie (dans les dialogues, les situations mais aussi la bo avec notamment « ça plane pour moi » de Plastic Bertrand), « Elle s’appelle Ruby » est un feel-good movie qui entrelace avec subtilité tragédie et comédie. Une comédie romantique atypique pleine de charme, de délicatesse, d’intelligence qui vous rappelle que aimer c’est laisser libre (comme créer consiste à libérer sa création) et que rêver, inventer est sans doute le plus magique des pouvoirs même s’il n’est pas sans périls. Un hymne poétique et sensible à la magie délicieusement périlleuse de l’amour et de l’écriture à découvrir absolument en salles le 3 octobre 2012.
9.« Dans la maison » de François Ozon

Comme je le fais avec certains de ses ainés (Resnais, Téchiné…) du cinéma français, je m’efforce (très doux effort, d’ailleurs) de ne manquer aucun film de François Ozon, promesse toujours d’une promenade dans les méandres de son imagination fertile servie, toujours aussi, par une réalisation maligne, complice ou traitre, qui nous conduit dans les secrets, souvent enfouis ou inavoués, de l’intérieur…des âmes et/ou des habitations. Et justement, ce nouveau long-métrage librement adapté de la pièce espagnole de Juan Mayorga intitulée « Le Garçon du dernier rang » s’intitule « Dans la maison ».
Cette maison, c’est celle dans laquelle s’immisce un garçon de 16 ans, Claude (Ernst Umhauer), celle d’un élève de sa classe, Rapha(ël). C’est ce qu’il commence à raconter à son professeur de français, Germain Germain (incarné par Fabrice Luchini) dans une rédaction, un devoir donné par ce dernier demandant à ses élèves (pardon : ses apprenants) de raconter leur week end. Plus doué que les autres dont les rédactions ne sont qu’une suite de banalités désespérantes, l’élève attire son attention par son intelligence malgré (à cause de ?) son mépris de « l’odeur de la femme de la classe moyenne ». La rédaction se termine par « A suivre ». Et des suites, il y en aura beaucoup. Reprenant goût à l’enseignement, Germain le professeur aigri, écrivain raté, continue à donner des cours particuliers et à demander des rédactions à son brillant élève qui dénote parmi ses élèves à uniformes (et uniformisés) et qui continue ainsi à lui raconter et/ou inventer les suites de son aventure et de son intrusion dans la maison. Germain va alors devenir le complice, le manipulateur et la victime de cette brillante rédaction/manipulation à suivre encore et toujours…
« Dans la maison » commence avec Germain, professeur sans histoire(s), dans le hall vide et austère du lycée, à l’image de son existence, un premier plan auquel le dernier très hitchcockien (je ne vous dirai évidemment pas en quoi il consiste), au contraire riche d’histoires, fait brillamment écho. Entre les deux, François Ozon, s’amuse avec les mots, rend hommage à leur prodigieux pouvoir, à leur troublante beauté, nous donne des pistes pour mieux nous en écarter, bref, nous manipule tout comme son élève manipule son professeur par un savant jeu de mise en abyme. Jeu de doubles, de miroirs et de reflets dans la réalisation comme dans les identités : Germain Germain, les deux jumelles (très courte mais irrésistible apparition de Yolande Moreau) et évidemment la plus maligne et féroce d’entre toutes, le spectateur et Germain pareillement manipulés, voyant leur curiosité aiguisée par un autre duo Claude/Ozon.
Et c’est ce qu’est avant tout ce nouveau film de François Ozon : une brillante leçon de manipulation et (donc) surtout d’écriture et de scénario (de ce point de vue comme le prolongement de « Swimming pool » et, dans une moindre mesure, de « Sous le sable »). Tout comme Germain donne un cours d’écriture à Claude en lui parlant de personnages, d’objectifs et de conflits ou encore de ce en quoi consiste une bonne fin (« Quand le spectateur se dit Je ne m’attendais pas à ça et ça ne pouvait pas finir autrement »), Ozon nous en donne une à nous aussi, en ne suivant justement pas ce schéma habituel, pour mieux nous dérouter, manipuler, et maintenir ainsi constamment le suspense, la surprise, voire l’emprise. Nous sommes sa marionnette consentante, dans la même situation que Germain, avides de connaître ce que cache ce « A suivre », Claude étant d’ailleurs, plus qu’un brillant écrivain, surtout très habile pour encourager la fibre voyeuriste de son lecteur (enfin, de ses lecteurs, puisque Germain lit tous ses textes à son épouse). Ce n’est évidemment pas un hasard si Germain et cette dernière vont au cinéma pour voir « Match point » de Woody Allen, la plus brillante des leçons de scénario et manipulation qui soit (critique en bonus à la fin de cet article, avec celle de « Potiche » également de François Ozon).
Et puis, surtout, Ozon s’amuse. Avec les mots, faussement dérisoires ou terriblement troublants et périlleux. Avec les noms propres (Germain Germain). Avec les codes de l’art : son absurdité, parfois (scènes irrésistibles dans la galerie de l’épouse de Germain interprétée par Kristin Scott Thomas) et sa beauté, souvent (« L’art nous éveille à la beauté des choses » ). Cela pourrait devenir un thriller mais Ozon se contente d’une inquiétante normalité qui, d’un instant à l’autre, semble pouvoir dériver vers le drame, toujours latent, retenant ainsi constamment notre attention. Riche de ses influences et références : de Pasolini (« Théorème ») à Hitchcock (« Fenêtre sur cour »), ce nouveau film de François Ozon se situe quelque part entre Chabrol et Polanski mais surtout témoigne de son style bien à lui prouvant, si besoin en était, la vitalité du cinéma français qui compte parmi les meilleurs films de cette année ( dans des genres différents : « J’enrage de son absence », « Une bouteille à la mer », « Vous n’avez encore rien vu », « Les Adieux à la reine », « Comme des frères »… ).
Le jeu trouble des acteurs, les angles changeants de la caméra (souvent trompeurs et doubles, eux aussi) permettent de brouiller les repères et de mêler les genres cinématographiques, les perceptions, la fiction et la réalité, de s’amuser avec ce jeu dangereux et délectable qu’est l’écriture, avec les clichés aussi. Clichés d’une famille qui semble tout droit sortie d’une sitcom avec sa maison à la décoration proprette, le père incarné par un Denis Ménochet moustachu et réjouissant (qui se prénomme Rapha comme le fils, brouillant là aussi d’autres repères) obsédé par la Chine et le basket, le fils totalement insipide, et la mère (Emmanuelle Seigner, parfaite dans ce contre-emploi de femme au foyer) constamment plongée dans ses magazines de décoration, caricatures de la classe moyenne vue par l’esprit arrogant de Claude.
Puis il y a Luchini, plus juste que jamais, cet amoureux des mots, sublimes et périlleux, auxquels Ozon rend si bien hommage, citant justement les auteurs que l’acteur aime tant : La Fontaine, Flaubert, Céline, ou encore Dostoïevski (à qui Woody Allen faisait d’ailleurs largement référence dans « Match point ») qui transpose « des êtres pathétiques, nuls, en personnages inoubliables ». Je vous reparlerai de Luchini et de l’amour des mots demain avec mon compte-rendu de la Master class de Jean-Laurent Cochet, le maître de l’acteur qui continue d’ailleurs de le citer régulièrement.
Un film particulièrement bien écrit (sans l’être trop, écueil particulièrement difficile à éviter avec un film sur l’écriture), brillant et ludique, un labyrinthe (avec et sans minotaure) joyeusement immoral, drôle et cruel, une comédie grinçante et un jeu délicieusement pervers, qui ne pourra que plaire aux amoureux de la littérature et de l’écriture qui sortiront de la salle heureux de voir que, toujours, le cinéma et l’écriture illuminent (ou, certes, dramatisent) l’existence et, en tout cas, sortent vainqueur, et peut-être sortiront-ils aussi en ressassant cette phrase : « Même pieds nus la pluie n’irait pas danser ». A suivre…
10. "De rouille et d'os" de Jacques Audiard
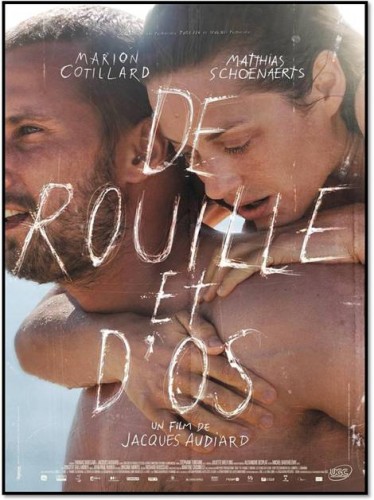
Ali (Matthias Schoenaerts) se retrouve avec Sam, 5 ans son fils qu’il connaît à peine. Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur (Corine Masiero) à Antibes. Elle les héberge dans le garage de son pavillon, elle s’occupe du petit. A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise celui de Stéphanie (Marion Cotillard). Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone. Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le spectacle tourne au drame, que Stéphanie perde ses jambes, pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Lors de la conférence de presse Jacques Audiard a ainsi évoqué des « destins simples magnifiés par les accidents », « une histoire d’amour des années de crise », « deux personnages qui tentent de s’extraire de leurs conditions. »
Jacques Audiard revient ainsi sur la Croisette et en compétition officielle avec « De rouille et d'os », adapté d’une nouvelle de Craig Davidson après avoir remporté le prix du Meilleur Scénario pour « Un héros très discret » lors de l'édition 1996 du festival, et le Grand Prix du Jury pour « Un prophète », il y a 3 ans. Cette fois, il revient avec une histoire d’amour entre deux êtres blessés (mais les personnages d’Audiard le sont finalement toujours), et comme toujours chez Audiard, pas forcément immédiatement aimables mais emportant progressivement notre adhésion. Son cinéma est à l’image de ce film et de ces deux personnages : un mélange habile et poignant de rudesse et de délicatesse. C’est un film de sensations, de chair, de corps, de sang. Le corps meurtri de Stéphanie face à celui presque animal d’Ali. Le corps brutalisé et filmé avec délicatesse, caressé presque par la caméra de Jacques Audiard (comme par le regard de Stéphanie). La dureté sublimée par une douce lumière et une chaleureuse atmosphère qui atténuent la violence (sociale) ravageuse du film. « J’ai horreur de la violence. Curieux de dire que j’ai horreur de la violence et d’y revenir tout le temps » a ainsi déclaré Jacques Audiard, ce midi, en conférence de presse.
Bien qu’ils soient très différents dans leurs manières de filmer, ce film d’Audiard en particulier m’a fait penser au cinéma des Dardenne qui, eux aussi, mettent en scène des êtres cabossés par la vie et la société (avec certes beaucoup plus de réalisme, évidemment), dont les enfants sont souvent les involontaires victimes, et ils ont bien sûr en commun une remarquable direction d’acteurs, et une force de la mise en scène, aussi différentes soient-elles.
C’est un film de contrastes et d’évolutions. De l’arrogance, ou du moins du contrôle à l’abandon. De l’impossibilité de s’exprimer à la possibilité de dire les plus beaux mots qui soient. Et surtout de la solitude à la réconciliation avec leurs proches (sœur, enfant) et avec eux-mêmes.
Un film âpre et plein d’espoir. De rouille et d’os. De chair et de sang. De rudesse et de délicatesse. De douceur et de violence. De troublants paradoxes pour un troublant film. Des contrastes à l’image de ceux de l’esthétique du film. Le (magnifique montage) met en exergue et oppose les sons, les silences, les corps, le contrôle, l’abandon. Ajoutez à cela une bande originale réussie, de la musique de Desplat à « Firework » de Katy Perry. Deux acteurs extraordinaires et extraordinairement dirigés. Comme dans « Bullhead », c’est l’animalité de son personnage que fait ressortir ici Matthias Schoenaerts, mais ici, au contraire de son personnage dans le film qui l’a révélé, il va aller vers la parole, l’humanité. Son personnage concentre aussi les contrastes du film, de même que celui de Marion Cotillard. Tous deux sont bouleversants de justesse, de dureté et de douceur, d’humanité et d’animalité, et en tout cas de fragilité masquée.
Marion Cotillard était ainsi visiblement très heureuse d’être à Cannes. Lors de la conférence de presse, elle a ainsi déclaré : « C’est ma première fois dans un film en compétition officielle à Cannes. Je ne pensais pas que ça allait me rentre si joyeuse. C’est un festival mythique qui a vu tellement de grandes histoires, de grands acteurs, de grands artistes et je suis particulièrement heureuse d’y être avec le film de Jacques» tandis que Matthias Schoenaerts a déclaré à son propos « C’est une comédienne exceptionnelle. On va dans l’absolu ». Pour Jacques Audiard, « Marion est une actrice très virile et sensuelle en même temps. Elle a une autorité dans le jeu. Elle est capable de passer de l’autre côté du mur ». Signalons enfin la présence de Corinne Masiero (dans le rôle de la sœur d’Ali), révélée par le personnage de Louise Wimmer dans le film éponyme de Cyril Mennegin.
Le Festival de Cannes commençait très fort avec ce film qui aurait pu prétendre à tous les prix, ou presque. Un film coup de poing qui fut aussi mon premier coup de cœur de cette édition 2012. Un film sensoriel magistralement monté, joué, pensé et mis en scène.
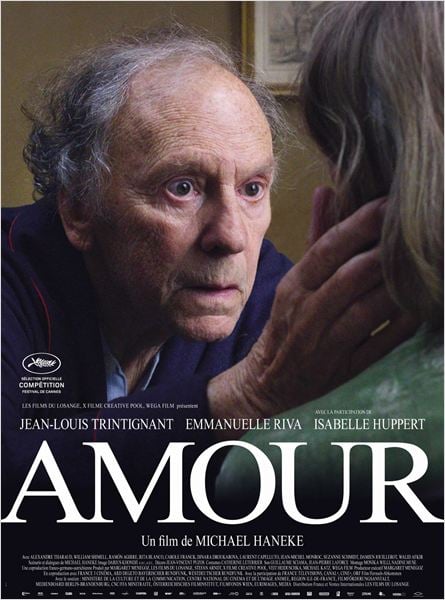
« Amour » de Michael Haneke présente plusieurs points communs avec mon autre coup de coeur du Festival de Cannes 2012 ( « J’enrage de son absence » de Sandrine Bonnaire, présenté à la Semaine de la Critique) malgré des différences formelles évidentes: d’abord leurs titres pourraient être interchangeables et ensuite parce que j’ai été submergée par l’émotion par ces deux films. Enfin, l’un et l’autre parlent d’amour inconditionnel et de la violence de l’absence, du départ, du silence. En bonus, retrouvez également, en bas de cet article, ma critique de l’autre palme d’or de Michael Haneke « Le ruban blanc ».
Mais revenons à « Amour », film au titre à la fois sobre, sibyllin et prometteur dans lequel Isabelle Huppert interprète la fille de Georges (Jean-Louis Trintignant) et d’Anne (Emmanuelle Riva), deux octogénaires, des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Egalement musicienne, elle vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.
Dès le début, la gravité, l’austérité, le dénouement inéluctable s’imposent. La caméra explore les pièces d’un appartement pour arriver dans une chambre où une femme âgée git, paisible, morte. Puis, flashback: le couple rentre d’un concert de musique classique dont on ne voit d’ailleurs que les spectateurs comme un miroir de ce que nous allons être pendant tout ce film, les spectateurs de l’envers du décor, de ce que la société préfère habituellement cacher, dissimuler. Lorsqu’ils rentrent, ils constatent que leur porte a été vraisemblablement forcée. Les prémisses d’une tragédie, d’un huis-clos dramatique. Un étranger s’est immiscé dans leur doux quotidien. La mort qui va peu à peu tisser sa toile.
La tendresse de leurs gestes, la manière dont ils s’excusent constamment, se considèrent, se regardent, semblent se découvrir encore, ne s’être pas tout raconté, avoir encore des secrets et plus que jamais des égards l’un pour l’autre, tout dit un amour qui n’a pas pris une ride mais qui s’est renforcé face aux épreuves de la vie. Notre souffle est suspendu, notre attention est captée, capturée, par ces gestes a priori anodins qui témoignent de leur amour indéfectible et magnifique. Leurs visages rayonnent, nous font oublier le poids des ans.
Cela pourrait être le couple d’ « Un homme et une femme », 46 ans plus tard (Emmanuelle Riva s’appelle d’ailleurs Anne comme Anouk Aimée dans le film de Claude Lelouch). Bien entendu, le cinéma d’Haneke, si épuré, est très différent de celui de Lelouch, si lyrique, mais ces détails qui disent tant et auxquels notre souffle est suspendu les rapprochent ici (au risque d’en heurter certains). L’opposé du couple du « Chat » de Granier-Deferre.
Jusqu’où peut-on aller par amour ? L’amour, le vrai, ne consiste-t-il pas à tout accepter, même la déchéance, à aider l’être aimé jusqu’au dernier souffle ? Le sujet était ô combien périlleux. Si Haneke ne nous épargne rien de ces moments terribles comme lorsque cette femme belle et fière se transforme peu à peu en enfant sans défense, il place sa caméra toujours avec pudeur.
Nous ne quitterons alors plus cet appartement pour un face à face douloureux, cette lente marche vers la déchéance puis la mort. Seules quelques visites comme celles de leur fille, d’un ancien élève, de voisins qui les aident, ou d’infirmières viennent ponctuer ces terribles instants, témoignant à chaque fois de maladresses, voire de cruauté involontaires. La scène de l’infirmière qui, avec une voix mielleuse, s’adresse à Anne comme à une enfant, la forçant avec une douce et d’autant plus terrible condescendance à se regarder dans le miroir est redoutablement juste et absolument terrible.
Que dire de Jean-Louis Trintignant et Emmanuelle Riva qui seraient à la hauteur de leurs bouleversantes prestations ? Le premier, qu’il raconte une anecdote sur son enfance, ou s’occupe d’Anne dans ses derniers instants avec une tendresse infinie (comment ne pas être bouleversé quand il lui raconte une histoire, lui caressant doucement la main, pour faire taire sa douleur, qu’elle hurle), est constamment juste, là, par un jeu d’une douce intensité. Ses gestes, sa voix, son regard, tout traduit et trahit son émotion mais aussi la digne beauté de son personnage qu’il dit être son dernier, ce qui rend ce rôle encore plus troublant et tragique. Quant à Emmanuelle Riva, elle fait passer dans son regard l’indicible de la douleur, de la détresse, après avoir fait passer la fierté et la force de cette femme debout, cette âme forte qui se transforme peu à peu en un corps inerte, pétri de douleurs.
Un film tragique, bouleversant, universel qui nous ravage, un film lucide, d’une justesse et d’une simplicité remarquables, tout en retenue. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse. C’est aussi ce qu’il nous reste de ce film, l’essentiel, l’Amour avec un grand A, pas le vain, le futile, l’éphémère mais l’absolu, l’infini.
Trois ans après sa palme d’or pour « Le ruban blanc », Michael Haneke méritait évidemment de l’obtenir à nouveau pour ce film éprouvant et sublime, d’une beauté tragique et ravageuse que vous hante et vous habite longtemps après la projection, après ce dernier plan d’une femme seule dans un appartement douloureusement vide. Un film d’Amour absolu, ultime. Et puis il y a la musique de Schubert, cet Impromptu que j’ai si souvent écouté et que je n’entendrai sans doute plus jamais de la même manière. Je crois qu’il me faudra un peu de temps encore pour appréhender pleinement ce film. Les mots me manquent encore.
12. "Comme des frères" d'Hugo Gélin

Nombreuses sont les comédies françaises à être sorties depuis le début de l’année (sans doute le reflet d’une frilosité des producteurs se disant qu’en période de crise, le public est friand de ce genre) et rares sont malheureusement celles à se démarquer et surtout à être autre chose qu’une suite de sketchs (certes parfois très drôles), sans véritable scénario ni mise en scène. Je vous parle d’ailleurs rarement de comédies ici mais je tenais à le faire pour celle-ci pour différentes raisons…
« Comme des frères », c’est l’histoire de trois hommes de trois générations différentes, Boris (François-Xavier Demaison), Elie (Nicolas Duvauchelle) et Maxime (Pierre Niney) qui, a priori, n’ont rien en commun, rien si ce n’est Charlie (Mélanie Thierry), à qui ils étaient tous liés par un sentiment fort et singulier, et qui vient de mourir. Comme elle le leur avait demandé, ils décident de faire ensemble ce dernier voyage qu’elle aurait voulu faire avec eux, direction la Corse et la maison que Charlie aimait tant. 900kms ensemble avec, pour point commun, l’ombre de la lumineuse Charlie, leur chagrin…un voyage après lequel plus rien ne sera tout à fait pareil.
Dès le début de ce film se dégage un charme inexplicable (pléonasme, non ?) qui vous accroche et attache aux protagonistes pour ne plus vous lâcher… Les frères Dardenne (dans un genre de film certes radicalement différent) répètent souvent que ce sont les personnages qui comptent avant les idées et, si la plupart des comédies se contentent d’une bonne idée et d’un bon pitch, négligeant leurs personnages, ici, dans l’écriture du scénario, Hérvé Mimran ( coauteur/coréalisateur d’une autre comédie très réussie qui d’ailleurs présentait aussi cette qualité: « Tout ce qui brille »), Hugo Gélin et Romain Protat, se sont d’abord attelés à construire des personnages forts et particulièrement attachants : le jeune homme lunaire de 20 ans, le trentenaire scénariste noctambule, et l’homme d’affaires, quadragénaire et seul. Trois personnages qui, tous, dissimulent une blessure.
Le chagrin et la personne qui les réunissent annihilent la différence d’âge même si elle est prétexte à un gag récurrent (et très drôle) sur les goûts parfois surannés du personnage de François-Xavier Demaison qui apporte toute sa bonhomie mélancolique et attendrissante et la justesse de son jeu à cet homme qui n’arrive pas -plus- à aimer depuis Charlie. L’autre bonne idée est en effet le casting : outre François-Xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle est également parfait, et surtout Pierre Niney ( pensionnaire de la comédie française depuis 2010), découvert au Festival du Film de Cabourg 2011 (où il a cette année reçu le prix de la révélation masculine) dans le très beau premier long-métrage de Frédéric Louf « J’aime regarder les filles » dans lequel il incarnait un personnage d’une maladroite élégance, à la fois léger et grave, immature et obstiné, autodestructeur et volontaire, audacieux et inconscient. Ici il est lunaire, burlesque même, immature (mais finalement pas tant que ça), attachant, et cache lui aussi derrière sa maladresse, une blessure. Pas étonnant que les propositions pleuvent après sa nomination aux César 2012 pour cet acteur par ailleurs humble et sympathique, ce qui ne gâche rien…
Si je vous parle du film de Frédéric Louf, c’est qu’il présente un autre point commun avec le film d’Hugo Gélin : cette vitalité si chère à Truffaut (« Le cinéma c’est la vitalité » disait-il) qui parcourt tout le film. Une vitalité, un sentiment d’urgence, une conscience du dérisoire de l’existence, de sa beauté mélancolique aussi, et de la tendre ironie qu’inspirent souvent les drames de l’existence, qui changent à jamais le regard sur celle-ci, et que ce film parvient magnifiquement à retranscrire.
Hugo Gélin ne recourt jamais au pathos, l’écueil dans lequel il aurait été si facile de tomber avec un tel sujet, mais montre au contraire qu’une révoltante et cruelle injustice de l’existence, peut donner une autre saveur à celle-ci , le goût de l’essentiel et qu’elle peut avoir la capacité de (re)créer des liens, ici quasiment fraternels. Plutôt que de nous montrer Charlie malade et agonisante, il nous la montre telle que la voyaient ses trois amis, radieuse, viscéralement vivante et lumineuse, par une série de flashbacks judicieusement amenés qui retracent le lien si particulier que chacun d’entre eux entretenait avec elle mais aussi la manière dont le quatuor devenu trio s’est construit avec, notamment, la très belle scène chaplinesque sur leur première rencontre, intelligemment placée au dénouement.
Le scénario (qui a le mérité d’être original, de n’être pas l’adaptation d’une BD ou d’un livre, ou la transposition de sketchs d’humoristes désireux de passer derrière et/ou devant la caméra comme c’est très-trop-souvent le cas), sensible, qui nous révèle les liens entre les personnages par petites touches et alterne intelligemment entre rires et larmes, est aussi servi par des dialogues savoureux. Tant pis si certains aspects sont peut-être plus prévisibles comme le prénom donné au bébé de l’un d’entre eux, cela fait aussi partie des codes de ce genre de film.
De ces trois (quatre)-là, vraiment irrésistibles, émane une belle complicité, une alchimie même, à cause de laquelle ou plutôt grâce à laquelle nous les laissons avec regrets nous frustrant presque de n’en savoir pas plus… Un quatuor qui m’a parfois rappelé celui de « Père et fils » de Michel Boujenah qui mettait ainsi en scène un père et ses trois fils. Le tout est servi par une belle photographie signée Nicolas Massart ( avec des plans que certains cyniques jugeront sans doute clichés, comme ce plan de soleil, reflet d’un nouveau jour et de l’espoir qui se lèvent), un film d’une gravité légère à la fois tendre et drôle, pudique et espiègle: en tout cas, charmant et qui prouve qu’une comédie peut sonner juste et actuelle sans recourir systématiquement au trash ou au cynisme.
Ajoutez à ce casting impeccable, ce scénario et ces dialogues réjouissants, cette photographie lumineuse, la musique ensorcelante du groupe Revolver (quelle bonne idée d’ailleurs! J’en profite pour vous signaler qu’ils seront à l’Olympia le 25 octobre prochain !) et vous obtiendrez ce road movie attachant et la comédie tendrement mélancolique de l’année qui, comme chez Claude Sautet, célèbre l’amitié, qu’elle soit amoureuse ou plus fraternelle et vous fait furieusement aimer la vie. Alors, n’attendez plus, allez voir sans hésiter Boris, Elie, Maxime et les autres!
« Comme des frères » vient d’être récompensé aux festivals de cinéma de La Réunion et de Sarlat et Pierre Niney fait partie des révélations pour le César du meilleur espoir masculin 2013.
13. « Au-delà des collines » de Cristian Mungiu

« Alina (Cristina Flutur) revient d’Allemagne pour y emmener Voichita (Cosmina Stratan), la seule personne qu’elle ait jamais aimée et qui l’ait jamais imée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour, il est difficile d’avoir Dieu comme rival. »
Ce film s’inspire de deux livres de la journaliste Tatiana Niculescu qui traitaient de l’affaire dite de Tacanu, de 2005 : une jeune religieuse schizophrène avait été retrouvée morte après un exorcisme.
Certaines des jurées du Prix Elle auquel ce film concourait et dans le cadre duquel je l'ai découvert l'ont trouvé lent et ennuyeux alors, que, au contraire, je n’ai pas vu passer ses 2H30 tant chaque plan d’une beauté –souvent sombre-picturale, trouve sa justification ultérieure, tant chaque seconde du film apporte un élément comme une preuve accablante, tant cette lenteur aussi concilie la forme et le fond, reflétant ainsi le rythme de vie au ralenti de ce couvent chrétien orthodoxe mais aussi cette forme de lancinante indifférence qui se révèlera meurtrière.
La situation de l’intrigue dans ce couvent importe (presque) peu, le réalisateur ne condamne pas forcément plus la religion que tout autre groupe. Sa portée est beaucoup plus universelle et peut s’appliquer à n’importe quel groupe dans lequel l’indifférence peut tuer (une dictature comme celle qui exista en Roumanie), dans lequel le silence ou l’effet de groupe peuvent être meurtriers.
Le souci du détail, la véracité qui en émane lui procurent un intérêt presque documentaire et les longs plans séquences parfois fixes sont d’une justesse et parfois d’une cruauté (non à cause de ce qui se passe mais plutôt à cause de ce qui ne se passe pas) terrifiantes. Le film fait aussi preuve d’un symbolisme appuyé qui se justifie ici entièrement par le fait que la religion est justement affaire de symboles.
Une histoire de foi redoutablement universelle empreint de l’implacable douleur d’un meurtre commis par innocence. Un double prix d’interprétation à Cannes entièrement justifié tant les deux protagonistes semblent vivre et non jouer, que ce soit la retenue pour l’une, la fougue pour l’autre, avec des regards pareillement enflammés par une foi (en l’amour, en Dieu) différente pour chacune. Bouleversant. Cinq ans après la palme d’or, ce film coproduit par les Dardenne méritait aussi son prix du scénario pour sa justesse et tant chaque seconde du film semble être « utile » (j’oserais même le comparer à un film policier dans lequel les preuves s’accumulent) et justifier son terrible dénouement.
14. "J.Edgar"de Clint Eastwood
Clint Eastwood fait partie de ces réalisateurs dont j’essaie de ne manquer aucun film (il faut dire que, depuis 2005, il est particulièrement prolifique), en particulier depuis « Sur la route de Madison », sans aucun doute un des plus beaux films d’amour de l’histoire du cinéma (auquel je suis beaucoup plus sensible qu’à « Million dollar baby », trop larmoyant à mon goût). En 2010, avec « Au-delà » il avait déçu beaucoup de spectateurs (une déception que je ne partageais pas) alors que, pourtant, ce film était aussi, à l’image de « Sur la route de Madison », un hymne à ces instants fugaces et intenses qui modifient le cours du destin, mais aussi le message d’un homme hanté par la mort comme en témoignait aussi déjà « Gran Torino ».
«Au-delà » n’est certes certainement pas le film trépidant que certains attendaient mais au contraire un film à hauteur d’hommes qui tisse peu à peu sa toile d’émotions en même temps que les destins de ses personnages et qui laisse une trace d’autant plus profonde et aboutit à un final d’autant plus bouleversant que le cheminement pour l’atteindre a été subtil et délicat et que tout le justifiait. Une réflexion sur la mort mais surtout un hymne à la vie (au-delà de la douleur, au-delà de la perte), à l’espoir retrouvé (qui n’est pas dans l’au-delà mais dans le dépassement de son appréhension et donc bel et bien là), à la beauté troublante et surprenante du destin.
D’une certaine manière, dans « J.Edgar », Clint Eastwood réunit les thématiques des trois films évoqués ci-dessus : Gran Torino (la hantise de la mort et de la trace laissée après celle-ci), « Sur la route de Madison » (une histoire d’amour condamnée à l’ombre) et « Au-delà » (les rouages du destin).
« J.Edgar » (Leonardo DiCaprio), c’est Hoover, cet homme complexe qui fut directeur du FBI de 1924 à sa mort, en 1972, soit pendant 48 ans. 48 années pendant lesquelles il a vu se succéder pas moins de 8 présidents. L’action du film débute ainsi dans les années 70. Pour préserver son héritage. Hoover dicte alors ses mémoires et se replonge dans ses souvenirs qui le ramènent en 1919. Il n’avait alors que 20 ans, était déjà ambitieux, orgueilleux et autoritaire et on ne le nommait pas encore J.Edgar.
Dès les premiers plans, trois éléments qui ne se démentiront pas tout au long du film, sautent aux yeux du spectateur (aux miens, du moins) : la beauté sombre de la photographie de Tom Stern (fidèle chef opérateur de Clint Eastwood), l’art avec lequel Clint Eastwood s’empare du scénario de Dustin Lance Black pour entremêler passer et présent, et pour nous raconter brillamment une histoire et enfin le jeu stupéfiant et remarquable de Leonardo Di Caprio qui, bien au-delà du maquillage, devient Hoover. Au moins trois éléments qui font de ce film un bonheur cinématographique…même s’il n’est pas exempt de défauts comme certaines longueurs ou certaines scènes trop appuyées et mélodramatiques.
Derrière ce que certains nommeront peut-être classicisme, Clint Eastwood démontre une nouvelle fois son habileté à tisser la toile du récit pour dresser le portrait complexe d’un homme dont la vie était basée sur le secret (ceux qu’il dissimulait et ceux des autres qu’il utilisait notamment ceux qu’il détenait sur les hommes du pouvoir qu’il manipulait sans scrupules, ce qui explique ici sa longévité à la tête du FBI) qui aspirait à être dans la lumière mais dont l’existence était une zone d’ombre, deux contrastes que la photographie de Tom Stern reflète magnifiquement. En un plan de Hoover sur son balcon, regardant les cortèges d’investiture de Roosevelt puis de Nixon, à plusieurs années de distance, il nous montre un homme dans l’ombre qui semble n’aspirer qu’au feu des projecteurs mais qui, aussi, de son piédestal, semble néanmoins être le démiurge de la scène qui se déroule en contrebas. Tout un symbole. Celui de ses contradictions.
Si les agents du FBI aimaient se présenter comme les « gentils », la personnalité de Hoover était beaucoup plus complexe que l’image qu’il souhaitait donner de l’organisation qu’il dirigeait et de lui-même : avide de notoriété, recherchant l’admiration et l’amour de sa mère, dissimulant son homosexualité, manipulant les politiques. Pour lui « l’information, c’est le pouvoir ».
Cette personnalité complexe (et ce qui conduisit Hoover à devenir J.Edgar) nous est expliquée à travers ses relations avec trois personnes : sa mère, Annie Hoover ( Judi Dench) qui lui voyait un destin et voulait qu’il compense les échecs de son père et dont il recherchera toujours l’admiration, sa secrétaire Helen Gandy (Naomi Watts) qui lui restera toujours fidèle depuis ses débuts et même après sa mort, et son directeur adjoint Clyde Tolson (Armie Hammer) avec qui il entretint vraisemblablement une liaison.
Si l’histoire de Hoover nous permet de traverser l’Histoire des Etats-Unis, la seconde est bien en arrière-plan et c’est bien à la première que s’attache Eastwood, de son rôle dans l’instigation des méthodes modernes d’expertises médico-légales mais aussi à ses tentatives (vaines) pour faire tomber Martin Lurther King, son combat obstiné et même obsessionnel contre le communisme et évidemment la création du FBI et l’enlèvement du fils de Lindbergh, deux évènements qui témoignent de l’ambition de Hoover et de ses méthodes parfois contestables pour la satisfaire.
Le film de Clint Eastwood épouse finalement les contradictions de son personnage principal, sa complexité, et a l’intelligence de ne pas faire de Hoover un héros, prétexte à un film à la gloire des Etats-Unis mais au contraire un personnage qui en symbolise l’ombre et la lumière et surtout ce désir d’être dans la lumière (manipulation des médias mais aussi propagande avec des albums de bd consacrés au FBI et des vignettes ornant les paquets de corn-flakes) comme le revers de la médaille d’un American dream dont l’image se voudrait lisse et irréprochable.
La réussite du film doit évidemment beaucoup à celui qui incarne Hoover et qui tourne pour la première fois pour Eastwood : Di Caprio dont le maquillage n’est pour rien dans l’étonnante nouvelle métamorphose qui le fait devenir Hoover, avec sa complexité, son autorité, son orgueil, ses doutes qui passent dans son regard l’espace d’un instant, lorsque ses mots trahissent subitement son trouble et le font alors redevenir l’enfant en quête de l’amour de sa mère qu’il n’a finalement jamais cessé d’être derrière ce masque d’intransigeance et d’orgueil (très belle scène avec Noami Watts dans la bibliothèque du Congrès ou dans la suite avec Clyde, scènes au cours desquelles il passe d’une expression ou une émotion à une autre, avec une rapidité fascinante). Une nouvelle composition magistrale. Déjà dans « Shutter island », il était habité par son rôle qui, en un regard, nous plongeait dans un abîme où alternaient et se mêlaient même parfois, angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi (interprétation tellement différente de celle des "Noces rebelles" mais tout aussi magistrale qui témoigne de la diversité de son jeu). Il n’avait pourtant obtenu l’Oscar du meilleur acteur pour aucun de ces deux films, il ne l’a d’ailleurs jamais obtenu. Est-ce possible que celui qui est sans doute le plus grand acteur actuel passe une nouvelle fois à côté ? J’avoue que mon cœur balance sachant que Jean Dujardin sera sans doute nommé face à lui pour « The Artist ». Vous pourrez aussi le retrouver bientôt dans une nouvelle adaptation du chef d’œuvre de Fitzgerald « Gatsby le magnifique » même si je vous recommande surtout la version de Jack Clayton.
En nous racontant avec une maîtrise incontestable des codes du récit l’histoire d’un homme soucieux du secret, de la trace qu’il laissera, de sa et ses mémoire(s) (et de sa subjectivité), de ses zones d’ombre, Clint Eastwood, par-delà la personnalité complexe et passionnante de Hoover traite d’un sujet particulièrement personnel (un homme qui se penche sur son passé, pétri de contradictions entre le culte du secret et l’envie d’être dans la lumière ) et universel et actuel (la manipulation des médias, le désir avide de notoriété). La marque d’un grand cinéaste. Et enfin, il permet à celui qui est le meilleur acteur actuel d’explorer une nouvelle facette de son immense talent et de trouver là un nouveau rôle, complexe et passionnant, à sa démesure et qui le mènera peut-être, enfin, à l’Oscar tant mérité.
Retrouvez également cet article sur mon blog "In the mood - Le Magazine": http://inthemoodlemag.com/2012/01/06/cinema-critique-de-j...
15. "L'homme qui rit" de Jean-Pierre Améris
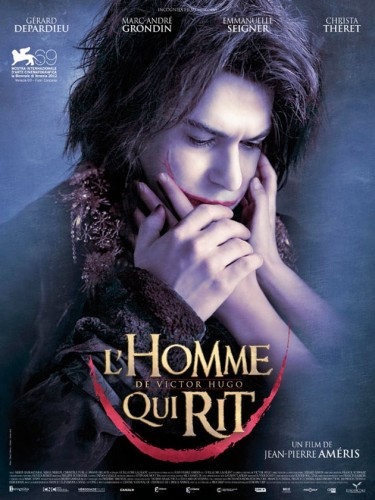
Comme étais-je passée à côté de ce roman de Victor Hugo ? Mystère… La sortie du film a pour moi été l’occasion de cette magnifique découverte, d’un texte ardu mais passionnant, riche de multiples digressions, d’une langue admirable (évidemment), et surtout d’un personnage monstrueusement séduisant auquel tous ceux qui se sont un jour sentis différents pourront s’identifier : Gwynplaine sur lequel Jean-Pierre Améris a eu la bonne idée de centrer son film.
Alors que la tempête de neige fait rage, Ursus (Gérard Depardieu), le forain en apparence revêche mais généreux, recueille deux orphelins dans sa roulotte. Le premier de ces deux orphelins, c’est Gwynplaine, un jeune garçon dont une cicatrice qui ressemble à un rire insolemment triste barre le visage, l’œuvre des Comprachicos (un mot qui est une invention de Victor Hugo provenant de l'espagnol comprar -qui signifie acheter- et chicos -qui signifie enfant- signifiant donc «acheteurs d’enfants»), spécialisés dans le commerce d'enfants, qu'ils achètent ou volent et revendent après les avoir mutilés. L’autre enfant, c’est Déa une petite fille aveugle que ce dernier a trouvée sur son chemin. Quelques années plus tard, ils sillonnent toujours les routes et présentent un spectacle dont Gwynplaine (Marc-André Grondin) alors adulte, est devenu la vedette, accompagné de Déa (Christa Théret), également sur scène. Partout, on souhaite voir « L’homme qui rit » celui qui fait rire et émeut les foules mais un autre théâtre, bien plus redoutable, celui de l’aristocratie, va l’éloigner de ceux qu’il aime et qui l’aiment…
Hugo a écrit « L’homme qui rit » entre 1866 et 1869 durant son exil politique dans les îles Anglo-Normandes. Adapter les 750 pages de ce roman était un véritable défi tant le roman est foisonnant, allégorique aussi, et tant l’auteur digresse sur la politique, la philosophie et même l’architecture. Jean-Pierre Améris et Guillaume Laurant (notamment scénariste de films de Jean-Pierre Jeunet dont « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain ») ont réalisé un incroyable travail d’adaptation et ont eu l’excellente idée de transposer le roman qui se déroule dans l’Angleterre du XVIIème sicèle dans un lieu et une époque imprécis (le film a été tourné en studios à Prague) et surtout d’en faire un conte sombre, et ainsi fascinant. Pour rendre l’histoire plus moderne et accessible, Jean-Pierre Améris a volontairement utilisé des éléments plus contemporains, pour les dialogues mais aussi pour les costumes, comme l'avaient fait Baz Luhrmann pour "Roméo et Juliette" ou Sofia Coppola pour "Marie-Antoinette".
Dès les premiers plans dans la neige et la tempête, la poésie lugubre et la féérie sombre des images captivent. Du roman baroque d’Hugo Jean-Pierre Améris a fait une fable intemporelle d’une beauté triste mais ensorcelante. C’est un magnifique roman (et film) sur la différence, la dualité, entre blancheur et noirceur, entre beauté et laideur, entre théâtre et réalité, entre aveuglement et clairvoyance, des contrastes que l’esthétique du film souligne magnifiquement et dont elle souligne aussi les paradoxes. « Qu’est-ce que ça veut dire être laid ? Laid c’est faire le mal ! Toi tu me fais du bien », résume si bien l’aveugle et sensible Déa.
La vie est à la fois sublimée et plus réelle sur les planches comme elle peut l’être dans « Le Carrosse d’or », « Les enfants du paradis », « Le dernier métro » et c’est là que l’amour impossible de Déa (la jeune aveugle qui voit la beauté de l’âme, allégorie simple et tellement magnifique) et Gwynplaine est le plus éclatant. La monstruosité, le théâtre, la noirceur se situent finalement dans la réalité et du côté de l’aristocratie comme dans le « Ridicule » de Patrice Leconte. « Ne quitte jamais les planches. Ici les gens t’aimeront, mais dans la vie réelle, ils te feront souffrir » le prévient pourtant Ursus mais pour son plus grand malheur, Gwynplaine ne l’écoutera pas…
Jean-Pierre Améris (dont j’ai découvert le cinéma avec « C’est la vie » et « Poids léger » que je vous recommande vivement et dont le dernier film « Les Emotifs anonymes » était une comédie très réussie), pour son 12ème film, est une nouvelle fois attiré par une histoire de marginaux qu’il sait si bien comprendre et pour lesquels il sait si bien susciter de l’empathie. Il a ainsi fait de Gwynplaine un personnage éminemment séduisant : innocent, révolté, libre, d’une laideur attrayante. Gwynplaine est moins connu que Quasimodo et pourtant sa belle monstruosité a énormément inspiré les artistes, à commencer par Tim Burton pour « Edward aux mains d’argent ». Le film de Jean-Pierre Améris, sans jamais le singer, m’a d’ailleurs beaucoup fait penser à l’univers du cinéaste américain par sa beauté baroque, entre rêve et cauchemar, par ses personnages d’une beauté étrange et fascinante (très felliniens, aussi), par sa mise en scène inspirée. Tim Burton n’était d’ailleurs pas le seul à avoir été inspiré par Gwynplaine. Les dessinateurs Jerry Robinson et Bob Kane reconnaissaient ainsi volontiers s’être inspirés de Gwynplaine pour le personnage du Joker, dans les comics Batman. Et le roman d’Hugo est longuement évoqué dans « Le Dahlia noir » de James Ellroy, présent également dans l'adaptation cinématographique de Brian De Palma.
C’est aussi un très bel hymne à la différence, et à ceux qui se battent pour les autres (Hugo était un écrivain engagé, Jean-Pierre Améris, l’est aussi à sa manière dans chacun de ses films ou même teléfilms comme « Maman est folle »). Magnifique scène de la tirade au Parlement ! Il s’agit d’un discours exalté dans lequel Marc-André Grondin met beaucoup d’éloquence et de conviction : « Ce qu’on fait à ma bouche, c’est ce qu’on fait au peuple. On le mutile » dit-il notamment (le texte, magnifique, est là repris de Hugo). Marc-André Grondin apporte toute sa beauté, sa fraîcheur à ce homme bouleversant caché derrière ce masque tragiquement rieur, se mettant ainsi à nu, dévoilant son visage mais surtout sa belle âme, face à la vraie monstruosité.
Le film bénéficie aussi d’un casting impeccable : outre Marc-André Grondin, Gérard Depardieu impose sa force tranquille et sa générosité (au passage, que les pseudo-politiquement corrects laissent tranquille cet homme terriblement libre, vivant, cet immense artiste, plutôt que d’utiliser sa vie personnelle pour, probablement, exprimer une certaine rancœur, voire jalousie, et qu’ils s’engagent et mettent leur énergie vindicative au service de causes qui en sont vraiment). J’espère que cela permettra aussi à certains de découvrir Swann Arlaud que j’avais découvert au Festival de Cabourg dans le court-métrage « Alexis Ivanovich vous êtes mon héros » de Guillaume Gouix dans lequel il incarne admirablement un personnage radieux et joyeusement désinvolte qui, en une fraction seconde, blessé dans son orgueil, va tout remettre en question, découvrant ne pas être le héros qu’il aurait aimé être aux yeux de son amoureuse. Emmanuelle Seigner est une incarnation sublime de la tentation diabolique et finalement, malgré tout, touchante (comme chez Hugo, même ou car monstrueux, ses personnages restent humains), et comme elle le dit elle-même, le visage de Gwynplaine est le reflet de son âme sombre. Enfin, Christa Théret dont le visage est si expressif (à voir aussi absolument dans « Renoir », dans un rôle très différent dans lequel elle excelle également) est la tentation angélique, incarnation du mélange de force et de fragilité, d’aveuglement et de clairvoyance.
Mon seul reproche concerne le montage, et la durée, l’impression que la fin est un peu brusque…et que sans digresser autant que le fait Hugo dans son livre, le film aurait encore gagné en densité en gagnant un peu en longueur.
Ce film est néanmoins vraiment un enchantement, un enchantement mélancolique, la forme reflétant ainsi le fond et toutes les sublimes dualités que l’histoire recèle. C’est aussi un opéra moderne ( la musique a été enregistrée à Londres avec un orchestre de 65 musiciens et elle apporte une force lyrique au film) . C’est également une histoire d’amour absolu, idéalisée, intemporelle (elles sont trop rares au cinéma pour s’en priver). C’est enfin un film universel au dénouement bouleversant. N’ayez pas peur de l’humour grinçant, la noirceur, la tragédie, ils sont sublimés par un personnage émouvant qui à la fois nous ressemble si peu et tellement (pour peu que nous nous sentions un tout petit peu différents) et un univers fascinant, poignant : celui d’un conte funèbre et envoûtant. La très belle surprise de cette fin d’année.
Quelques citations extraites du livre « L’homme qui rit » de Victor Hugo, pour terminer :
« Les aristocrates ont pour orgueil ce que les femmes ont pour humiliation, vieillir. »
« De telles innocences dans de telles ténèbres, une telle pureté dans un tel embrassement, ces anticipations sur le ciel ne sont possibles qu'à l'enfance, et aucune immensité n'approche de cette grandeur des petits. »
« Ca doit se fourrer dans des trous, le bonheur. Faites-vous encore plus petits que vous n'êtes, si vous pouvez. Dieu mesure la grandeur du bonheur à la petitesse des heureux. Les gens contents doivent se cacher comme des malfaiteurs. »
« Deux coeurs qui s'aiment, n'allez pas chercher plus loin la poésie; et deux baisers qui dialoguent, n'allez pas chercher plus loin la musique. »
L’homme qui rit a été présenté en clôture de la 69ème Mostra de Venise
Sortie en salles : le 26 décembre 2012
Retrouvez également cet article sur mon site http://inthemoodlemag.com : http://inthemoodlemag.com/2012/12/21/avant-premiere-criti...
A ce classement il faudrait ajouter d’autres coups de cœur (outre les coups de cœur en festivals évoqués dans l’article ci-dessus comme "Himizu" de Sono Sion) : « Laurence Anyways », "Reality" , « To Rome with love », « Royal affair ». Peut-être en ajouterai-je à cette liste puisqu’il me reste encore quelques films de cette année à rattraper.

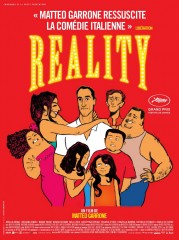

Mes bilans des autres années :
Je vous donne rendez-vous dès demain pour mes premiers articles sur l’actualité cinématographique 2013 avec les critiques de « Renoir » de Gilles Bourdos (ainsi que le récit de la rencontre avec Michel Bouquet et des places à gagner pour le film) et « Django unchained » de Quentin Tarantino.

Les 6 blogs inthemood: http://inthemoodlemag.com , http://inthemoodforfilmfestivals.com , http://www.inthemoodforcinema.com , http://www.inthemoodforcannes.com , http://www.inthemoodfordeauville.com
Les comptes twitter: @moodforcinema (compte principal), @moodforcannes, @moodfdeauville, @moodforfilmfest, @parallelshadows, @moodforluxe
Les pages Facebook: http://facebook.com/inthemoodforcinema , http://facebook.com/inthemoodforcannes , http://facebook.com/inthemoodfordeauville