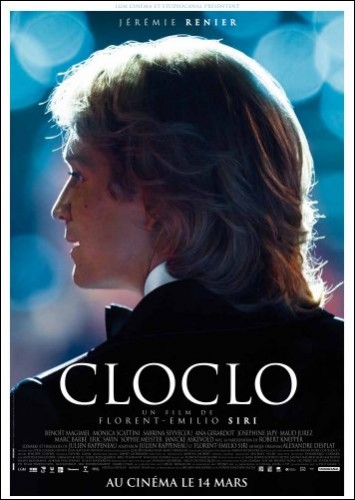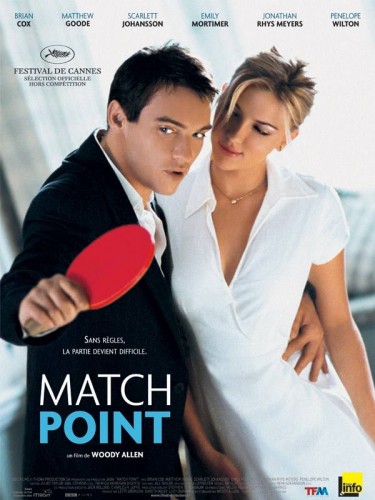Les Oscars 2016 ont enfin couronné Leonardo DiCaprio pour ce film (son premier Oscar après 5 tentatives, sans compter tous les films pour lesquels il n’était pas nommé et l’aurait mérité – Cliquez ici pour retrouver mes 7 critiques de films avec DiCaprio- ). Ils ont également récompensé son réalisateur pour la deuxième année consécutive. Alejandro González Iñárritu avait en effet déjà reçu l’Oscar du meilleur réalisateur, l’an passé, pour « Birdman ». Avant lui, John Ford (en 1941 et 1942) et Joseph L. Mankiewicz (en 1950 et 1951) avaient déjà réussi cet exploit. « The Revenant » a également reçu l’Oscar de la meilleure photographie attribué à Emmanuel Lubezki qui le reçoit ainsi pour la troisième année consécutive (il l’avait eu l’an passé pour « Birdman » et il y a deux ans pour « Gravity »).
« The Revenant » n’a cependant finalement récolté que 3 des 12 Oscars pour lesquels il était nommé, certes non des moindres. Alejandro González Iñárritu a souvent eu les honneurs des palmarès : « Babel » avait ainsi reçu le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2006, « Biutiful » avait permis à Javier Bardem de recevoir le prix d’interprétation masculine à Cannes en 2010 et « Birdman » était le grand vainqueur de la cérémonie des Oscars 2015 : meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure photographie. Et si, justement, ce film n’était qu’affaire d’exploits ?
Les films d’Alejandro González Iñárritu sont toujours des expériences fascinantes dans lesquelles le montage prend une place centrale, souvent pour souligner la solitude, voire la déchéance, d’un personnage confronté à la violence (de la maladie, des éléments, de la société…) et ce sixième long-métrage ne déroge pas à la règle. Les solitudes et les douleurs se faisaient écho d’un pays à l’autre dans « Babel ». Cet écho résonne désormais entre les différents films du cinéaste. Là ne sont pas les seuls éléments distinctifs de ses films, je vais y revenir…
Le film est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain Michael Punke sur le trappeur Hugh Glass brutalement attaqué par un ours et laissé pour mort par les membres de sa propre équipe. Il nous plonge dans une Amérique profondément sauvage. Hugh Glass, le trappeur, est interprété par Leonardo DiCaprio et, comme dans le roman, est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné et laissé pour mort par ses équipiers, des soldats qu’il devait aider, accompagné de son fils (un « sang-mêlé ») à regagner leur camp, et en particulier par l’un d’eux, John Fitzgerald (dont la médiocrité s’avèrera aussi mythique que son nom) incarné par Tom Hardy, méconnaissable, qui l’enterre vivant. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, et par sa soif de vengeance, Glass entreprend un voyage de plus de 300 kms dans un environnement hostile qu’il devra affronter en plus des tribus et d’un hiver glacial, sur la piste de l’homme qui l’a trahi.
« Birdman » débutait par le plan d’un homme simplement -dé-vêtu, assis, comme suspendu dans les airs. De dos alors qu’il ne rêvait que d’être à nouveau sous les feux des projecteurs et au devant de la scène. Une voix off (sa voix intérieure, celle du personnage qu’il avait incarné) apparaissait parfois à ses côtés. Si le cadre et le lieu sont très différents, ce début n’est pas sans similitudes avec celui de « The Revenant ». C’est là aussi l’histoire d’un homme condamné à une certaine animalité, donc à nu, d’ailleurs filmé, dans l’un des premiers plans du film, là aussi de dos, face à la nature cette fois. Iñárritu n’économise pas non plus les métaphores, les plans pour nous faire comprendre que Glass est réduit à l’état animal : privé de paroles et réduit à ânonner des râles et des sons incompréhensibles, vêtu d’une peau qui se confond avec ses cheveux, rampant comme un animal avec cette peau sur le dos et se retrouvant soudainement face à une nature paisible et majestueuse dont l’homme a disparu. comme « Birdman » était « l’homme oiseau », « The Revenant » devient « l’homme ours ». Un homme qui va peu à peu renaître, en se débarrassant progressivement de sa façon de se mouvoir et de ses attributs d’animal pour (par le biais d’une scène choc dans laquelle il vide la carcasse d’un animal et s’y love en position fœtale) ne faire qu’un avec la nature puis renaitre, redevenir un homme qui marche sur ses deux jambes, se redresse, parle et peut (potentiellement) croire et admettre que « la vengeance appartient à Dieu. » La caméra le suit, le traque, l’emprisonne parfois face à cette nature aux étendues vertigineuses. Déjà dans « Biutiful », le personnage central était encerclé, enserré même par la caméra d’Iñárritu qui le suivait jusqu’à son dernier souffle. L’unité de temps, l’unité de lieu et d’action renforçaient l’impression de fatalité inéluctable.
« Babel » était pour moi un chef d’œuvre à la virtuosité scénaristique rarement égalée. Si « The Revenant » n’est pas avare de virtuosité, ce n’est certainement pas du côté du scénario qu’elle se trouve. J’évoquais plus haut ce qui caractérise et singularise les films d’ Iñárritu. Outre cette confrontation d’un personnage principal à lui-même et à la violence, ses films se distinguent par le montage (à l’exception de « Biutiful », le seul à proposer un montage linéaire), une utilisation judicieuse du son, une musique toujours prenante ( comme les cordes de cette guitare qui résonnent comme un cri de douleur et de solitude dans « Babel », le pendant du solo de batterie dans « Birdman »), des scènes oniriques (ainsi dans « Biutiful » des incursions oniriques ponctuaient un film par ailleurs extrêmement réaliste comme si le seul espoir possible était dans un ailleurs poétique mais irréel comme c’est d’ailleurs dans le cas dans « The Revenant ») et de forts contrastes, tout ce qui se retrouve dans « The Revenant ».
Ainsi, les dialectes et le ruissellement de l’eau ressemblent à une mélopée enchanteresse et une phrase qui revient à plusieurs reprises semble battre la mesure : « Tant que tu respires, tu te bats ». Des scènes oniriques ponctuent là aussi l’aventure de Glass, certaines un peu « plaquées » et d’autres magnifiques comme celles du rêve de Glass qui voit une Eglise délabrée et non moins belle surgir au milieu de nulle part et qui étreint son fils mort qui se transforme brutalement en arbre.
Le montage alterne entre les scènes du passé de Glass explicitant la mort de sa femme et celles de son épopée. Quant aux contrastes, ils sont toujours aussi saisissants. Contraste entre la lumière naturelle éblouissante et l’âpreté de ce à quoi est confronté Glass. Contraste entre la majesté de la nature et sa violence. Contraste entre la blancheur de la nature et la noirceur des desseins de ceux qui la traversent. Contraste entre la beauté étourdissante, royale même, de l’environnement et des animaux (cerfs traversant une rivière sous un soleil étincelant, aigle observant la nature majestueuse etc) et la brusquerie de l’homme.
Evidemment, DiCaprio, grand défenseur de la nature (comme il l’a une nouvelle fois prouvé dans son sublime discours lorsqu’il a reçu son Oscar) pouvait difficilement refuser ce film (il aurait refusé « Steve Jobs » pour celui-ci et de ce point de vue, il a eu raison) qui est un hymne vibrant à la nature. Evidemment aussi, certains plans sont d’une beauté inouïe et la prouesse technique est indéniable comme elle l’est dans chacun des films du cinéaste, a fortiori le dernier, « Birdman », tourné et monté de telle sorte que le spectateur avait l’impression qu’il ne s’agissait que d’un seul plan séquence (à une exception près, au dénouement). Evidemment encore, DiCaprio, est une fois de plus, une de fois encore, magistral, transfiguré, et dans son regard animé par une volonté farouche et vengeresse et la douleur indicible de la perte des siens, passent toutes ses émotions qu’il ne peut plus exprimer par une parole réduite à des borborygmes. La prouesse physique est aussi incontestable et d’après ses propres dires, ce tournage fut son plus difficile (des membres de l’équipe ont même abandonné en cours de route) et nous le croyons bien volontiers. Qu’il combatte à mains nues avec un ours (la scène est bluffante et nous fait retenir notre souffle et nous accrocher à notre siège) ou qu’il soit plongé dans une rivière glaciale, il contribue à ce que nous croyions à ce combat surhumain.
S’il mérite son Oscar, il y a eu aussi tant d’autres films pour lesquels il l’aurait mérité, peut-être davantage, par exemple « Shutter island » (le film ne fut pas nommé aux Oscars), dans lequel il est habité par son rôle et dans lequel, en un regard, il nous plonge dans un abîme où alternent et se mêlent même parfois angoisse, doutes, suspicion, folie, désarroi ou encore dans « Gatsby le magnifique » dans lequel il incarne un Gatsby bouleversant, énigmatique, mélancolique, fragile, charismatique, avec ce sourire triste, si caractéristique du personnage ou encore dans « J.Edgar » dans lequel le maquillage n’est pour rien dans l’étonnante nouvelle métamorphose qui le fait devenir Hoover, avec sa complexité, son autorité, son orgueil, ses doutes qui passent dans son regard l’espace d’un instant, lorsque ses mots trahissent subitement son trouble et le font alors redevenir l’enfant en quête de l’amour de sa mère qu’il n’a finalement jamais cessé d’être derrière ce masque d’intransigeance et d’orgueil. Et je pourrais continuer longtemps ainsi tant la liste est longue et impressionnante et tant l’éclectisme de ses judicieux choix révèlent son intelligence…. Mais revenons à « The Revenant ».
Malgré toutes les qualités du film énoncées ci-dessus : des plans majestueux, une interprétation irréprochable, une prouesse technique, une utilisation judicieuse du son et de la musique, des scènes spectaculaires, je n’ai pas été totalement emportée. La faute sans doute à un propos trop appuyé (trop d’excès, trop de redondances), à un rythme inégal, à un scénario et des personnages secondaires extrêmement manichéens (le personnage de Tom Hardy d’une médiocrité abyssale dont la haine des Indiens est certes expliquée par un scalp qu’ils lui avaient fait subir ou encore le personnage de Bridger interprété par Will Poulter dont le cas est vite expédié). Les plans du soleil qui perce à travers les arbres et de la caméra qui tournoie m’ont semblé tellement nombreux qu’ils en ont perdu de leur lyrisme (certain) et de leur force. Les personnages secondaires sont réduits à des stéréotypes et les scènes phares me semblent ne pas avoir suscité l’émotion et là encore, la force, qu’elles auraient dû contenir même si, pour me contredire, je suis bien consciente que le cinéaste ne cherchait pas à séduire ni à flatter (tout comme dans « Birdman »), bien au contraire, et c’est d’une certaine manière tout à son honneur. Dans un western (que ce film est aussi), avant la confrontation finale, le retour du héros est toujours LE moment crucial mais ici il m’a juste donné l’impression d’une fin qui s’essoufflait, d’un moment par lequel on devait passer parce qu’il faut en finir comme Glass veut lui aussi en finir avec son adversaire.
Tout comme dans « Birdman », au-delà de la prouesse technique, encore une fois admirable, grandiose, tout comme j’avais eu l’impression de voir un énième film dans et sur les coulisses du spectacle et la vie d’artiste (et tant de chefs d’œuvre l’avaient précédé : « Eve », «La comtesse aux pieds nus », « Le dernier métro », « Vous n’avez encore rien vu », « The Artist » et tant d’autres) sur le narcissisme, l’égocentrisme, la folie, l’excès ou le manque de confiance (l’un étant souvent le masque de l’autre) des acteurs, j’ai là aussi eu l’impression de voir un énième film sur la majesté de la nature, et quand tant d’autres l’ont précédé ( à commencer par Malick auquel Iñárritu emprunte tant, à commencer par son –très talentueux- directeur de la photographie).
« The Revenant » est une fable spectaculaire, fascinante, âpre, une ode à la nature aussi hostile soit-elle presque inoffensive face à la sauvagerie des hommes ( et qui, contrairement à eux, quand elle se rebelle le fait toujours pour se défendre ou survivre, la nature étant dépourvue de la médiocrité propre à l’homme) et une ode aux Indiens spoliés puisque nature et Indiens sont les décideurs finaux, les vrais Dieux que Glass avaient un temps supplantés, une fable portée par une réalisation époustouflante qui culmine dans ce plan final qui est d’une puissance redoutable et poignante et qui nous interpelle comme l’a fait DiCaprio lors de ces Oscars et dont je vous retranscris ici la fin du discours : « Faire The Revenant a aussi été une histoire de relation entre l'homme et la nature. Une année 2015 que nous avons collectivement menée à être la plus chaude de l'histoire enregistrée. La production a dû voyager jusqu'à l'extrême sud de la planète pour pouvoir trouver de la neige. Le réchauffement climatique est quelque chose de réel, qui arrive maintenant. C'est la plus grande menace à laquelle notre espèce doit faire face, et nous devons travailler ensemble et cesser de procrastiner. Nous devons apporter notre soutien aux leaders du monde entier qui ne parlent pas au nom des gros pollueurs, mais au nom de l'humanité toute entière, pour les peuples indigènes de ce monde, pour les millions et millions de populations déshéritées qui sont les plus affectées par tout cela. Pour les enfants de nos enfants, et pour les gens dont la voix a été noyée par des politiques avides. Merci à tous pour cette incroyable soirée de remise de prix. Ne considérons pas cette planète comme acquise, je ne considère pas cette récompense comme acquise. »
Iñárritu nous fait vivre une expérience, non dénuée de redondances, d’excès, de métaphores surlignées qui sont la marque de ce cinéaste qui, à chacun de ses films, toujours jalonnés de fulgurances, prouve néanmoins qu’il possède un univers singulier, une inventivité technique et une capacité à porter ses comédiens au sommet de leur art. « Tant que tu respires, tu te bats », « Le vent ne peut rien contre un arbre aux racines solides », telles sont les phrases qui symbolisent le parcours et la volonté incroyables de Glass et qui m’accompagnent bien après la projection, des phrases portées par la plus belle des mélodies, celle de la nature : le ruissellement de l’eau, la force du vent, le bruissement des feuilles. Une nature dont Iñárritu film et glorifie avec maestria l’effrayante et admirable majesté.
Ce soir, sur Canal +, à 21H, ne manquez pas « Birdman », dont vous pouvez retrouver ma critique en cliquant, ici.
Cliquez ici pour lire ma critique du chef d’œuvre « Babel ».