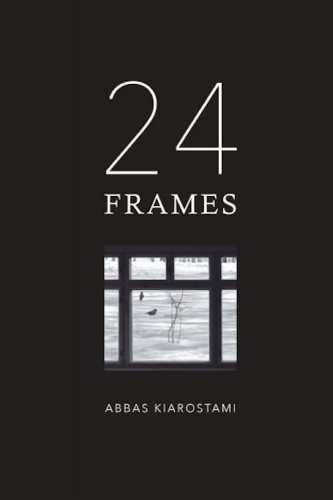Critique de HAPPY END de Michael Haneke

Cette critique est extraite de mon compte rendu du Festival de Cannes 2017 à retrouver ici.
« Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles. Instantané d’une famille bourgeoise européenne.» nous indiquait le synopsis du dernier film de Michael Haneke, ironiquement intitulé (connaissant la noirceur de son cinéma, nous pouvions en effet douter de la sincérité du titre) « Happy end ». Lauréat de la palme d’or en 2009 avec « Le ruban blanc » et avec « Amour » en 2012, deux chefs-d’œuvre, Michael Haneke m’a quelque peu décontenancée avec ce nouveau film. Déçue de prime abord… et pourtant il est de ceux dont les images me reviennent, dont je réalise la force avec le recul.
Le film commence par une scène vue à travers le téléphone portable de la fille de la famille, tout aussi ironiquement prénommée (Eve), qui filme avec celui-ci. La scène est la suivante : la mère de la jeune fille se prépare dans son rituel quotidien avant d’aller au lit. Chaque geste, du brossage des cheveux à l’extinction de la lumière, est commenté par sa fille. Des gestes mécaniques. Comme si la mère était un robot déshumanisé. La mère prend des calmants. La fille décide qu’il serait bien de s’en servir pour se débarrasser du hamster dont elle filme ainsi la mort. Prémisses de celle de la mère qui mourra dans des circonstances similaires auxquelles sa fille ne semble pas étrangère. Ces premiers plans, glaçants, quotidiens mais palpitants, nous rappellent ainsi ceux d’ « Amour » : la caméra d’Haneke y explorait les pièces d’un appartement pour arriver dans une chambre où une femme âgée gisait, paisible, morte. Ici aussi il s’agit de mort. Des sentiments. De l’humain. Là aussi la mort va peu à peu tisser sa toile.
Pendant ce temps, à Calais, sur un chantier, un mur s’effondre.
Deux mondes qui ne devraient pas se côtoyer.
Mais alors que sa mère est hospitalisée dans le coma, la jeune fille doit revenir vivre dans la famille de son père. Sa tante dirige l’entreprise de BTP. Il y a là aussi son grand-père qui n’aspire plus qu’à une chose : mourir.
Haneke est sans concessions avec la bourgeoisie de province aveuglée par ses drames individuels tandis que des drames collectifs se jouent à ses portes. L’histoire se déroule à Calais, là où les migrants venus du monde entier tentent de passer en Angleterre. La première fois où nous voyons les migrants, c’est en plan large alors que le patriarche leur adresse des propos inaudibles pour le spectateur, et dont on imagine qu’il leur demande de l’aide.
Chacun vit enfermé. Dans sa douleur. Dans son monde. Dans sa catégorie sociale. Dans son incapacité à communiquer. A livrer ses émotions autrement que par écrans interposés. Autrement qu’en criant sa douleur en tentant de mettre fin à ses jours (ce qui relie d’ailleurs le patriarche et la jeune fille). Les échanges amoureux ont lieu par messagerie internet (donnant lieu à de très longues scènes où les échanges défilent sur l’écran).
Jean-Louis Trintignant est une fois de plus remarquable, sorte de continuité du personnage d’ « Amour », misanthrope ayant perdu et aidé l’amour de sa vie à mettre fin à ses jours.
Le tout est filmé avec une froideur documentaire, une distance qui renforce la force du propos. Le dénouement, lorsque ces différents mondes et douleurs se confrontent, est férocement savoureux. Un mariage dans une salle baignée de clarté, avec la mer d'un bleu parfait en arrière-plan alors que tout n'est que fallacieuse sérénité et harmonie. Les dernières minutes sont cruelles, lucides, cyniques, magistrales.
Une comédie noire grinçante d’une d’une acuité ahurissante qui prouve une nouvelle fois l’étendue du talent d’Haneke, la puissance de son regard mais aussi la modernité de son cinéma. «Je ne me souviens plus du film, mais je me souviens des sentiments» dit Jean-Louis Trintignant en racontant une anecdote à son épouse dans « Amour ». C’est aussi ce qui reste de ce nouveau film d’Haneke. Le sentiment d’une incommunicabilité ravageuse et destructrice.
Avec une froideur et un ascétisme inflexibles, avec une précision quasi clinique, avec une cruauté tranchante et des dialogues cinglants, avec une maîtrise formelle fascinante, dans « Le ruban blanc » Haneke poursuivait son examen de la violence en décortiquant les racines du nazisme, par une démonstration cruelle et prodigieuse. C’est une autre démonstration d’une autre violence, l’indifférence sociale, qu’il réalise ici. Et la démonstration est une fois de plus implacable et saisissante.