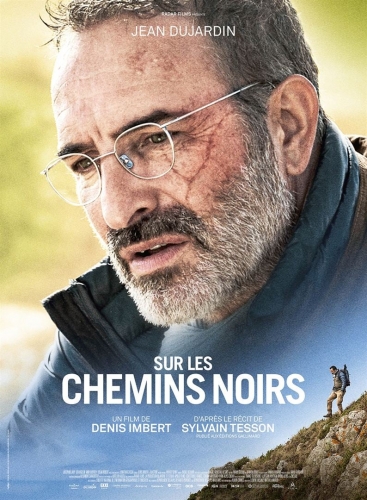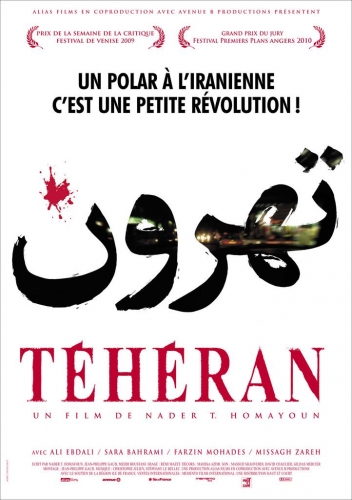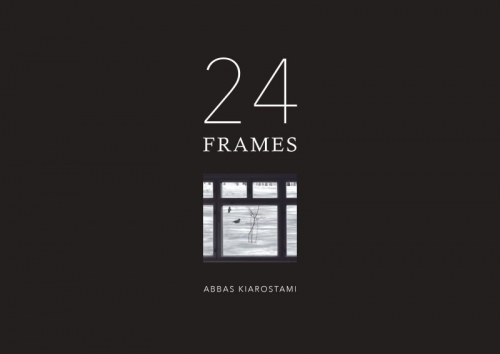Critique - LE PRIX DU PASSAGE de Thierry Binisti (au cinéma le 12 avril)

Je vous ai souvent parlé ici du travail de Thierry Binisti dont j’avais déjà tant aimé Une bouteille à la mer, un film que j’avais découvert au Festival International du Film de Saint-Jean-de-Luz dans le cadre duquel il fut primé du Prix du meilleur film en 2011. Ce film était une adaptation du roman de Valérie Zenatti Une bouteille à la mer de Gaza, l’histoire de Tal (Agathe Bonitzer), une jeune Française de 17 ans installée à Jérusalem avec sa famille, qui, après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, écrit une lettre à un Palestinien imaginaire dans laquelle elle exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine puisse régner entre les deux peuples. Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son service militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux « Gazaman » (Mahmoud Shalaby). Va alors débuter un échange épistolaire d’abord constitué de doutes, de reproches, d’incompréhension mais qui va finalement les mener sur le chemin d’une liberté et d’une réconciliation a priori impossibles.
Je vous avais aussi parlé du travail de Thierry Binisti à l’occasion de la diffusion du docu-fiction Louis XV, le soleil noir qu’il avait réalisé pour France 2 et par lequel j’avais été captivée : un divertissement pédagogique passionnant, de très grande qualité, aussi bien dans le fond que dans la forme, une immersion dans les allées tumultueuses de Versailles et dans les mystérieux murmures de l'Histoire, dans le bouillonnant siècle des Lumières et dans la personnalité tourmentée de Louis XV. Les similitudes entre ce téléfilm et Une bouteille à la mer étaient d’ailleurs assez nombreuses : Versailles, une prison (certes dorée) pour Louis XV comme pouvait l’être Gaza pour Naïm, un portrait nuancé de Louis XV comme l’étaient ceux de Naïm et Tal, une combinaison astucieuse entre fiction et documentaire.
Tout comme le docu-fiction évoqué ci-dessous, Une bouteille à la mer ne laissait pas place à l’approximation, avec un scénario particulièrement documenté. Ces deux voix qui se répondent, à la fois proches et parfois si lointaines, se font écho, s’entrechoquent, se confrontent et donnent un ton singulier au film, grâce à une écriture belle et précise, et sont ainsi le reflet de ces deux mondes si proches et si lointains qui se parlent, si rarement, sans s’entendre et se comprendre. Thierry Binisti ne tombe jamais dans l’angélisme ni la diabolisation de l’un ou l’autre côté du « mur ». Il montre au contraire Palestiniens et Israéliens, par les voix de Tal et Naïm, si différents mais si semblables dans leurs craintes et leurs aspirations, et dans l’absurdité de ce qu’ils vivent. Il nous fait tour à tour épouser le point de vue de l’un puis de l’autre, leurs révoltes, leurs peurs, leurs désirs finalement communs, au-delà de leurs différences, si bien que nous leur donnons tour à tour raison. Leurs conflits intérieurs mais aussi au sein de leurs propres familles sont alors la métaphore des conflits extérieurs qui, paradoxalement, les rapprochent.
Si j’ai établi ce long préambule avec ces digressions, c’est parce que l’on retrouve ces qualités dans Le Prix du passage, le troisième long-métrage de Thierry Binisti (qui a aussi réalisé de très nombreux téléfilms, souvent remarquables), là aussi très documenté, notamment grâce à l’expérience de la scénariste Sophie Gueydon qui a travaillé avec des associations à Paris puis à Calais, et noué des liens avec les migrants rencontrés alors. Avec Pierre Chosson, elle a écrit un scénario puissant dénué de manichéisme.
Là aussi, il s’agit de la rencontre entre deux mondes qui n’auraient jamais dû se rencontrer, qui vont s’enrichir l’un l’autre. Là aussi il s’agit de partir de l’intime pour parler du politique. Là aussi, il s’agit de deux personnages forts. Là aussi il s’agit de désirs (d’ailleurs) qui vont éclore.
Sur ce sujet de la situation des migrants, il y eut notamment Welcome de Philippe Lioret dans lequel, pour impressionner et reconquérir sa femme Marion (Audrey Dana), Simon (Vincent Lindon), maître-nageur à la piscine de Calais, (là où des centaines d’immigrés clandestins tentent de traverser pour rejoindre l’Angleterre, au péril de leur vie) prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde, Bilal (Firat Ayverdi) qui tente lui-même de traverser la Manche pour rejoindre la jeune fille dont il est amoureux, Mina (Dira Ayverdi).
L’an passé, l’excellente comédie sociale bienveillante de Louis-Julien Petit, La Brigade, braquait ses projecteurs sur la situation des migrants en foyers pour mineurs dans les Hauts-de-France. Le film de Thierry Binisti nous emmène aussi dans les Hauts-de-France, où vit Natacha (Alice Isaaz), 25 ans, jeune mère célibataire qui galère pour élever son fils Enzo (Ilan Debrabant), 8 ans. Walid (Adam Bessa), quant à lui, migrant d’origine Irakienne, attend de réunir assez d’argent pour payer son passage vers l’Angleterre. Aux abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de passages clandestins. Ne parvenant plus à payer ses factures, sa chaudière tombant en panne, renvoyée du bar où elle travaillait pour avoir pris de l’argent dans la caisse, Natacha est dans une impasse et ne trouve que cette solution pour s’en sortir et pour offrir une vie un peu plus confortable à son fils avec lequel elle partage un logement spartiate à Boulogne-sur-mer.
Ce film, comme ses acteurs principaux, dégage un charme qui vous saisit dès les premières minutes, dès cette chanson en Italien qu’entonnent Natacha et son fils. Comme dans Une bouteille à la mer, Le Prix du passage réunit deux êtres que tout oppose a priori et la richesse du film réside avant tout dans la profondeur de ces deux personnages qui aspirent tous deux à prendre un nouveau départ, à un ailleurs, à un nouvel horizon. S’ils viennent de deux mondes en apparence opposés (Natacha est au départ particulièrement hostile aux migrants), leurs situations finalement pas si différentes, la dureté du monde à laquelle ils se confrontent et l’âpreté de leurs existences vont les rapprocher, la précarité dans laquelle la jeune femme vit la conduisant aussi à être sans cesse aux abois et dans l’instabilité, tout comme Walid.
Leur rencontre nait d’un choc contre le capot de la voiture de Natacha. Le choc d’une rencontre qui va la bousculer, la conduire à commettre des folies, à se saisir de sa liberté…
Walid était étudiant en Irak. Il parle parfaitement le français, connaît et aime la littérature française, Voltaire et Rousseau, philosophes des Lumières et de la liberté. On ne saura jamais ce qu’il a vécu en Irak, un plan furtif sur ses cicatrices dans le dos entrevues par Natacha laisse deviner un douloureux passé inscrit dans sa chair. Adam Bessa a reçu le Prix d’Interprétation de Un Certain Regard, au dernier Festival de Cannes, pour son rôle dans Harka. Il mériterait aussi d’être récompensé pour ce rôle tant il apporte d’intensité, de détermination et de douceur à son personnage.
Alice Isaaz, quant à elle, apporte toute sa fougue à son personnage en colère et impulsif, qui peu à peu va prendre le chemin de la lumière, de la liberté, et empoigner son destin de mère. Elle qui n’a jamais quitté sa région va franchir les frontières, de la morale et de ses Hauts-de-France. Le passage du titre, c’est bien sûr celui qui mène vers l’Angleterre mais aussi celui-là, le passage vers la liberté, de partir et d’être soi. De Mademoiselle de Joncquières de Emmanuel Mouret, du Mystère Henri Pick de Rémi Bezançon à Une belle course de Christian Carion, Alice Isaaz impose sa lumineuse présence, et accède ici enfin au premier rôle qu'elle mérite.
Toute la beauté de la relation entre Natacha et Walid, orageuse puis complice, se situe dans l’indicible, dans cet avenir sur lequel ouvre le film qu’il nous appartient d’esquisser, dans cette phrase que Walid dit à Natacha qui n’est pas traduite qu’il nous appartient de deviner (comme dans Lost in translation).
Le film lorgne aussi du côté du thriller, avec des séquences trépidantes particulièrement réussies lors des franchissements des contrôles de police, grâce à la réalisation inspirée et efficace de Thierry Binisti et grâce à l’interprétation d’Alice Isaaz dont le spectateur partage alors l’angoisse. Et quand le coffre s'ouvre sur un horizon irradié de lumière, nous partageons avec elle ce sentiment de soulagement.
Cette histoire singulière dont le rythme ne faiblit jamais, le montage mettant ainsi en exergue le sentiment d'urgence et de risque constants qui étreint les deux protagonistes, donne une incarnation à une situation plus universelle, celle des migrants qui, au péril de leur vie, fuient et bravent tous les dangers pour se donner une chance d'un avenir meilleur. Ce film riche de ses nuances nous donne aussi envie, comme Natacha, de prendre conscience de la préciosité de notre liberté, et d’en saisir chaque parcelle de seconde… Vous l’aurez compris : je vous recommande vivement et sans réserves ce film nuancé et palpitant, au cinéma ce 12 avril, dont vous ressortirez le cœur empli du souvenir revigorant et rassérénant de ce plan d'un horizon ensoleillé mais aussi du souvenir de ces deux magnifiques personnages, deux combattants de la vie qui s'enrichissent de la confrontation de leurs différences.