Premier bilan de la compétition officielle du 36ème Festival du Cinéma Américain de Deauville (07/09/2010)
La section la plus intéressante de ce Festival de Deauville est décidément celle de la compétition des films indépendants, initiée en 1995, même si les avant-premières et les hommages ont longtemps eu le devant de l’affiche. Si cette année, le tapis rouge deauvillais est déserté par les stars du cinéma américain alors que tant l’ont pourtant foulé et les hôtels par les festivaliers (il suffit pour s’en apercevoir de se rendre dans les salons des deux plus grands hôtels deauvillais inhabituellement désertés a fortiori depuis aujourd’hui,) Deauville reste un vrai plaisir pour les cinéphiles avides de découvertes de curiosités et/ou pépites cinématographiques et le charme de Deauville (même sans Trintignant, n’en déplaise à Vincent Delerm) reste intact et pour moi toujours aussi prégnant. Si je ne peux m’empêcher d’avoir un pincement au cœur en pensant à ce que ce fut ce festival, je n’en reste pas moins enthousiaste notamment grâce à la compétition qui, comme chaque année, et en quatre films sur les douze que compte cette compétition 2010 a encore réussi à me surprendre.
Il est ainsi toujours frappant de constater les points communs entre les films sélectionnés (eux-mêmes probablement le reflet de ceux reçus par les sélectionneurs), souvent l’adolescence. A cela rien d’étonnant puisque les cinéastes en compétition sont souvent très jeunes, mettant ainsi en scène de jeunes héros (d’ailleurs plus souvent antihéros) à fleur de peau. En quatre films se dégage ainsi une tendance puisque les quatre films de cette compétition déjà projetés nous parlent d’orphelins, dans un sens plus ou moins large, et d’enfants ou d’adolescents en quête de repères, égarés, traumatisés par une absence, liés à un parent (ou plusieurs) par un amour aussi inconditionnel que maladroit. Sont-ce encore là les stigmates de l’Amérique de l’ère Bush, en quête d’une autre « paternité »? Sans doute est-ce extrapoler (d’autant qu’un des films se déroule au Mexique, néanmoins produit par Malkovich , sa production américaine expliquant sa sélection à Deauville) mais toujours est-il que les Etats-Unis qui nous sont ici montrés y apparaissent comme une terre hostile, incapable de protéger ses enfants, si éloignée de l’American dream. Effet de la crise aussi sans doute où les enfants sont confrontés aux problèmes des adultes et obligés d’apprendre très tôt un rôle qui n’est normalement pas le leur.
Je vais commencer par le dernier projeté, « Abel », le premier film en tant que réalisateur de l’acteur Diego Luna. Abel est ainsi un enfant de 9 ans qui ne parle plus depuis que son père a quitté la maison. Un jour il retrouve la parole et se prend pour son père. Tout le monde se plie à ses volontés et joue le jeu jusqu’au jour où le père d’Abel réapparait. (Vous trouverez ci-dessous une vidéo de la conférence de presse dans laquelle Diego Luna explique la genèse du film). « Abel » a été présenté hors compétition dans le cadre du dernier Festival de Cannes. Filmé la plupart du temps à hauteur d’Abel, le regard, frondeur, déterminé, si touchant du petit garçon, nous saisit dès le début pour ne plus nous quitter et pour, finalement, arracher au nôtre quelques larmes. Avec beaucoup de pudeur et de drôlerie, parfois pour désamorcer des scènes qui auraient pu se révéler glauques, Diego Luna nous embarque dans son histoire qu’il filme et conte avec beaucoup de tendresse, nous surprend avec ce qu’on attend. Tendresse pour ce petit garçon, un peu celui qu’il a été comme il l’a expliqué en conférence de presse, mais aussi d’une certaine manière pour cette mère, aimante et courageuse, à laquelle son film rend hommage (Diego Luna a perdu sa mère dans sa petite enfance) à travers le personnage de la mère d’Abel. Pour son premier film, Diego Luna a réussi sans doute ce qu’il y a de plus compliqué : donner l’apparence de la simplicité à une histoire qui est loin de l’être et susciter l’émotion, sans jamais la forcer, par le ton du film, burlesque et poignant, par la puissance du sujet et de son (réellement extraordinaire) jeune acteur principal dont, en conférence de presse, Diego Luna a ainsi souligné à quel point (presque effrayant) il avait un comportement adulte, voire paternaliste, à l’image du personnage qu’il a incarné.
Dans « Two gates of sleep » d’Alistair Banks Griffin (sosie officieux de Johnny Depp), la figure absente n’est plus celle du père mais de la mère, la mère de deux frères, qui, suite à sa mort imminente à laquelle ils s’étaient préparés vont entreprendre un voyage difficile avec son cercueil, pour l’enterrer et ainsi honorer sa dernière volonté. Déjà sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs, « Two gates of sleep » a décontenancé plus d’un festivalier. Plus d’un a ainsi quitté la salle au bout de quelques minutes de projection. C’est d’ailleurs dommage de ne pas accepter de se laisser surprendre, de ne pas tenter de voir où va nous conduire un univers qui a le mérite au moins d’être intrigant. Contemplatif, épuré, abrupte, le film d’Alistair Banks Griffin ne répond certes pas à un schéma narratif classique et nous emmène hors des sentiers battus au propre comme au figuré, même si les influences (revendiquées) foisonnent, de Gus Van Sant à Bresson en passant par Tarkovsky ou Ozu. Sa caméra caresse la nature à la fois rugueuse et consolatrice, silencieuse et vibrante (à noter : une judicieuse utilisation de la bande son dans ce film presque muet). Variation et méditation sur la mort, « Two gates of sleep » nous met face à nos propres questionnements sans apporter réellement de réponses. Une expérience déroutante, mystique, intrigante, singulière et universelle qui nous fait suivre, malgré son étrangeté rêche, le voyage de ces deux frères qui n’obéissent qu’à une loi : celle de la nature. Un discours simpliste mais aussi un voyage à la fois beau et éprouvant qui pourra ennuyer ou fasciner mais qui a peu de chances de vous laisser indifférents.
Dans « Winter’s bone » de Debra Granik (dont c’est le deuxième film après « Down to the bone »), c’est à nouveau la figure paternelle qui est absente. Ainsi, Ree Dolly, 17 ans, vit seule dans la forêt des plateaux de l’Orzak avec son frère et sa sœur. Lorsque son père sort de prison et disparait sans laisser de traces, elle n’a d’autre choix que de se lancer à sa recherche sous peine de perdre la maison familiale qu’il a utilisée comme caution. Ree va se heurter au silence des populations du Missouri. Là encore, c’est une absence et une région hostile qui nous sont décrites…quoique hostile soit un euphémisme étant donné le caractère totalement irrécupérable de la famille en question dans laquelle la haine domine et dans laquelle la violence semble être le seul moyen d’expression, et de pallier au manque de communication des populations revêches de cette région. La jeune actrice Jennifer Lawrence , par sa présence à l’écran (un peu trop téméraire pour que ce soit crédible d’ailleurs, même si l’environnement dans lequel elle a baigné dans son enfance peut expliquer sa maturité ), sauve ce film qui n’échappe pas aux clichés et à ses personnages sommairement caractérisés… Il est aussi frappant de constater que là aussi c’est une enfant qui endosse un rôle d’adulte. Sans doute le jury de Sundance (qui lui a attribué le grand prix) a-t-il été séduit par ce qui relève presque de l’étude sociologique et par la jeune actrice.
Enfin dans le dernier des quatre films en compétition déjà projetés, « Welcome to the Riley’s », deuxième film de Jake Scott (fils de Ridley), ce dernier nous parle d’une orpheline, Mallory, stripteaseuse dans un club de la Nouvelle-Orléans, où Doug Riley est en déplacement professionnel. Doug a perdu sa fille unique huit ans auparavant et il va se prendre d’affection pour cette adolescente qui pourrait être sa fille… Première surprise : Kristen Stewart qui incarne la stripteaseuse est étonnamment crédible, en jeune fille insolente (très relativement certes) et fragile. Là encore rien de révolutionnaire mais la transgression provient peut-être finalement de la bonté, rare, du personnage principal (formidable James Gandolfini dans le rôle de Doug), de son empathie, sa sincérité, ses failles. De ce film, de cette histoire de retour à la vie et à l'espoir, qui n’a donc certainement pas la prétention de révolutionner le cinéma se dégage une grâce, un charme, une émotion (là aussi) tout en finesse grâce à des personnages attachants, une réalisation intelligemment sobre.
Je vous ferai un nouveau « bilan » de la compétition dans deux jours et nous verrons si les points communs demeurent les mêmes. En tout cas, si les sujets sont étonnamment proches, les styles des cinéastes sélectionnés sont en revanche très différents et témoignent déjà une nouvelle fois de la diversité, l’inventivité et la richesse du cinéma indépendant américain.
01:00 Écrit par Sandra Mézière | Lien permanent | Commentaires (4) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer |
Imprimer |  | |
| |






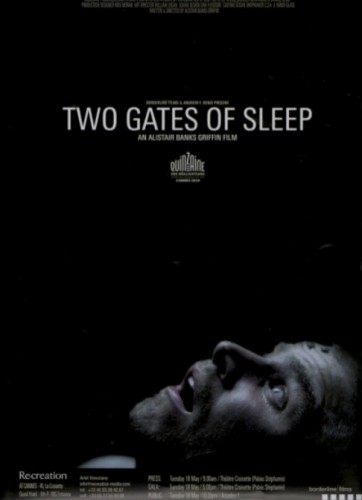
Commentaires
Merci pour ce premier bilan passionnant, l'occasion de saliver à l'idée de découvrir prochainement de petits bijoux du cinéma indépendant!
J'ai déjà noté "Abel" dans mes tablettes, qui m'a l'air puissant! Et "Welcome to the Rileys" pourrait bien aussi avoir mes faveurs!
Votre critique de "La dette" m'a également beaucoup plu. En revanche, je n'ai que survolé celle de "Buried" afin d'en préserver le mystère (ce film m'intrigue depuis des mois!).
Vivement la suite! La liste est longue des films que je vous envie de pouvoir découvrir: "Kaboom", "The runaways", "The kids are all right", "Cyrus", "Morning", "Mother and child", "Exit through the gift shop", "3 backyards", "Love and other impossible pursuits"... et j'en passe!
Bonne continuation Sandra!
Écrit par : Mister Loup | 08/09/2010
@Mister Loup: A vrai dire, j'ai très peu publié pendant ce festival, faute de coups de coeur pour la sélection de qualité très médiocre cette année. "Abel" et "Welcome to the Rileys" sont en effet de très bons films et surtout le premier, je ne comprends toujours pas pourquoi il ne figurait pas au palmarès... Le concept de "Buried" est d'une indéniable originalité même si je trouve que le film n'est pas totalement abouti.
Écrit par : Sandra.M | 15/09/2010
C'est vrai que vous n'avez pas eu l'air extrêmement emballée et c'est dommage de voir que la sélection n'était pas vraiment à la hauteur de l'excellente réputation du festival!... They'll do better next year! ;)
Allez, il y a eu le coup de coeur pour "Abel", c'est déjà ça!
J'ai d'ailleurs vu Diego Luna hier dans un joli film mexicain hélas peu médiatisé, la comédie sociale "Rudo et Cursi" avec également Gael Garcia Bernal (toujours parfait), "fresh", touchant et bien rythmé!
Écrit par : Mister Loup | 15/09/2010
@Mister Loup: Oui, cela ne pourra qu'être mieux l'année prochaine mais je pense que le Festival aura perdu beaucoup d'habitués en cours de route. Je n'ai pas vu "Rudo et Cursi", mais avec un casting pareil, c'est déjà très prometteur. En tout cas "Abel" reste mon chouchou de ce festival 2010 avec, dans un autre genre et malgré quelques défauts, "La Dette".
Écrit par : Sandra.M | 21/09/2010