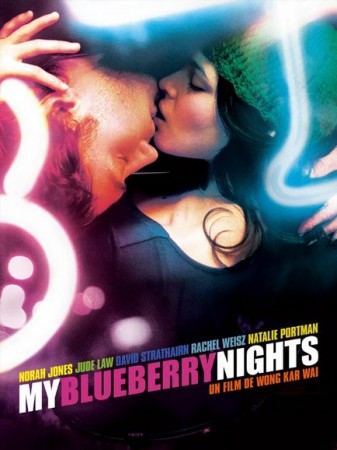Pour certains, ce week end fut synonyme de frénésie d’achats, pour moi il fut synonyme de frénésie cinématographique. Loin des bousculades, des empoignades, des regards et des pas harassés. On ne va pas impunément dans certains cinémas. Certains sont des lieux de bien être, de recueillement presque. Si le Dieu cinéma existait son lieu de culte s’appellerait Arlequin ou Saint-Germain des Prés, là où les spectateurs ont les yeux qui brillent avant même que la séance ne commence, là on ne monte pas mais où on descend dans la salle , lieux mystérieux, salles obscures qui nous éclairent sur le monde vers lesquelles on se fraie lentement un chemin en chuchotant respectueusement. C’est donc à l’Arlequin que j’ai vu « Un baiser s’il vous plait » et au Saint-Germain des Prés que j’ai vu « La graine et le mulet » (ils sont toujours à l’affiche dans ces deux salles.) Premier point commun : l’un et l’autre sont projetés dans des salles art et essai. Pas le seul d’ailleurs même si au premier abord il semblerait s’agir de films aussi différents que possibles.
L’un, d’Emmanuel Mouret, « Un baiser s’il vous plait », commence par la rencontre fortuite de Gabriel (Michael Cohen) et Emilie (Julie Gayet). Emilie est parisienne en déplacement à Nantes, ils ne se reverront probablement jamais, tous deux ont des compagnons. Gabriel veut embrasser Emilie. Emilie hésite et pour qu’il comprenne son hésitation, elle lui en raconte la raison, l’histoire d’une femme mariée (Virginie Ledoyen) et du meilleur ami de celle-ci (Emmanuel Mouret) et les conséquences d’un baiser…
L’autre, d’Abdellatif Kechiche, "La graine et le mulet" qui se déroule sur le port de Sète, nous conte l’histoire de Beiji, soixante et un an, père de cinq enfants, divorcé, licencié d’un chantier naval, qui, avec l’aide de sa belle-fille, Rym, une adolescente, décide de créer sa propre affaire : un restaurant sur un vieux bateau délabré. Le rêve qui va souder une famille. Le rêve d’une vie meilleure. Le rêve qu’il veut laisser à ses enfants.
Bien sûr ces deux films ont aussi en commun la singularité de leurs titres, dans les deux cas ce autour de quoi tourne tout le film : le baiser d’un côté, la graine et le mulet, de l’autre. Mais pas seulement. Ce titre et ce qu’il désigne sont alors l’objet d’un suspense inattendu et incongru dans les deux cas. Ces deux films ont encore en commun d’avoir été présentés en compétition officielle du dernier Festival de Venise. Celui d’Abdellatif Kechiche est reparti avec trois récompenses : le prix de la critique internationale, le prix Marcello Mastroianni pour Hafsia Herzi (ô combien mérité), prix qui récompense un jeune talent, et le prix spécial du jury ex-aequo avec « I’m not there » de Tod Haynes. « La faute à Voltaire » d’Abdellatif Kechiche avait d’ailleurs déjà obtenu le lion d’or de la meilleure première œuvre au Festival de Venise 2000.
« Un baiser s’il vous plaît » et « La graine et le mulet » ou plutôt Abdellatif Kechiche et Emmanuel Mouret ont également Marivaux en commun : l’un, l’a brillamment utilisé et remis en scène, dans « l’Esquive », l’autre nous parle de marivaudages, des jeux de l’amour et du hasard, de petits jeux a priori sans conséquences dans « Un baiser s’il vous plaît ». Mais leur principal point commun c’est la façon dont ils nous convainquent, nous envoûtent même, progressivement, (ce ne sont pas des univers dans lesquels on rentre immédiatement mais qui captivent peu à peu et subrepticement notre attention, sans recourir à des méthodes, non, mais avec un univers qui leur est propre) irréversiblement, pour aboutir l’un et l’autre à une fin mémorable. C’est tellement important le dénouement, la dernière note, le goût qui restera sur nos lèvres et dans nos yeux avides de spectateurs parfois exigeants… Que serait « Lost in translation » sans sa fin énigmatique ? Je repense aussi à un téléfilm récent, l’adaptation de « Guerre et paix » de Tolstoï, plutôt réussie d’ailleurs, mais dont les deux dernières minutes gâchaient les heures qui avaient précédées, plutôt réjouissantes, un insert qui indiquait de manière pour le moins déplacée « tout est bien qui finit bien ». Comme si le spectateur n’était pas capable de supporter une fin en demi-teinte, comme si le spectateur ne pouvait survivre sans happy end, comme si les spectateurs étaient des enfants qu’il fallait bercer d’illusions. J’ai rarement vu idée aussi ridicule et surtout aussi insultante pour le spectateur.
Deux fins mémorables donc, deux fins que je ne vous raconterai donc pas mais qui justifient évidemment à elles seules d’aller voir ces deux films. Deux films à contre-courant du cynisme ambiant, du formatage ambiant, deux films qui donnent le temps au temps, le temps de dire (même très vite, même de manière très différente, très écrite pour l’un, très parlée pour l’autre, mais non moins travaillée et efficace), le temps de les écouter, le temps de laisser l’émotion s’installer, et non de la proclamer, l’ordonner. La semaine dernière, lors d’un séminaire sur le scénario, Olivier Lorelle (scénariste césarisé d’Indigènes) disait « il y a d’un côté les salles vides de sens et de l’autre les salles vides de spectateurs ». Eh bien non, la salle du Saint-Germain était pleine et la séance d’après aussi. Le public a besoin de sens, le public n’a pas toujours envie qu’on lui dicte ses émotions. Et le bouche à oreille ne s’y trompe pas.
Ces deux films ont aussi en commun une direction d’acteurs remarquable. Et évidemment surtout celle d’Abdellatif Kechiche. Un modèle du genre. Epoustouflant. A tel point qu’on se sent presque gênés, voyeurs, oubliant qu’il ne s’agit pas d’un documentaire mais d’une fiction tant la vérité semble jaillir de chaque scène, de chaque parole, de chaque regard que la caméra semble surprendre et non précéder. Les scènes de repas sont saisissantes, la caméra guette le moindre signe de faiblesse, de doute, de tristesse qui passent, presque invisibles, dans la cohue et dans les mouvements frénétiques, et non moins judicieux, de la caméra qui scrute et sculpte chaque visage. Tout le talent est dans le presque, dans la nuance, dans le non-dit, dans ce qui est suggéré. Ce brouhaha contraste avec les silences du personnage de Slimane dont le visage buriné, triste et noble trimballe avec lui une vie d’émotions et suscite la nôtre. Ami et collègue de chantier du père du cinéaste, Slimane (Habib Boufares) comme souvent chez Abdellatif Kechiche, n’est pas un comédien professionnel mais non moins exceptionnel et bouleversant. A l’inverse Emmanuel Mouret a choisi uniquement des comédiens professionnels.
Tous deux ont cependant encore cela en commun : leur style imprègne le fond et la forme, très rohmerien ou même truffaldien pour Emmanuel Mouret (dont le personnage maladroit est une sorte de mélange d’Antoine Doinel et Pierre Richard), Abdellatif Kechiche,lui, même si son cinéma ne ressemble à aucun autre, lorgne plutôt du côté de Pialat. Forme vivante et frénétique chez Abdellatif Kechiche. Théâtralisée, ludique et burlesque, chez Emmanuel Mouret. Mais au fond, chez l’un comme chez l’autre la preuve d’une grande liberté. La mise en abyme structurée, les décors aseptisés sur lesquels plane l’ombre de Schubert (je ne résiste jamais à Schubert…) sont aussi éloignés que possible de ceux du film d’Abdellatif Kechiche imprégné de documentaire dans le fond comme dans la forme. Et pourtant dans les deux cas on se laisse embarquer. L’un et l’autre nous parlent du destin. D’actes a priori insignifiants et anodins qui peuvent devenir cruciaux. L’un et l’autre nous donnent envie de saisir chaque seconde, d’embrasser, de désirer même la vie : un désir de vie dont les deux fins sont emblématiques.
Abdellatif Kechiche signe un hymne à la solidarité, nous parle du droit à la différence, sans revendiquer (on aurait pu craindre, au regard des premières minutes, d’ailleurs très réussies, un discours militant sur la précarité de l’emploi mais non Abdellatif Kechiche est trop intelligent et doué pour tomber dans la revendication ostentatoire), non, mais comme on nous conterait une comptine sauf que celle-là ne nous endort pas mais nous maintient éveillés, nous réveille aussi, si bien que les 2H30 dont on pense au début qu’elles seront interminables paraissent trop courtes tant nous aurions aimé rester avec ces personnages attachants, palpitants de vie.
« La graine et le mulet » est un film énergique et fiévreux, solaire et sombre, étourdissant de vie à l’image de sa jeune interprète principale qui, notamment dans un plan séquence où elle tente de convaincre sa mère ( de quoi, je vous laisse découvrir) fait passer une multitude d’émotions avec un brio déconcertant et rarement vu au cinéma. De même que le duo singulier qu’elle forme avec Slimane donne lieu à des scènes toujours bouleversantes, Slimane, tellement touchant, qui se raccroche à son regard notamment lors de leurs démarches administratives face à des banquiers, fonctionnaires…, plus vrais que nature. Il faudrait parler de tant d’autres scènes encore où le rire et les larmes, la lâcheté et le courage se confondent, où la tristesse et la drôlerie affleurent.
Aucun personnage n’est négligé mais existe. Abdellatif Kechiche n’a pas son pareil pour, dans un geste esquissé, traduire la vanité ou l’humanité, le ridicule ou le sublime : la comédie humaine.
Ce n’est pas un film militant mais un film vivant. C’est juste et tellement la vie. Un tourbillon de vie qui m’a bouleversée, qui ne vous laissera pas indemne, qui ne peut vous laisser indemne, qui vous bouscule et vous emmène dans sa danse échevelée. Et puis cette fin, cette fin, danse de mort et danse de vie qui s’enlacent et se répondent magnifiquement et tragiquement, fin sensuelle et terrible, belle et douloureuse, troublante et poignante, inoubliable : SUBLIME. Le grand film d’un très grand directeur d’acteurs. A ne manquer sous aucun prétexte !
Et si vous aussi avez envie d’une frénésie de cinéma, plutôt que d’achats, allez voir ensuite « Un baiser s’il vous plait » dont l’exquise fin vous laissera un goût délicieux et vous fera quitter la salle un peu « lost in translation » tant Emmanuel Mouret parle une langue bien à lui, presque étrangère, en tout cas singulière… Cette semaine vous n’aurez donc aucune excuse pour ne pas plonger « in the mood for cinema » !
Sandra.M


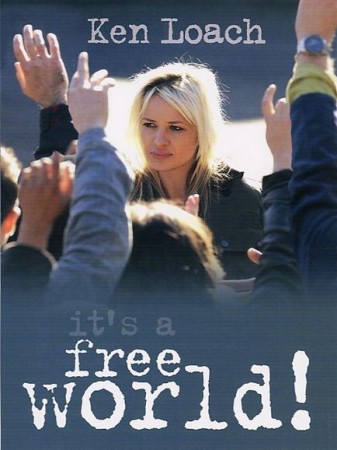




 la vie qui joue aux montagnes russes, de cette fureur de vivre, de l’étincelante et insondable mélancolie. Je pourrais te parler, cher lecteur, de musiques de 2007, de mon 2007,
la vie qui joue aux montagnes russes, de cette fureur de vivre, de l’étincelante et insondable mélancolie. Je pourrais te parler, cher lecteur, de musiques de 2007, de mon 2007, 













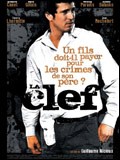




 Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du
Cette semaine sortent deux films qui figuraient parmi mes favoris du