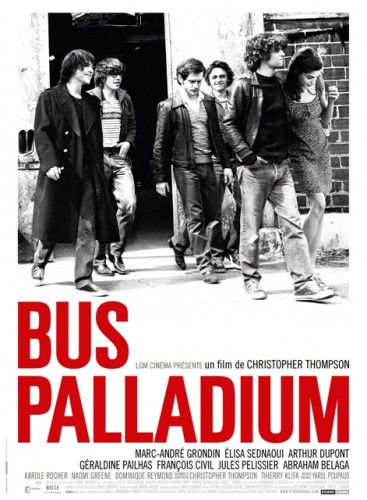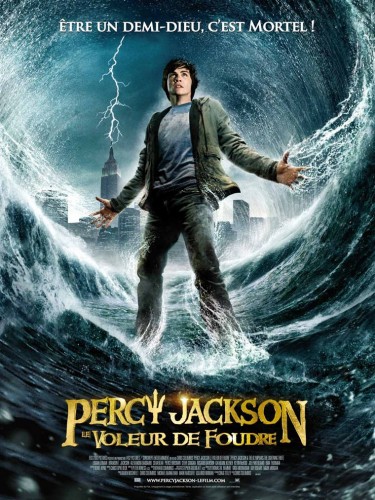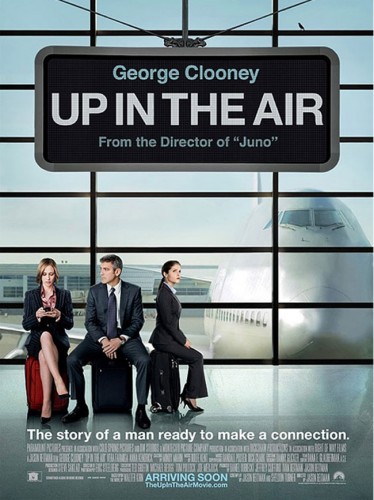Avant-première- Critique de « Bus Palladium » de Christopher Thompson
Alors qu'il a toujours baigné dans l'univers cinématographique, entre son grand-père Gérard Oury et sa mère Danièle Thompson (avec laquelle il a coécrit plusieurs scénarii), Christopher Thompson a attendu d'avoir presque quarante ans pour passer derrière la caméra. Un premier film est souvent le plus personnel, celui qui porte le plus l'empreinte de son réalisateur. Christopher Thompson, lui, a choisi de nous parler de musique et d'amitié à travers une bande de jeunes musiciens...
Lucas, (Marc-André Grondin), Manu (Arthur Dupont), Philippe (Abraham Belaga), Jacob (Jules Pelissier) et Mario (François Civil) s'aiment depuis l'enfance. Ils ont du talent et de l'espoir. Ils rêvent de musique et de gloire. Leur groupe de rock, LUST, connaît un succès grandissant, mais les aspirations de chacun rendent incertain leur avenir commun. L'arrivée de Laura (Elisa Sednaoui) dans leur vie va bousculer un peu plus ce fragile équilibre.
Cela débute sur le sublime air de « Let it loose » des Stones et pour moi c'était déjà une bonne raison d'aimer ce film ( vous saurez désormais comment me corrompre... : -)). Et ensuite ? Ensuite, « Bus Palladium » pâtit un peu de cette brillante référence avant de nous embarquer dans sa propre musique. Plus lisse, plus douce mais non dénuée de rugosité et d'amertume. Christopher Thompson fait commencer son film dans un joyeux désordre imprégné de l'enthousiasme de ce groupe qui débute. Puis, des personnages se distinguent : Lucas et Manu surtout, définis autant par l'amitié qui les lie que par leur rapport à leurs mères. La mère de Lucas est psy, réfléchie et compréhensive. Celle de Manu est très jeune, hôtesse de l'air, elle est indépendante, libre, et vit avec son fils comme avec un colocataire, dans un incessant tourbillon. Le premier est aussi équilibré que le second vit sur le fil et en déséquilibre. Et c'est là la grande force de ce premier film qui nous en fait dépasser les faiblesses : le caractère attachant de ses personnages dont Christopher Thompson (et Thierry Klifa, son coscénariste) brosse subtilement les portraits, à travers leurs relations avec leurs parents (mère dans le cas des deux précités ou grand-mère dans le cas de Babcia la grand-mère de Jacob qui ne parle que Yiddish.) Il sait singulariser ses personnages, les distinguer, nous les rendre familiers, particulièrement aidé en cela par trois acteurs exceptionnels. D'abord, la découverte Arthur Dupont qui interprète l'écorché vif Manu qui joue la comédie avec un air de Romain Duris et chante avec la voix de De Palmas. Ensuite Marc-André Grondin qui de nouveau en est au « premier jour du reste de sa vie ». et Elisa Sednaoui, séductrice et forte avec juste ce qu'il faut de fragilité qui affleure.
Ces trois-là nous valent de suivre le film avec intérêt, leurs relations parfois troubles, surtout fortes, leur douloureux et définitif adieu à l'adolescence et le cruel renoncement à leurs rêves. Dommage alors que le reste soit si peu « rock », si peu à l'image du nom du groupe « Lust » (qui signifie luxure), que tout semble tellement lisse, que le Bus Palladium et certains personnages (au contraire de ces trois-là qui en ont tant) manquent de caractère, que le film ait refusé de se situer vraiment dans une époque pour malheureusement ne pas parvenir non plus à être intemporel ( l'intrigue se déroule dans les années 80 avec des références vestimentaires des années 1970 et un vocabulaire des années 2000 « taf », « buzz » sans oublier la nourriture venant de chez Quick...).
Malgré cela, émanent de ces trois personnages principaux un tel charisme et une belle fragilité qu'on les quitte avec regret même s'ils nous laissent, comme Rizzo (lumineuse Naomi Greene)qui, dans le dernier plan, regarde à travers une vitre baignée de soleil, avec le bel espoir et la force d'un avenir (plus) radieux. Allez-y ne serait-ce que pour ces trois-là qui crèvent l'écran... Une première réalisation imparfaite mais attachante avec quelques beaux plans qui reflètent bien le tourbillon d'effervescence et de mélancolie mêlées de cette période charnière de leurs existences.
Sortie en salles : le 17 mars 201