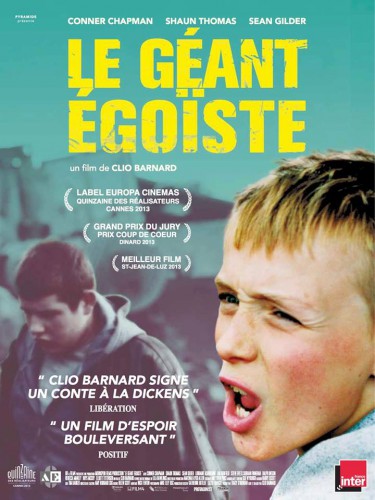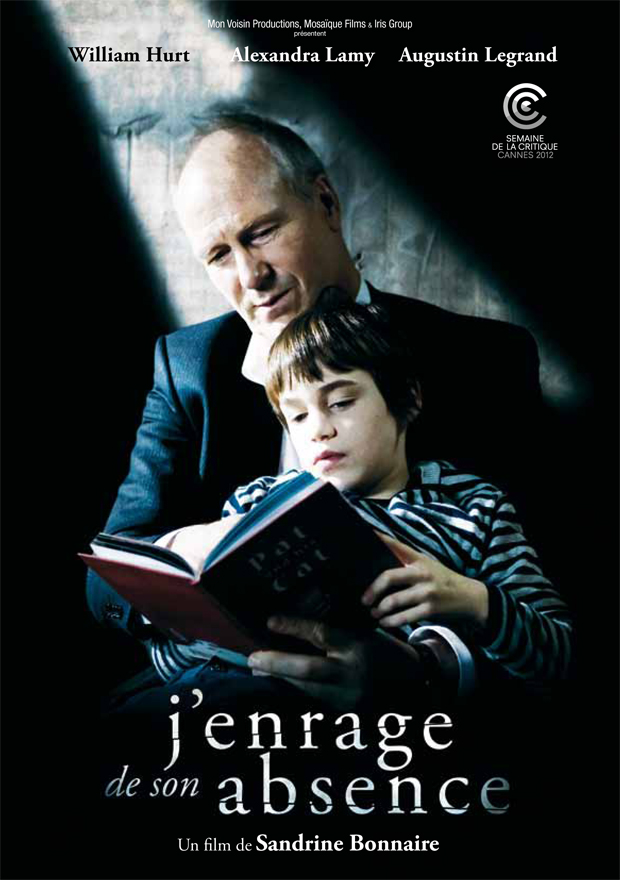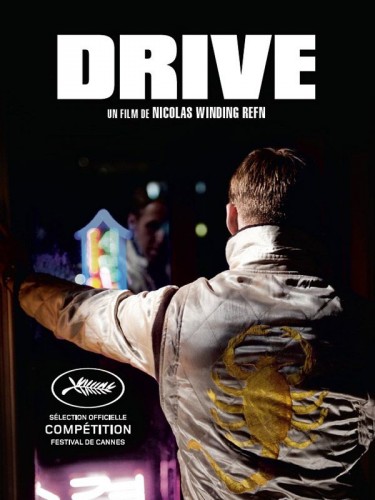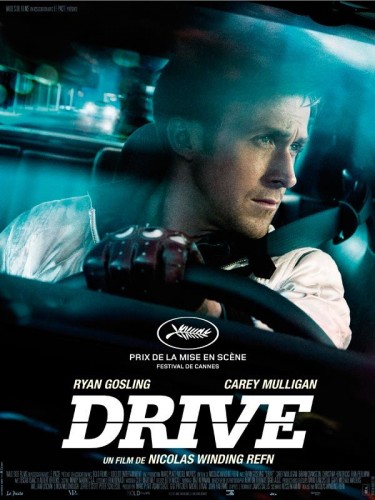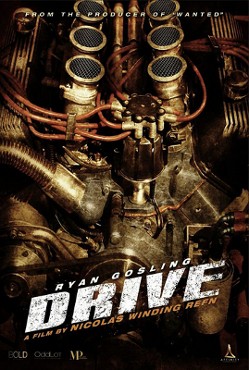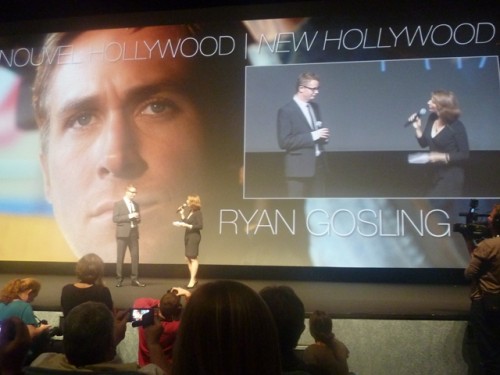Critique de WELCOME de Philippe Lioret, à 20H45, sur France 2
Pour impressionner et reconquérir sa femme Marion (Audrey Dana), Simon (Vincent Lindon), maître nageur à la piscine de Calais (là où des centaines d’immigrés clandestins tentent de traverser pour rejoindre l’Angleterre, au péril de leur vie) prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde, Bilal (Firat Ayverdi) qui tente lui-même de traverser la Manche pour rejoindre la jeune fille dont il est amoureux, Mina (Dira Ayverdi).
Cela faisait un peu plus d’un an que j’attendais la sortie de ce film, depuis que Philippe Lioret l’avait évoqué avec un enthousiasme débordant lors du Salon du Cinéma 2008… Alors ? Alors…
La première demi-heure, intense, âpre, au style documentaire suit au plus près Bilal ( au plus près de son visage, de ses émotions, de sa douleur, de ses peurs) et nous embarque d’emblée dans son parcours périlleux. Il nous embarque et il conquiert dès les premières minutes notre empathie, notre révolte aussi contre une situation inhumaine, encore à ce jour insoluble, mais contre laquelle se battent des bénévoles comme Audrey tandis que d’autres préfèrent fermer les yeux comme Simon. La réalité sociale sert ensuite de toile de fond lorsqu’apparaît Simon, et avec son apparition c’est le documentaire qui cède le pas à la fiction.
Jusqu’où iriez-vous par amour ? Tel était le slogan du précèdent film dans lequel jouait Vincent Lindon : « Pour elle ». Tel pourrait aussi être celui de « Welcome ». Ce n’est, au début, pas vraiment par altruisme qu’agit Simon mais plutôt avec l’intention d’impressionner Marion, de lui prouver qu’il n’est pas comme eux, comme ceux qui baissent la tête au lieu d’agir, comme ceux qui font éclater ou renaître un racisme latent et peu glorieux qui rappelle de tristes heures, et qui rappelle aux étrangers qu’ils sont tout sauf « welcome ».
Peu à peu Bilal, son double, va ébranler les certitudes de Simon, Simon qui se réfugiait dans l’indifférence, voire l’hostilité, aux étrangers qu’il croisait pourtant tous les jours. L’un fait face à son destin. L’autre lui a tourné le dos. L’un a été champion de natation, mais n’a pas réalisé ses rêves. L’autre rêve de devenir champion de football. Mais l’un et l’autre sont prêts à tout pour reconquérir ou retrouver la femme qu’ils aiment. L’un et l’autre vont s’enrichir mutuellement: Simon va enseigner la natation à Bilal, et Bilal va lui à ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de lui.
Le film doit beaucoup à l’interprétation de Vincent Lindon (toujours aussi exceptionnel), tout en violence et sensibilité, en force et fragilité. Il manie et allie les contradictions et les ambiguïtés de son personnage avec un talent époustouflant, faisant rapidement oublier ces déstabilisantes minutes de changement de ton et de passage du style documentaire à la fiction (ce parti pris initial de documentaire aurait peut-être été plus intéressant, mais nous aurait certes privés de l’incroyable prestation de Vincent Lindon et aurait aussi privé le film d’un certain nombre de spectateurs). L’interprétation du jeune Firat Ayverdi et des autres acteurs, également non professionnels, est elle aussi troublante de justesse et contribue à la force du film.
Philippe Lioret a coécrit le scénario avec Emmanuel Courcol, Olivier Adam (avec lequel il avait déjà coécrit « Je vais bien, ne t’en fais pas »), un scénario d’ailleurs parfois un peu trop écrit donnant lieu à quelques invraisemblances (en contradiction avec l’aspect engagé du film et la réalité de sa toile de fond) qui tranche avec l’aspect documentaire du début ( histoire de la bague un peu téléphonée) mais permet aussi de souligner certaines réalités par des détails qu’un documentaire n’aurait pas forcément pu saisir (quoique) comme cette annonce d’une avalanche aux informations et de ses quelques victimes qui semblent alors disproportionnées face à cette autre réalité passée sous silence, comme ce marquage, s'il est réel, absolument insoutenable et intolérable.
La photographie aux teintes grisâtres et la mise en scène appliquée de Philippe Lioret s’efface devant son sujet, devant ses personnages surtout, toujours au centre de l’image, souvent en gros plan, ou du moins en donnant l’impression tant ils existent et accrochent notre regard.
Peut-être aurait-il été encore plus judicieux que cette réalisation soit empreinte de la même rage et de la même tension que ceux dont elle retrace l’histoire, et peut-être est-ce ce qui manque à ce film aux accents loachiens pour qu’il ait la saveur d'un film de Loach. Peut-être aussi est-ce la raison pour laquelle je suis finalement restée sur la rive. Sans doute est-ce lié à l’attente suscitée depuis plus d’un an par ce film mais plus certainement encore par le souvenir indélébile, forcément plus viscéral et plus âpre, plus marquant parce que réel, de centaines de clandestins, dans un autre port, dans un autre pays, mais si semblables, sans doute ce souvenir de la réalité d’une souffrance inouïe soudainement sous mes yeux et si tangible prise en pleine face m’a -t-il réellement et autrement fait prendre conscience de cette douloureuse et insoutenable réalité: chaque visage (souvent très très jeune) entrevu alors portant sur lui, à la fois si pareillement et si différemment, la trace d’une longue et inconcevable route, d’une histoire douloureuse, d’une détermination inébranlable, d’un pays pour lui inhospitalier, inique ou en guerre et à quel point la réalité du pays qu’ils ont quittée devait être violente et insupportable pour qu’ils aient le courage et/ou l’unique issue de prendre tous ces risques et de se confronter à la réalité de pays qui ne souhaitent ou du moins ne savent pas forcément davantage les accueillir et panser leurs plaies.
Philippe Lioret, par ce film indéniablement engagé, a le mérite de mettre en lumière une part d’ombre de la société française, et plus largement de violentes et flagrantes disparités mondiales. Le succès connu par le filmprouve ainsi que le public ne s’intéresse pas seulement aux comédies formatées que les diffuseurs s’acharnent à lui proposer et que l’âpreté d’un sujet, pourvu qu’il soit traité avec sensibilité et intelligence, pouvait aussi susciter son intérêt et le faire se déplacer en nombre.