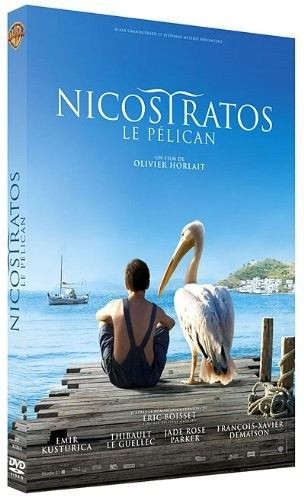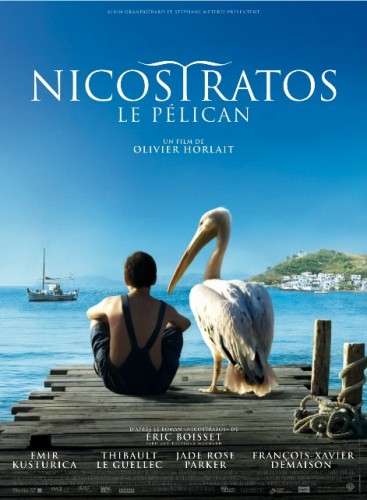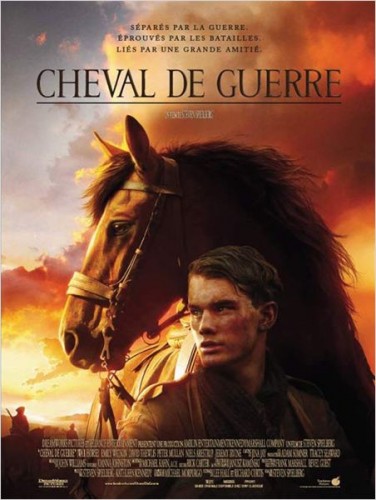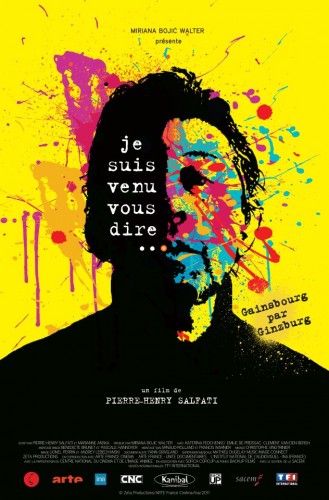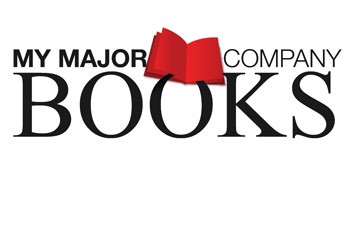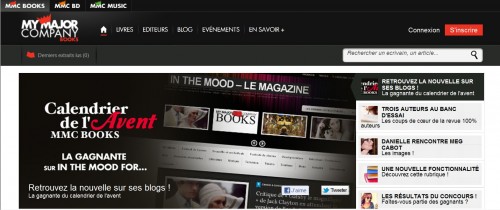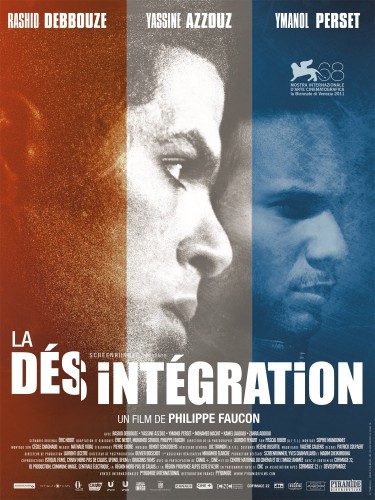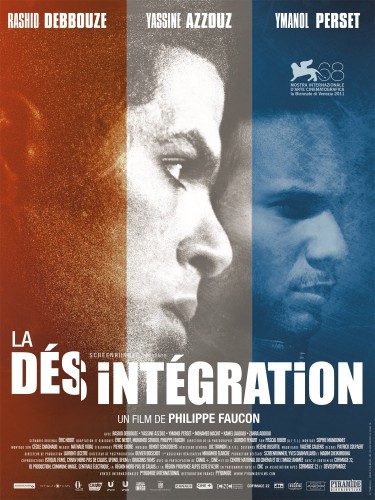
C’est avec un peu de retard que je vous parle de ce film sorti le 15 février dernier et qu’il faut absolument que vous découvriez. Je l’avoue humblement, je ne connaissais pas le travail de Philippe Faucon mais, sans aucun doute, je m’y intéresserai à l’avenir tant ce film choc traite avec simplicité, nuance, humanité, intelligence, d’un sujet complexe et dense.
L’intrigue se déroule dans une cité dans l’agglomération Lilloise, aujourd’hui.
Ali, Nasser et Hamza, âgés d’une vingtaine d’années, font la connaissance de Djamel qui dix ans de plus qu'eux.
Aux yeux d'Ali et ses amis, Djamel apparaît comme un aîné aux propos acérés et au charisme certain. Habile manipulateur, il endoctrine peu à peu les trois garçons, connaissant mieux que quiconque leurs déceptions, leurs failles et leurs révoltes face à une société dans laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense plus désormais faire partie.
Ce film, certes très court (1H18) n’en est pas moins intense. Les ellipses accroissent la force du message et, avec subtilité, Philippe Faucon (dé)montre comment les souffrances sociales, le sentiment de se sentir nié, voire rejeté, aboutissent aux replis communautaires et parfois à des actes radicaux. Toute l’intelligence de l’écriture réside dans le fait d’éviter le manichéisme (Philippe Faucon montre ainsi qu’à côté de l’Islam radical, minoritaire, existe un Islam éclairé). Son film est une implacable démonstration qui montre comment des éléments apparemment mineurs, une suite de rejets et de frustrations vont aboutir à la violence extrême comme une issue inévitable.
Plutôt que de construire un film spectaculaire, Philippe Faucon a choisi de filmer au plus près de ces hommes égarés qui basculent dans l’horreur plus par « désintégration » et parce qu’ils trouvent là une forme d’intégration que par conviction ou idéologie.
Sans artifices, sans sensationnalisme, Philippe Faucon passe par la fiction pour montrer une réalité d’une manière plus convaincante que bien des articles ou reportages, auscultant ainsi les plaies béantes d’une République qui, parfois, désintègre plus qu’elle n’intègre mais sans non plus nier les progrès –et donc l’intégration- qu’elle permet (ainsi la comparaison entre la génération des parents et celle des enfants).
Les dernières minutes du film sont d’une saisissante douleur et criantes de vérité. Les scènes qui les précèdent, au plus près du désarroi, de la folie, montrant le contraste entre la vie, là, si simple, ensoleillée, derrière la vitre, et ce dénouement effroyable qui semble inextricable, cette atmosphère cloisonnée, carcérale dans l’habitacle de la voiture à laquelle l’un d’entre eux même, si symboliquement, s’enchaîne sont aussi simples que magistrales. Un film d’une simplicité aussi radicale et saisissante que son propos.
Je ne pouvais pas terminer sans évoquer ce qui est l’autre grande force du film, ses incroyables interprètes dont l’époustouflante Zahra Addioui qui joue la mère, et dont j’ai encore du mal à croire que c’est sa première expérience de tournage tant elle est juste mais aussi Rashid Debbouze qui se fait ici plus qu’un prénom et qui crève littéralement l’écran, sidérant de justesse et d’intensité (et qui a d'autant plus de mérite qu'il n'a jamais utilisé sa célèbre parenté mais a fait son propre chemin, jouant son spectacle dans des salles parfois quasiment vides, un bel exemple d'opiniâtreté), sans oublier Yassine Azzouz, Ymanol Perset et Mohamed Nachit également remarquables. Des acteurs à suivre et un film à découvrir !