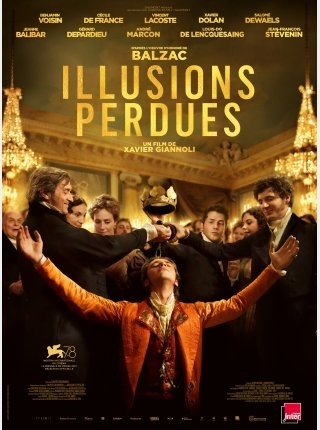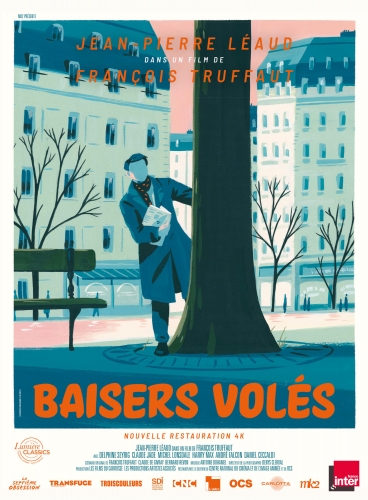Tromperie est une adaptation du livre Deception de Philip Roth publié en 1990 et sorti en 1994 en France.
1987. Philip (Denis Podalydès) est un écrivain américain célèbre installé à Londres avec son épouse (Anouk Grinberg). Sa maîtresse (Léa Seydoux) vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants dans lequel ils vivent leur amour et parlent des heures durant.
Tromperie a été présenté en séance spéciale sous le nouveau label Cannes Première du Festival de Cannes, label initié en 2021, réservé à des films de réalisateurs confirmés « que le festival suit depuis longtemps » selon la définition du Délégué Général du festival, Thierry Frémaux.
Desplechin jouait déjà la scène finale avec Emmanuelle Devos dans le bonus DVD de Rois et Reines. S’il portait donc en lui cette œuvre depuis longtemps, son adaptation ne relevait pas moins du défi. C’est avec Julie Peyr, sa coscénariste, qu’il s’y est attelé, divisant ainsi le film en onze chapitres et un épilogue. Il s’agissait en effet d’adapter un film dont l’intrigue se déroule dans les années 1980, en Angleterre, avec des acteurs français, en langue française, et un film reposant essentiellement sur les dialogues très écrits. Défi relevé magistralement puisque le résultat est absolument captivant, évoquant des sujets parfois sombres (la mort qui obsède Philip, l’âge et la maladie qui sont aussi des sujets récurrents), teinté d'ironie et même d'humour, traversé par le désir (amoureux, de vie, d’art).

Dans Les Fantômes d’Ismaël, la vie d’un cinéaste, Ismaël (Mathieu Amalric) est bouleversée par la réapparition de Carlotta, un amour disparu 20 ans auparavant. Un personnage irréel à la présence troublante et fantomatique incarné par Marion Cotillard, filmée comme une apparition, pourtant incroyablement vivante et envoûtante, notamment dans cette magnifique scène d’une grâce infinie lors de laquelle elle danse sur It Ain't Me Babe de Bob Dylan (qui à elle seule justifie de voir le film en question). Desplechin jongle avec les codes du cinéma pour mieux les tordre et nous perdre. A la frontière du réel, à la frontière des genres (drame, espionnage, fantastique, comédie, histoire d’amour), à la frontière des influences (truffaldiennes, hitchcockiennes - Carlotta est ici une référence à Carlotta Valdes dans Vertigo d’Hitchcock - ) ce film d’Arnaud Desplechin est savoureusement inclassable, et à l’image du personnage de Marion Cotillard : insaisissable, et nous laissant une forte empreinte. Comme le ferait un rêve ou un cauchemar. Un film plein de vie, un dédale dans lequel on s’égare avec délice. Un film résumé dans la réplique suivante : « la vie m'est arrivée. » La vie avec ses vicissitudes imprévisibles que la poésie du cinéma enchante et adoucit.
Si j’effectue cette digression sur Les fantômes d’Ismaël, c’est parce que j’aurais pu tirer la même conclusion de ce dernier film de Desplechin. Dès la séquence d’ouverture, le cinéma, à nouveau, (ré)enchante la vie. Le personnage de l’amante incarnée par Léa Seydoux se trouve ainsi dans une loge du théâtre des Bouffes du Nord. Là, elle se présente à nous face caméra et nous envoûte, déjà, et nous convie à cette farandole utopique, à jouer avec elle, à faire comme si, comme si tout cela n’était pas que du cinéma. Parce que ludique, ce film l’est follement, notamment lors d’une scène burlesque de procès. Mais aussi dans la première séquence entre Philip et sa maîtresse. Il lui demande alors de décrire le bureau dans lequel ils se trouvent, ce qu’elle fait les yeux fermés avec poésie, malice, avec la complicité de la caméra de Desplechin qui nous invite dans cet autre dédale, à plonger pleinement dans chaque moment, à les vivre intensément, là, dans ce bureau qui devient le lieu de la liberté. Le lieu où l’amante anglaise est écoutée sans être jugée.
L’intrigue est principalement centrée autour de Philip et de sa maîtresse dans l’appartement -bureau de l’écrivain, mais aussi jalonné de conversations, avec d’autres femmes, qui portent toutes en elles des brisures qui ne les rendent pas moins ensorcelantes, vibrantes, vivantes. Il y a là Rosalie (Emmanuelle Devos), la seule à porter un prénom, son ancienne maîtresse newyorkaise qui lutte contre le cancer mais aussi l’épouse, l’étudiante (Rebecca Marder), l’exilée tchèque (Madalina Constantin).
Tromperie est une ode constante aux pouvoir de la fiction, qu’elle soit littéraire ou cinématographique. La fiction qui sublime la vie. Par une judicieuse mise en abyme, le dispositif qu’utilise Desplechin fait écho au travail et aux ruses de l’écrivain qui s’amuse avec la réalité, la traduit, la trahit, la transgresse, lui vole des moments de vérité. D’ailleurs, l’amante existe-t-elle vraiment ? C’est là que le film prend une tournure encore plus passionnante, quand Philip pour se justifier auprès de son épouse lorsqu’elle tombe sur un carnet racontant son histoire avec son amante anglaise, explique qu’il s’agit là seulement d’un être fictif et de la matière de son nouveau roman, brouillant encore un peu plus les frontières entre le vrai et le faux, comme s’amuse à le faire aussi Desplechin dans ce film qui manie l’ellipse et les changements de tons et de décor avec maestria.

On a beaucoup évoqué Bergman à propos de ce film. Il m’a aussi souvent rappelé Alain Resnais qui, à chaque film, réinventait encore et encore le dispositif cinématographique. Il m’a notamment fait songer à Vous n’avez encore rien vu, dans lequel un homme de théâtre, après sa mort, convoque ses amis comédiens ayant joué dans différentes versions d’une pièce. Chaque phrase prononcée, d’une manière presque onirique, magique, est d’une intensité sidérante de beauté et de force et exalte la force de l’amour. Un film inventif et, là aussi, ludique qui joue avec les temporalités, avec le temps, avec la disposition dans l’espace. Il donne à jouer des répliques à des acteurs qui n’en ont plus l’âge. Cela ne fait qu’accroître la force des mots, du propos, leur douloureuse beauté et surtout cela met en relief le talent de ses comédiens. Chaque phrase qu’ils prononcent semble être la dernière et la seule, à la fois la première et l’ultime. Une sublime déclaration d’amour au théâtre et aux acteurs, un des plus beaux hommages au cinéma qu’il m’ait été donné de voir et de ressentir. Une mise en abyme déroutante, exaltante, d’une jeunesse folle, un pied-de-nez à la mort qui, au théâtre ou au cinéma, est transcendée. Un film inclassable et si séduisant, n’usant pourtant d’aucune ficelle pour l’être mais au contraire faisant confiance à l’intelligence du spectateur, qui m’avait enchantée, bouleversée, et qui m’a rappelé pourquoi j’aime follement le cinéma et le théâtre, et les mots auxquels il rend un si bel hommage.
Je me permets cette nouvelle digression parce que je pourrais là aussi employer ces mêmes termes à propos de ce nouveau film de Desplechin, déclaration d’amour aux acteurs, au théâtre, au cinéma, aux pouvoirs de l’écriture, et qui fait tout aussi confiance à l’intelligence du spectateur.
Arnaud Desplechin retrouve ici Léa Seydoux qu’il avait dirigée dans son film précédent, le remarquable Roubaix, une lumière, dans un rôle radicalement différent. Le spectateur est suspendu à chacun de ses mots. Elle est ainsi à la fois sensuelle, malicieuse, inquiète, toujours lumineuse a fortiori quand elle se rhabille et que tout devient noir autour d’elle (une des nombreuses astuces de mise en scène). Desplechin offre à chaque actrice une partition sublime dont l’ensemble permet de faire entendre une musique, celle de la voix de Philip Roth, et de dresser son portrait. Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos, Madalina Constantin, Rebecca Marder sont aussi absolument bouleversantes. En double de Roth et un peu de Desplechin, Denis Podalydès a le regard et l’écoute intenses qui le rendent successivement ironique, inquiétant, attachant, détestable, désirable, méprisable mais toujours à l’image du film : captivant.
La caméra d’Arnaud Desplechin, avec l’aide précieuse et judicieuse de son chef-opérateur Yorick Le Saux, caresse sensuellement les visages et les corps, au plus près. Sur une année, de l’automne à l’été, la lumière, est de plus en plus prégnante. Ajoutez à cela la musique de Grégoire Hetzel et une précision et une variation astucieuses des décors et vous obtiendrez une orfèvrerie de mise en scène.
Un film solaire et sensuel, parfois doucement cruel mais aussi tendre, même quand il évoque des sujets plus âpres, bouleversant, intimiste, réjouissant, élégant, à la fois léger et sombre. Une réflexion passionnante sur l’art aussi et sur la vérité, une réflexion à laquelle cette brillante mise en abyme invite, nous emportant dans son tourbillon fascinant de mots et, surtout, de cinéma.